ESPACE MEMBRE

Retour sur la matinée Finances locales de l’APVF !
La journée Finances locales de l’APVF, organisée en partenariat avec le Groupe BPCE, s’est tenue ce matin au #Cloud business center. Des intervenants de qualité et des échanges riches. Jérémy Estrader, Directeur des marchés Institutionnels & Immobilier Professionnel du Groupe BPCE, et Antoine Homé, Maire de Wittenheim, Premier vice-président de l’APVF, ont introduit les travaux. …
La journée Finances locales de l’APVF, organisée en partenariat avec le Groupe BPCE, s’est tenue ce matin au #Cloud business center. Des intervenants de qualité et des échanges riches.
Jérémy Estrader, Directeur des marchés Institutionnels & Immobilier Professionnel du Groupe BPCE, et Antoine Homé, Maire de Wittenheim, Premier vice-président de l’APVF, ont introduit les travaux.
Tirant les conséquences de la crise sanitaire et les besoins de relance économique dans les territoires, Jérémy Estrader a rappelé les deux grandes ambitions du groupe BPCE pour les années à venir, à savoir une volonté de s’affirmer comme un banquier tourné vers la coordination territoriale et l’économie sociale et solidaire, mais également de soutenir les projets de territoire axés sur les transitions, notamment énergétique et numérique, et l’accès aux soins pour tous.
Le caractère fécond et pérenne du partenariat avec le groupe BPCE a été souligné à plusieurs reprises par Antoine Homé. Sa présence aux Assises et sur les grands évènements thématiques organisés par l’APVF est précieuse pour les petites villes, qui peuvent bénéficier d’un puissant réseau et d’un levier pour la relance. Le Premier vice-président de l’APVF a ensuite rappelé l’impact du contexte de crise sanitaire sur les budgets locaux depuis 2020 et les attentes des collectivités territoriales vis-à-vis de l’Etat : l’établissement d’une véritable relation de confiance à travers la stabilisation des dotations, une plus grande liberté d’emploi des subventions d’investissement et surtout, une véritable contractualisation fondée sur les politiques d’avenir que l’Etat seul ne peut plus assumer.
Jean-Pierre Coblentz, Directeur associé Stratorial finances, a présenté ensuite le détail du PLF 2022. S’il contient moins de dispositions touchant aux collectivités territoriales, certaines mesures risquent d’avoir des conséquences non négligeables pour les communes et particulièrement les petites villes. Il en va précisément de la réforme des indicateurs financiers dont les effets ne peuvent à ce jour pas être maîtrisés, mais qui aura un impact réel sur la définition de l’effort fiscal des communes servant de base au calcul des dotations de péréquation et du FPIC.
Comme l’a illustré André Laignel, Maire d’Issoudun, Président du Comité des finances locales, avec cette réforme des indicateurs financiers, on pénalise les collectivités territoriales qui ont joué le jeu de l’intercommunalité. Plus généralement, s’agissant des grandes masses engagées en 2022, André Laignel regrette quant à lui le caractère « stagnant » de ce nouveau PLF, voire préjudiciable aux collectivités territoriales, qui subissent une grave contraction de leur épargne nette et un affaiblissement de leur capacité à investir.
Jean-René Cazeneuve, Député du Gers, Président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale, a pourtant rappelé la bonne résilience des collectivités territoriales malgré un contexte extrêmement difficile. Elles ont mieux fait que l’Etat lui-même. Très conscient du besoin de visibilité et de prévisibilité des Maires pour planifier leurs investissements, il s’est dit intéressé par la proposition formulée par l’APVF d’établir une véritable contractualisation fondée sur la confiance. Claude RAYNAL, Sénateur de la Haute-Garonne, Président de la Commission des finances du Sénat, malgré l’optimisme de Jean-René Cazeneuve, craint que le niveau d'épargne de 2019 ne soit pas atteint avant longtemps entrainant un risque important pour l’investissement public. Certaines collectivités territoriales, particulièrement industrielles, pourront être lourdement impactées par la baisse de la CVAE en 2022. Il a également évoqué le manque de recul sur les conséquences de la suppression de la TH.
Après un temps d’échanges avec la salle, Julien Megdoud est intervenu pour l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) pour présenter un état des lieux de la mise en place des contrats territoriaux de transition écologique et de relance dans les territoires (CRTE). Il a rappelé toute la nécessité d’un meilleur ancrage territorial de ces contrats et d’une implication plus forte des Maires. Des pistes d’amélioration du dispositif sont donc possibles et l’ANCT doit pouvoir les accompagner.
La matinée de travail s’est achevée sur une table-ronde consacrée aux moyens mobilisés par élus des petites villes en faveur de la relance. Et, tant Charlotte Blandiot-Faride, Maire de Mitry Mory, que Romain Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine, ont témoigné d’une certaine inquiétude et déception : de l’énergie dépensée dans le montage de projets sans garantie d’obtention des crédits afférents, une mainmise des préfets de régions et une logique d’appels à projet qui ne favorisent pas la capacité des élus des petites villes en manque d’ingénierie à capter les crédits d’investissement. En contrepied, Christian Gros, Maire de Monteux, a opté pour l’emprunt auprès de la Caisse d’Epargne, mais aussi de la Banque des territoires, selon des modalités intéressantes et sécurisées, pour mener à bien ses projets. Enfin, Romain Colas, a posé la question de la fiscalité locale et du consentement à l’impôt, enjeux démocratiques fondamentaux auxquels il est nécessaire de s’atteler sérieusement et rapidement.
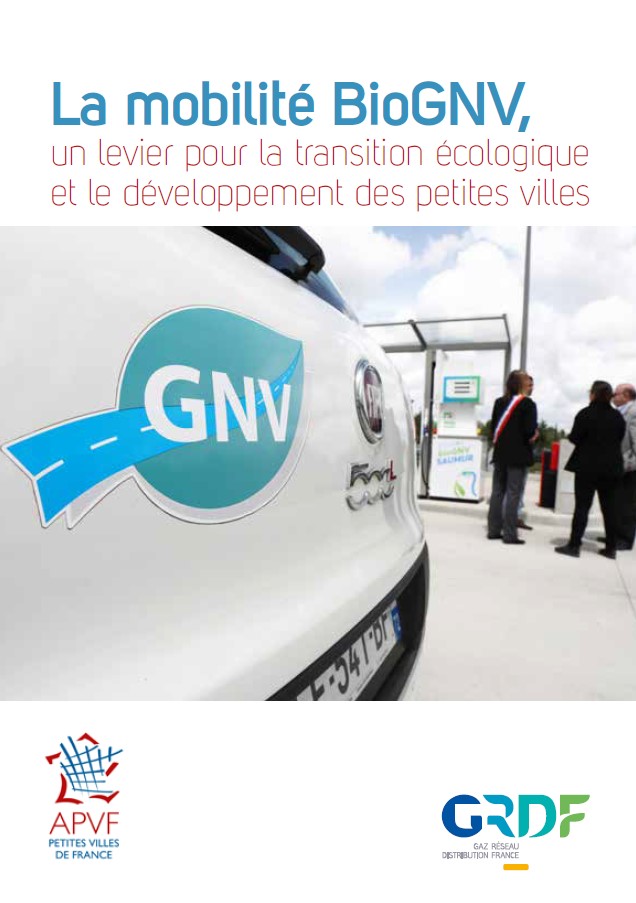
Gaz Vert : L’APVF et GRDF guident les élus
L’APVF et son partenaire GRDF publient un livret pour tout comprendre de la mobilité BioGNV dans les petites villes avec des témoignages d’experts mais aussi d’élus locaux en avance sur ce sujet. Le biogaz est en effet un facteur de décarbonation de notre énergie mais aussi de développement de nos territoires. Le biogaz permet de …
L’APVF et son partenaire GRDF publient un livret pour tout comprendre de la mobilité BioGNV dans les petites villes avec des témoignages d’experts mais aussi d’élus locaux en avance sur ce sujet.
Le biogaz est en effet un facteur de décarbonation de notre énergie mais aussi de développement de nos territoires.
Le biogaz permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire avec un gaz moins polluant mais aussi car il réutilise les déchets agricoles et évite les émissions liées à leur élimination. Le biogaz c’est aussi une énergie qui permet de réduire la pollution sonore source de stress.
Le biogaz est par ailleurs un bon levier pour redynamiser le territoire autour de filières durables. Plusieurs emplois ont été créés à Cestas ou encore Liffré grâce aux usines de méthanisation.
Le rôle de l’échelon communal est essentiel dans ce type de projet pour collecter et transformer les biodéchets mais aussi pour contribuer à l’ouverture de station biognv ouverte au public.
Par exemple, la commune de Chamonix a pu améliorer la qualité de son air grâce au biognv produit et utilisé sur son territoire.
Pour retrouver la fiche, cliquez ici
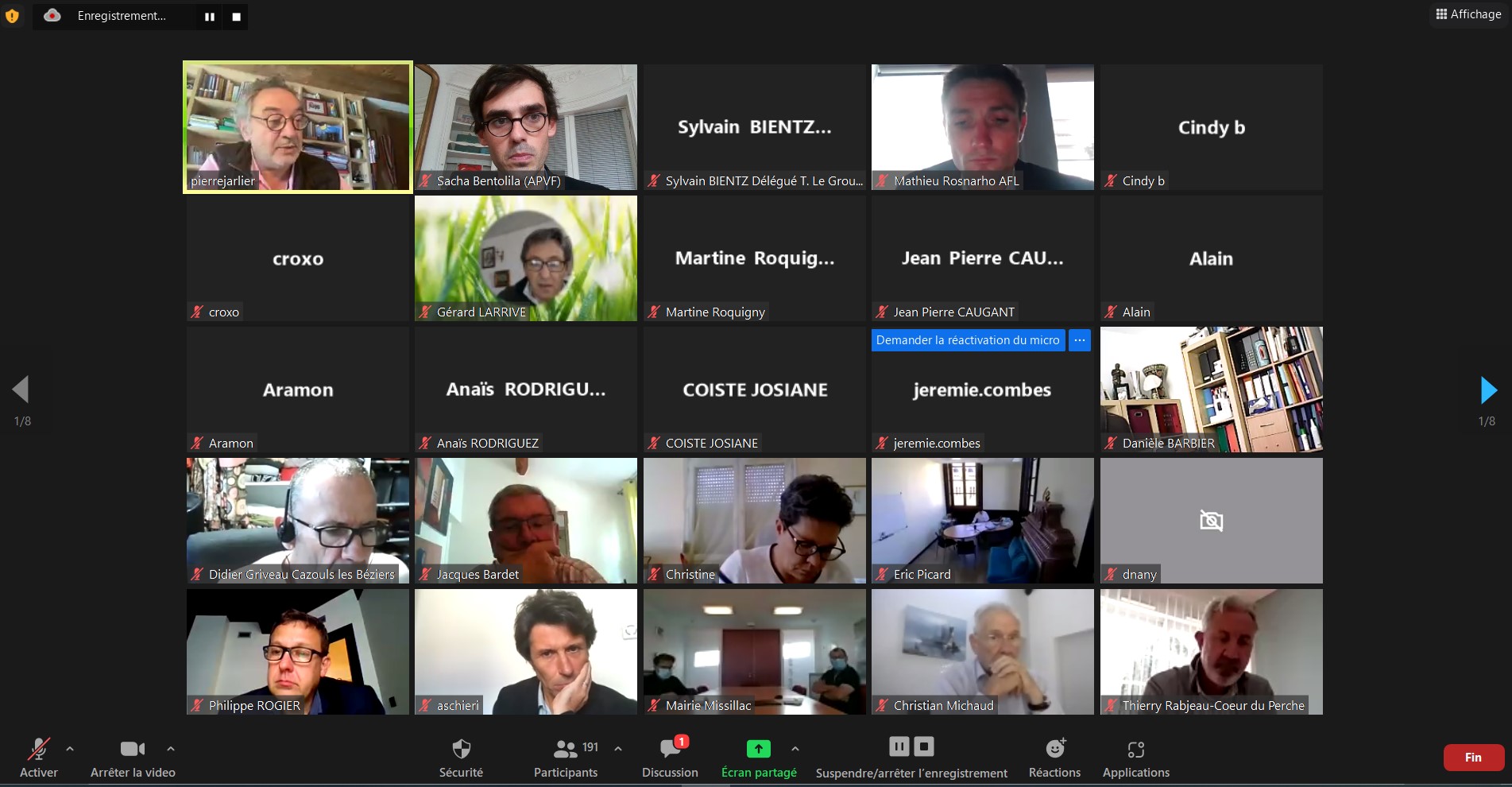
Financement de la transition écologique : Retour sur le webinaire de l’APVF et de l’AFL
L’Agence France Locale et l’APVF ont organisé le mardi 12 octobre dernier un webinaire qui a réuni plus de 200 participants sur le financement de la transition écologique. Ce webinaire animé par Pierre Jarlier, Président d’Honneur de l’APVF, fait suite à l’étude publiée par l’AFL et l’APVF sur le financement de la transition écologique dans …
L’Agence France Locale et l’APVF ont organisé le mardi 12 octobre dernier un webinaire qui a réuni plus de 200 participants sur le financement de la transition écologique. Ce webinaire animé par Pierre Jarlier, Président d’Honneur de l’APVF, fait suite à l’étude publiée par l’AFL et l’APVF sur le financement de la transition écologique dans les petites villes.
En introduction, Pierre Jarlier a rappelé les grands enjeux des petites villes en matière de transition écologique. Ce sont les territoires qui sont au cœur de la gestion des déchets, des mobilités mais aussi de la biodiversité et des énergies renouvelables. Mais les freins sont nombreux notamment financiers ou techniques. Cette étude et ce webinaire doivent permettre de mieux appréhender ces freins et les leviers pour les dépasser.
Philippe Rogier, Directeur des adhésions et du crédit à l’AFL, est revenu sur les conclusions de l’étude basée sur un questionnaire répondu par presque 600 communes. Sur les constats, cette étude montre bien que la transition écologique est au cœur des politiques locales et que la commune est le pilier de cette transition. Les priorités des petites villes sont l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Sur les freins, la multitude d’acteurs de soutien est une difficulté essentielle comme le manque de financements. Pour lever ces freins, les élus locaux proposent d’adapter les dispositifs de soutien à chaque territoire mais aussi de mieux diffuser l’information. La mutualisation entre les collectivités et la plus grande territorialisation des opérateurs de l’Etat sont également mises en avant par les petites villes.
Pierre Aschieri, Maire de Mouans Sartoux, est revenu ensuite sur les difficultés financières des collectivités de plus en plus grandes. Il faut innover et être imaginatif pour relever le défi écologique rappelle le Maire de Mouans Sartoux. Il a également rappelé la nécessité d’accompagner les petites villes dans la recherche de financement. Il est essentiel que des projets communaux soit également éligibles aux financements et pas seulement les projets des intercommunalités.
Edith Lamarque, Directrice générale adjointe de Saint-Avé, est ensuite revenue sur le projet écologique de la commune à la pointe sur le sujet. La commune de Saint-Avé a mis la transition écologique au cœur de son projet de territoire. L’ensemble des politiques publiques sont élaborées à partir de cet objectif. Néanmoins, la dispersion des compétences dans ce domaine pose des problèmes de cohérence et d’efficacité. Elle a également rappelé la difficulté de capter l’ingénierie et de remporter les appels à projet qui favorisent les grands territoires. Pour lever ces freins, la ville se Saint -Avé a créé un poste de Directeur des transitions.
Frank Sentier, Délégué général du réseau Flame, est revenu sur le rôle clé des Alec dans les territoires et notamment dans les petites villes. Les ALEC couvrent 6 600 communes dont 900 petites villes. Elles sont un outil de mutualisation et de mobilisation des acteurs. Charline Lasterre, Directrice de l’ALEC du Pays de Saint Brieuc, a ensuite présenté le rôle concret d’une Alec dans une petite ville notamment sur le montage de dossier pour les appels à projet.
Durant les questions, Pierre Aschieri a rappelé la nécessité de faire du cousu main et d’adapter les politique aux spécificités de chaque territoire. Frank sentier a rappelé de son côté que la création du l’ALEC reposait avant tout sur la volonté politique des territoires. La fédération aide à la création des ALEC locales.
En conclusion, Pierre Jarlier est revenu sur la nécessité renforcer le soutien en ingénierie mais aussi les financements alloués aux territoires qui portent la transition écologique. La mise en place d’un guichet unique est également un levier essentiel.
Contact de intervenants :
Philippe Rogier, Directeur des adhésions et du crédit de l’AFL, philippe.rogier@afl-banque.fr
Frank Sentier, Délégué général du réseau Flame, frank.sentier@federation-flame.org
Pierre Aschieri, Maire de Mouans Sartoux, aschieri@mouans-sartoux.net
Edith Lamarque, DGA de Saint Avé edith.lamarque@saint-ave.bzh
Pour retrouver l’étude, cliquez ici.
Pour retrouver les supports de présentation, cliquez ici
Pour revoir le webinaire, cliquez ici
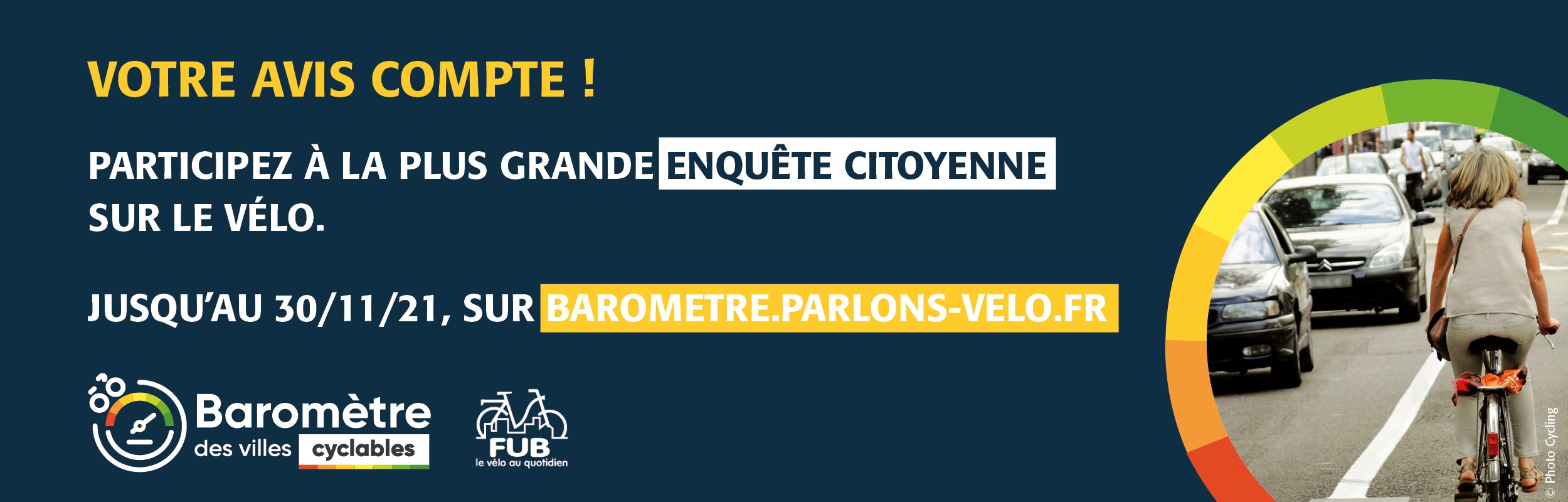
Territoires et vélo : Lancement du 3e baromètre des villes cyclables.
La FUB, la fédération française des usagers de bicyclette, lance la 3e édition de la plus grande enquête citoyenne sur le vélo au quotidien en France : le Baromètre des villes cyclables. C’est un enjeu essentiel dans les grandes métropoles mais aussi dans les petites villes. Cette enquête en ligne permet de mesurer la satisfaction …
La FUB, la fédération française des usagers de bicyclette, lance la 3e édition de la plus grande enquête citoyenne sur le vélo au quotidien en France : le Baromètre des villes cyclables. C’est un enjeu essentiel dans les grandes métropoles mais aussi dans les petites villes.
Cette enquête en ligne permet de mesurer la satisfaction et de recueillir les attentes des usagers concernant leurs déplacements à vélo, dans toutes les communes de France. La 3e édition du Baromètre des villes cyclables est réalisée avec le soutien du ministère de la Transition écologique, LCL et Vélogik, acteurs engagés en faveur du développement de la pratique du vélo au quotidien
Pour participer à l’enquête, cliquez ici.
|
À propos de la FUB À travers son réseau de plus de 460 associations locales réparties sur tout le territoire, la FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, agit pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes et pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien. La FUB oeuvre ainsi pour une meilleure prise en compte des usagers cyclistes dans les politiques de transports, la réglementation, les aménagements et l'éducation. |

Le Ministère de l'Intérieur lance un appel à candidatures pour la déconcentration de ses services
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le 16 septembre dernier en Corrèze sa volonté de réinstaller hors de la capitale 1 500 postes du ministère de l’Intérieur. Un appel à candidature des communes est ouvert jusqu’au 31 octobre. 1 500 postes des services centraux du ministère de l’Intérieur doivent être relocalisés entre 2022 …
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le 16 septembre dernier en Corrèze sa volonté de réinstaller hors de la capitale 1 500 postes du ministère de l’Intérieur. Un appel à candidature des communes est ouvert jusqu’au 31 octobre.
1 500 postes des services centraux du ministère de l’Intérieur doivent être relocalisés entre 2022 et 2025.
Ce mouvement de déconcentration doit répondre à des objectifs de proximité et d’efficacité.
Entre 15 et 230 agents seront affectés par ville d’implantation. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 31 octobre 2021 auprès du préfet de département.

Fin de la gratuité des tests
A partir du 15 octobre, les tests Covid ne sont plus gratuits. Un certain nombre de dérogations persistent cependant. Fin de la gratuité des tests A partir de vendredi, les tests Covid ne sont plus gratuits. 2 types de tests sont toujours reconnus pour l’obtention du pass sanitaire : le test antigénique et le test …
A partir du 15 octobre, les tests Covid ne sont plus gratuits. Un certain nombre de dérogations persistent cependant.
Fin de la gratuité des tests
A partir de vendredi, les tests Covid ne sont plus gratuits. 2 types de tests sont toujours reconnus pour l'obtention du pass sanitaire : le test antigénique et le test PCR. Les autotests sous supervision d'un professionnel de santé ne sont plus admis.
Des dérogations
Un certain nombre de dérogations existent. Ainsi, les personnes présentant un schéma vaccinal complet pourront toujours se faire tester gratuitement en officine ou en laboratoire. Les mineurs ne sont pas non plus concernés par cette mesure. En outre, les personnes contactées par l'Assurance Maladie ou les personnes concernées par une campagne de dépistage n'auront pas à payer leur test. Enfin, en cas de prescription médicale ou de possession d'un certificat de rétablissement de moins de 10 mois, le test demeure gratuit.
Enfin, il est à noter que la prise en charge par l'Assurance Maladie se poursuite dans les territoires en état d'urgence sanitaire. Les Antilles et la Guyane sont donc concernées. Mayotte ne relèvera pas du droit commun, en raison de l'état de son système de santé.
Poursuite de l'expérimentation pour un nouveau protocole sanitaire dans les écoles
Concernant le protocole sanitaire dans les écoles, une expérimentation est en cours dans 10 départements. Les autorités sanitaires proposent un changement de paradigme. A une logique de test systématique et régulier, elles privilégieraient une logique réactionnelle. La démarche peut être résumée par "En cas de suspicion de cas, on teste la classe". Cette démarche suppose un haut niveau de réactivité.
L'expérimentation se déroulera jusqu'à la Toussaint. Une prolongation est possible. Il est à noter qu'il s'agit d'une expérimentation sur le temps scolaire ; le périscolaire n'est pas concerné.

A Coulaines, des fleurs en or
Le jury national du Label « Villes et Villages Fleuris » réuni en séance plénière le mercredi 22 septembre 2021 a décidé de renouveler la « 4ème Fleur » à la commune de Coulaines (Sarthe). Les experts lui attribuent le prix « Fleur d’Or 2021 ». Attribué aux communes “4 Fleurs” qui présentent une démarche …
Le jury national du Label « Villes et Villages Fleuris » réuni en séance plénière le mercredi 22 septembre 2021 a décidé de renouveler la « 4ème Fleur » à la commune de Coulaines (Sarthe). Les experts lui attribuent le prix « Fleur d’Or 2021 ».
Attribué aux communes "4 Fleurs" qui présentent une démarche exemplaire, ce trophée millésimé est valable un an. Il ne peut être attribué qu’une seule fois pendant une période de six ans.
En 2020, seules 4 communes ont obtenu ce prix "Fleur d'or".
Sur la photo, de gauche à droite : Mme Khady GRANDRY, Responsable des Espaces Verts ; Monsieur Didier LE BARS, adjoint au Maire en charge des investissements durables et du suivi des interventions de proximité ; Madame Yaël Haddad, membre du jury et journaliste du paysage ; Monsieur Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines.
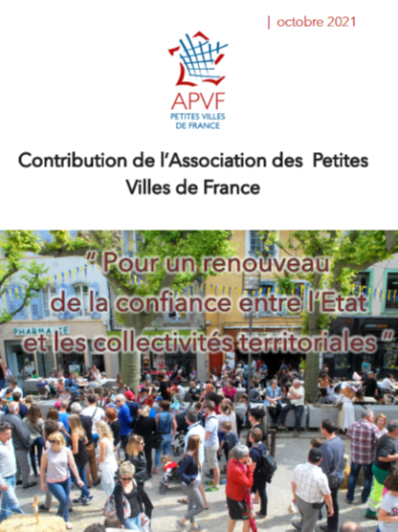
Nouveau pacte de confiance entre l’Etat et les collectivités territoriales : les 10 préconisations de l’APVF
L’APVF précise les modalités de son nouveau Pacte, dont les grandes lignes ont été esquissées lors de ses 23èmes Assises, les 9 et 10 septembre 2021 à Cenon. Il a pour ambition de garantir des relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales, confiantes, solidaires et responsables, et donc respectueuses des principes constitutionnels de libre …
L’APVF précise les modalités de son nouveau Pacte, dont les grandes lignes ont été esquissées lors de ses 23èmes Assises, les 9 et 10 septembre 2021 à Cenon. Il a pour ambition de garantir des relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales, confiantes, solidaires et responsables, et donc respectueuses des principes constitutionnels de libre administration et d’autonomie financière locale.
Si les grandes lois de décentralisation des années 80 devaient élever les collectivités territoriales au rang des partenaires majeurs de l’Etat, leurs relations financières sont, depuis une vingtaine d’années, marquées du sceau de la défiance. En réalité, c’est à une recentralisation rampante à laquelle nous assistons. Les baisses unilatérales des dotations, l’encadrement de la dépense locale et la suppression régulière d’impôts directs locaux portent gravement atteinte à l’autonomie financière et fragilisent les finances locales. Elles illustrent la volonté de l’Etat d’une reprise en main de ce qu’il avait concédé à contre cœur lors du vote des lois Defferre-Mauroy. Les élus locaux ont le sentiment d’être dépossédés de leur liberté de faire et, par conséquent, de leurs responsabilités.
C’est bien d’un renouveau de confiance entre l’Etat et les collectivités territoriales dont notre pays a besoin. Cela relève d’une exigence démocratique, mais aussi d’une exigence d’efficacité pour faire face aux grands défis des transitions auxquels les territoires sont confrontés et que l’Etat seul n’est plus en mesure de relever.
A cette fin, l’APVF formule 10 préconisations qui s’articulent autour de 3 grands axes : changer de paradigme, changer de méthode et réaffirmer les grands principes de la décentralisation.
Changer de paradigme :
Proposition n° 1. Les finances locales doivent être en mesure de répondre aux grands défis de la transition
Proposition n° 2. Les finances locales ne peuvent plus être la variable d’ajustement du budget de l’Etat
Changer de méthode :
Proposition n° 3. Etablir une contractualisation réellement équilibrée entre l’Etat et les collectivités territoriales
Proposition n° 4. Mettre en place une instance efficace de dialogue et de prise de décision concertée
Proposition n° 5. Modifier les règles d’évolution des concours financiers de l’Etat : vers un mode de revalorisation plus juste et une stabilisation de la DGF garantie dans le temps
Proposition n° 6. Assurer la garantie des ressources de chaque collectivité territoriale : redonner du sens et de la prévisibilité à la DGF
Proposition n° 7. Renforcer le pouvoir des élus locaux dans l’affectation des dotations de soutien à l’investissement public local : vers une déconcentration et une globalisation des subventions d’investissement
Réaffirmer les grands principes de la décentralisation :
Proposition n° 8. L’autonomie financière : une composante essentielle de la libre administration des collectivités territoriales qui doit être redéfinie
Proposition n° 9. Le consentement à l’impôt : un aspect majeur de la démocratie locale qui doit être préservé et qui impose une réflexion ambitieuse sur la fiscalité
Proposition n° 10. Une fiscalité locale plus juste qui doit s’accompagner de mécanismes de péréquation efficaces
***
Téléchargez le nouveau Pacte de confiance entre l’Etat et les collectivités territoriales en cliquant ici.
Téléchargez la Tribune du Président de l’APVF, Christophe Bouillon, parue dans la Gazette des communes en cliquant ici.
Téléchargez le communiqué de presse en cliquant ici.
***
JOURNEE FINANCES LOCALES DE L'APVF LE 21 OCTOBRE AU #CLOUD BUSINESS CENTER (10 bis rue du 4 septembre 75002) : derniers jours pour s'inscrire !

PLF2022 : L’APVF auditionnée sur les enjeux de revitalisation
Harold Huwart, Vice Président de l’APVF, Maire de Nogent le Rotrou, été auditionné par la députée Laurianne Rossi sur la mission cohésions des territoires du PLF2022. L’ADF et l’ADCF étaient également présents. Sur la question de l’ANCT, le Maire de Nogent le Rotrou a tenu tout d’abord à saluer l’esprit originel de l’ANCT partagé par …
Harold Huwart, Vice Président de l'APVF, Maire de Nogent le Rotrou, été auditionné par la députée Laurianne Rossi sur la mission cohésions des territoires du PLF2022. L’ADF et l’ADCF étaient également présents.
Sur la question de l’ANCT, le Maire de Nogent le Rotrou a tenu tout d’abord à saluer l’esprit originel de l’ANCT partagé par tous. Il a néanmoins tenu à souligner le manque d’ancrage local et de moyens de l’agence. Il faut créer un guichet unique et mettre en place un délégué spécial de l’ANCT dans chaque département qui permettra de rapprocher l’Agence des territoires. Il faut aussi renforcer « les troupes au sol » rappelle le vice-président de l’APVF. L’ANCT a aujourd’hui moins de moyens humains que le CGET. Les autres représentants des collectivités partagent cette position.
Sur Action Cœur de ville et petites villes de demain, l’APVF a salué le succès de ces dispositifs et notamment de petites villes demain dont elle est partenaire national. Elle a néanmoins alerté sur le risque de dilution des financements au regard du nombre plus important que prévu de l’Etat dans le programme. Il faut renforcer le volet soutien à l’investissement et cibler le programme sur les territoires qui en ont le plus besoin. L’ensemble des associations d’élus sont unanimes sur l’impact de la multiplication des appels à projet qui profite en priorité aux grandes aires urbaines mieux dotés pour y répondre.
Sur France Services, l’APVF tire un bilan globalement plutôt positif du dispositif. Elle attire néanmoins l’attention sur le reste à charge pour les collectivités mais aussi sur la nécessité que les Maisons France Services ne débouchent pas sur la disparition des services publics dans les territoires.
Pour finir, les représentants des associations d’élus ont abordé la question des contrats plan Etat Région. Harold Huwart a profité de l’occasion pour rappeler la nécessité de bien associer le bloc communal à l’élaboration des CPER via les CTAP par exemple. Il a également alerté sur la question du manque d’engagement de certains financements en raison de la complexité des procédures.
Pour retrouver la note de l’APVF, cliquez ici.

Petites villes de demain : L’APVF demande à la Ministre un renforcement du volet soutien à l'investissement
Suite à l’annonce par le Premier ministre d’un abondement de 350 millions de DSIL pour l’année 2022 au Congrès des petites villes à Cenon, l’APVF a tenu à attirer l’attention de la Ministre sur la nécessité de bien cibler ces financements supplémentaires sur la revitalisation de nos territoires. La réussite du plan passe en effet …
Suite à l’annonce par le Premier ministre d’un abondement de 350 millions de DSIL pour l’année 2022 au Congrès des petites villes à Cenon, l’APVF a tenu à attirer l’attention de la Ministre sur la nécessité de bien cibler ces financements supplémentaires sur la revitalisation de nos territoires.
La réussite du plan passe en effet par un soutien à l’ingénierie mais aussi un soutien en investissement tout aussi essentiel. Plusieurs petites villes ont déjà des projets prêts et ont besoin de financements pour les mettre en œuvre.
Les petites villes s’inquiètent également du risque de dilution des financements mobilisés au regard du nombre plus important de communes retenues.
Le programme petites villes de demain doit constituer enfin un axe fort de la relance et venir soutenir les territoires fragilisées par la crise.
L’APVF a donc fait part à la Ministre de ces différentes inquiétudes et attire l’attention sur la nécessité de bien cibler les financements supplémentaires sur les territoires qui en ont le plus besoin.
Pour retrouver l’intégralité du courrier, cliquez ici
