ESPACE MEMBRE
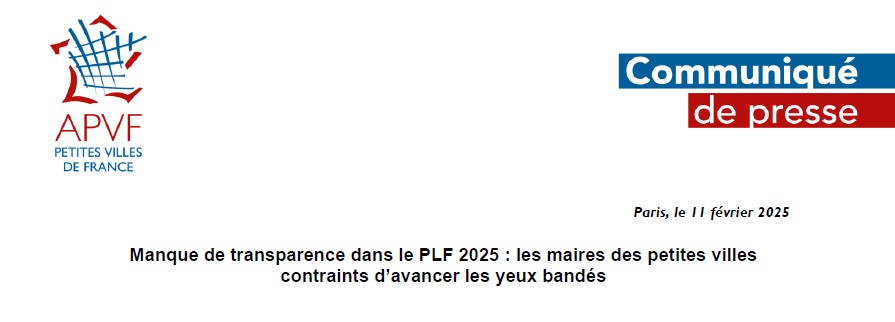
Manque de transparence dans le PLF 2025 : les maires des petites villes contraints d’avancer les yeux bandés
L’APVF a déploré, dans un communiqué de presse en date du 11 février, les incertitudes et le manque de clarté de certaines dispositions relatives aux collectivités territoriales dans le Projet de loi de finances pour 2025 (PLF 2025), et notamment sur les modalités d’application du Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales …
L’APVF a déploré, dans un communiqué de presse en date du 11 février, les incertitudes et le manque de clarté de certaines dispositions relatives aux collectivités territoriales dans le Projet de loi de finances pour 2025 (PLF 2025), et notamment sur les modalités d’application du Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico).
Outre que le Dilico soit contestable en son principe, étant donné que les collectivités territoriales ne sont responsables en rien de la dégradation des comptes de la nation, ses implications pratiques sont encore obscures pour les maires des petites villes, qui pour beaucoup tentent de finaliser leur débat d’orientation budgétaire. L’APVF a rappelé que l’élargissement du périmètre du Dilico concerne tout particulièrement les petites villes, qui doivent pourtant supporter d’importantes charges de centralité. A l’heure où est publié ce communiqué, la liste officielle des communes concernées par le dispositif est encore inconnue, de même que le montant de leur mise à contribution.
D’après les simulations de Jean-Pierre Coblentz, notre consultant expert en finances et fiscalité locales chez Stratorial, près de 20 % des petites villes seront contributrices pour un montant total de 66 millions d'euros (soit un tiers de l'effort demandé aux communes), les contributions allant de 1 059 euros pour une commune de 2 700 habitants, à plus d'1,2 millions d'euros pour une commune de 22 000 habitants. Dans l'attente d'une communication plus officielle de la part de l'Etat, l'APVF a adressé un courrier aux Maires des petites villes concernées pour les convier à une réunion d'information, en partenariat avec Stratorial, sur le Dilico, le 4 mars, de 14H30 à 16H.
L’APVF a rappelé par ailleurs que le Dilico n’est pas le seul dispositif à impacter le budget des collectivités territoriales. La section de fonctionnement des communes sera fortement affectée par la forte hausse de la cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), imposée sans concertation (en 2025, l'impact est de 280 millions pour l'ensemble des petites villes), ou par la non-indexation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). De même, la section d’investissement pâtira indubitablement des coupes effectuées dans le Fonds vert ou la Dotation de soutien à l’investissement (DSIL). De surcroît, les départements et les régions, qui sont les partenaires naturels des petites villes, devront réduire leur soutien du fait des restrictions budgétaires.
Les maires des petites villes auront à cœur de travailler à ce que ces mesures aient le moins d’impact possible sur la qualité des services publics et la qualité de vie de leurs administrés. Mais pour ce faire, dans un contexte d’instabilité politique inédit sous la Ve République, l’APVF demande à l’Etat de la transparence et de la prévisibilité au niveau budgétaire. L’APVF répondra, comme à son habitude, présente pour que ce dialogue exigeant ait lieu.
Télécharger le communiqué de presse
Télécharger le courrier adressé à l'ensemble des petites villes contributrices au Dilico

L’APVF arrive sur Instagram !
L’Association des Petites Villes de France (APVF) est désormais présente sur Instagram. Ce nouveau canal de communication permettra de valoriser l’action des petites villes, de partager les initiatives locales et de suivre au plus près l’actualité des territoires. À travers cette présence sur Instagram, l’APVF souhaite partager un regard sur les enjeux qui concernent les …
L’Association des Petites Villes de France (APVF) est désormais présente sur Instagram. Ce nouveau canal de communication permettra de valoriser l’action des petites villes, de partager les initiatives locales et de suivre au plus près l’actualité des territoires.
À travers cette présence sur Instagram, l’APVF souhaite partager un regard sur les enjeux qui concernent les territoires, tout en facilitant les échanges avec les élus locaux et les acteurs engagés dans le développement des petites villes.
Nous vous invitons à nous suivre sur @petites.villes pour découvrir et échanger autour des enjeux qui façonnent nos villes à taille humaine.

Communes nouvelles : une solution pour l’élection du maire adoptée définitivement
L’Assemblée nationale a adopté, sans modification, la proposition de loi visant à permettre l’élection du maire dans les communes nouvelles en cas de conseil municipal incomplet. Ce texte, qui répond à une difficulté rencontrée à Rives-du-Fougerais (Vendée), assure la continuité du fonctionnement des conseils municipaux jusqu’au prochain renouvellement général. Adoptée lundi 11 février 2025 par …
L’Assemblée nationale a adopté, sans modification, la proposition de loi visant à permettre l’élection du maire dans les communes nouvelles en cas de conseil municipal incomplet. Ce texte, qui répond à une difficulté rencontrée à Rives-du-Fougerais (Vendée), assure la continuité du fonctionnement des conseils municipaux jusqu’au prochain renouvellement général.
Adoptée lundi 11 février 2025 par l’Assemblée nationale et déjà validée par le Sénat, la proposition de loi vise à résoudre le problème spécifique des communes nouvelles où le mécanisme habituel d’intégration d’un « suivant de liste » est inapplicable. Dans la commune nouvelle de Rives-du-Fougerais (Vendée), le décès du maire a rendu impossible l’élection d’un remplaçant avec un conseil municipal initialement complet, composé de l’ensemble des conseillers issus des anciennes communes.
La nouvelle disposition autorise désormais l’élection du maire par un conseil municipal incomplet jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux, évitant ainsi l’obligation d’organiser de nouvelles élections qui entraîneraient une réduction significative du nombre de conseillers.
L’initiative, portée par la ministre Françoise Gatel et le rapporteur Philippe Latombe (Les Démocrates), est saluée par l’APVF, qui y voit un moyen de garantir une gouvernance locale stable et d’éviter des situations jugées délicates par certains acteurs territoriaux.
Cette adoption définitive marque une étape clé dans l’adaptation du droit local aux fusions communales et ouvre la voie à de futures évolutions pour répondre aux enjeux spécifiques des communes nouvelles.

Vidéoprotection algorithmique : après un "bilan contrasté", le gouvernement souhaite prolonger l'expérimentation
Par Frédéric Fortin, pour Localtis *** CET ARTICLE EST EN PARTENARIAT AVEC NOTRE PARTENAIRE LOCALTIS / BANQUE DES TERRITOIRES *** Enfin publié, le rapport d’évaluation de l’expérimentation de la “vidéoprotection algorithmique” plaide en creux pour remettre le métier sur l’ouvrage. Le document fait état d’un “bilan contrasté”, qui tient notamment aux conditions d’expérimentation du dispositif. …
*** CET ARTICLE EST EN PARTENARIAT AVEC NOTRE PARTENAIRE LOCALTIS / BANQUE DES TERRITOIRES ***
Le rapport tant attendu du comité d’évaluation de l’expérimentation de traitements algorithmiques d’images de vidéoprotection – conduite par la préfecture de police de Paris, la SNCF, la RATP et la ville de Cannes – a enfin été publié, ce 7 février, par le ministère de l’Intérieur. Ses principales conclusions ont déjà été largement dévoilées (voir notre article du 20 janvier). Elles font état d’un "bilan contrasté" sur le plan opérationnel, que l’on pourrait toutefois qualifier d’encourageant.
Un intérêt limité, mais à relativiser
Certes, le rapport fait à ce stade état d’un "intérêt opérationnel limité" du dispositif, pointant des "performances techniques inégales, très variables en fonction des opérateurs et des cas d’usage" (eux-mêmes limités par les textes). Si les rapporteurs ont observé des "performances globalement satisfaisantes pour l’intrusion, la circulation et la densité des personnes", ils font état de "résultats encore incertains et à améliorer pour les mouvements de foule" et déplorent "des performances inégales pour la détection d’objets abandonnés et d’armes à feu". Des performances qui fluctuent également en fonction "des contextes d’utilisation, des caractéristiques techniques et du positionnement des caméras".
Trop tôt, trop restreint, trop court
Reste que le constat est à relativiser. D’abord parce que l’évaluation a été conduite dans un "calendrier contraint" qui n’a, notamment, "laissé en pratique que quatre mois environ aux opérateurs pour effectuer de premiers tests destinés à calibrer le dispositif". Or "l’intérêt opérationnel dépend de la durée d’entrainement de la caméra", est-il souligné.
Des conditions qui ont, par exemple, conduit la préfecture de police à faire le choix d’un déploiement "assez limité du traitement [pendant les JO], par manque de moyens et d’expérience pour en assurer une mise en œuvre plus étendue". Sans compter un encadrement par le droit très "étroit", "progressivement resserré à chaque stade de l’élaboration du disposition", ou encore des "contraintes techniques encore renforcées", notamment au stade de la procédure d’appels d’offres, qui "ont limité la portée de l’expérimentation". Ainsi n’ont été retenus que deux prestataires, dont l’un n’a "pu être évalué que par la seule commune de Cannes, la seule collectivité qui a choisi de mettre en œuvre l’expérimentation".
Le tout "sur une période relativement brève" – de neuf mois environ. Or, relève le rapport, l’intérêt est "subordonné à la mise en œuvre du traitement pendant une durée suffisamment longue", qui permet notamment aux agents de s’approprier l’outil. Au total, le dispositif n’aura ainsi été testé que sur une trentaine d’événements, dans environ 70 lieux différents.
Des Jeux olympiques finalement peu propices
En outre, le choix de profiter des Jeux olympiques et paralympiques pour conduire cette expérimentation s’est avéré peu pertinent. "Les utilisateurs qui voulaient justement réduire les risques au maximum ont misé d’abord sur la densité des effectifs sur le territoire plutôt que sur une expérimentation qui, en tant que telle, comprenait une part d’incertitude". Cette "présence humaine exceptionnelle" sur le terrain a ainsi "rendu moins prioritaire la mise en place" du dispositif. Or le comité souligne que l’intérêt du dispositif "dépend de l’aptitude à mobiliser des effectifs suffisants pour traiter et exploiter les alertes déclenchées". Les auteurs du rapport déplorent ainsi que les moyens mis en œuvre n’aient que rarement permis de confronter les détections des algorithmes avec ceux des opérateurs humains. En outre, "cette présence humaine garantissait à elle seule des capacités de détection hors normes". Et de conclure que, "de façon générale, [l’intérêt du dispositif] est plus marqué lorsque la présence policière est insuffisante pour couvrir toute la zone considérée mais néanmoins suffisante pour permettre une intervention utile".
Mais un intérêt "réel", des agents "globalement satisfaits" et des libertés publiques préservées
Pour autant, le rapport met en avant un intérêt "réel" du dispositif, notamment "en ce qu’il a pu permettre à certains opérateurs vidéo de se concentrer sur ce qui pouvait être des situations à risque et de procéder à une meilleure répartition des agents présents sur le terrain". Et d’ajouter : "Et surtout, il comporte des potentialités". En dépit des faiblesses relevées, les agents concernés se font d’ailleurs plutôt positifs, le rapport évoquant "un degré d’attente et de confiance des personnels globalement élevé". Il observe que ceux de la RATP et de la SNCF "se sont, presque tous, déclarés favorables à son déploiement pérenne. Il a en été de même, dans une moindre mesure, des agents de la préfecture de police et de la commune de Cannes". Si ces derniers avaient dans un premier temps pu être rebutés par de premiers tests peu concluants, le rapport note que "leur regard a évolué de façon plus positive au fur et à mesure de l’expérimentation, du fait des progrès réalisés (…)".
Autre point positif, alors que les craintes et les oppositions étaient grandes, le rapport fait état d’un dispositif qui, "en l’état, ne heurte les libertés publiques ni dans sa conception ni dans sa mise en œuvre". Les auteurs s’interrogent toutefois sur les "très faibles remontées du public", ce qui pourrait traduire une information et/ou une compréhension insuffisantes.
Expérimentation prolongée ?
In fine, le rapport conclut que la présente expérimentation – laquelle, pour mémoire, ne prendra fin que le 31 mars prochain – "ne permet en aucun cas de se prononcer de façon générale sur la pertinence du recours à l’IA en matière de vidéoprotection". Un message semble-t-il entendu par le gouvernement, qui vient de déposer un amendement(Lien sortant, nouvelle fenêtre) à la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. "Les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF relèvent qu’ils n’ont pu bénéficier des systèmes de traitement algorithmique qu’à compter du printemps 2024 et n’ont pas pu faire suffisamment évoluer leur organisation pour optimiser les remontées opérationnelles des alertes", argue le gouvernement. Les partisans d’une généralisation sans délai de la solution devront donc sans doute prendre encore leur mal en patience (voir notre article du 4 octobre).
*** CET ARTICLE EST EN PARTENARIAT AVEC NOTRE PARTENAIRE LOCALTIS / BANQUE DES TERRITOIRES ***

Polices municipales : l'APVF auditionnée par la commission des lois du Sénat
Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François et référent sécurité de l’APVF a été auditionné par la commission des lois du Sénat au sujet des polices municipales. M. Bouquet a rappelé qu’il était essentiel de définir enfin les missions qui doivent échoir aux policiers municipaux. M. Jean-Pierre Bouquet, référent sécurité de l’APVF s’exprimait devant la Commission des …
Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François et référent sécurité de l'APVF a été auditionné par la commission des lois du Sénat au sujet des polices municipales. M. Bouquet a rappelé qu'il était essentiel de définir enfin les missions qui doivent échoir aux policiers municipaux.
M. Jean-Pierre Bouquet, référent sécurité de l'APVF s'exprimait devant la Commission des Lois du Sénat dans le cadre de la mission d'information sur les polices municipales, dont la rapporteure est Jacqueline Eustache-Brinio. Cet article synthétise la prise de parole de M. Bouquet et présente les grands enjeux pour les maires des petites villes selon l'APVF.
L'APVF considère en effet que l'Etat est en difficulté pour procéder à des implantations police/gendarmerie en fonction de la démographie et de la délinquance. Question de l’allocation des moyens publics et des effectifs. Se pose ainsi la question de l'efficacité des forces de sécurité intérieure, qui englobent la police nationale et la gendarmerie. Face à cette difficile allocation des forces, qui n'ont retrouvé leurs effectifs d'avant la Révision Générale de Politique Publique (2007) que récemment, ce sont les polices municipales qui ont pris le relai sur la voie publique. On assiste donc à un phénomène de substitution.
Pour l'APVF, avant de s'interroger sur le rôle des polices municipales, il faut poser la question de la doctrine des forces de sécurité intérieure. En effet, depuis la fin de la police de proximité, les missions de la police sont des missions d'intervention, après que les délits aient lieu. Le volet préventif n'existe plus en tant que tel au niveau national.
Cette situation, tant au niveau des effectifs que des missions des forces de sécurité intérieure, couplé à l'absence de cadre légal explique la grande diversité des polices municipales.
Cette diversité s'exprime d'abord dans le nombre de policiers municipaux engagés. Les effectifs dans les petites villes se situent entre 1 et 5 agents ; on compte 4,5 policiers pour 10 000 habitants en moyenne selon le ministère de l'Intérieur, les petites villes participent donc pleinement de l'effort de sécurité.
On constate également une diversité des missions attribuées au polices municipales. Depuis 1999, on observe régulièrement un accroissement des pouvoirs des polices municipales. Par la voie de l'expérimentation, certaines polices municipales disposent de pouvoirs judiciaires élargis. Il s'agit là d'un engrenage où les coûts supportés pour la sécurité sont transférés aux communes alors que le pouvoir décisionnaire serait transféré à l'Etat, et plus précisément au parquet.
L'APVF s'oppose fermement à l'annexion des polices municipales et c'est la raison pour laquelle elle demande que soient rappelées leur missions premières : proximité et tranquillité. L'APVF n'accepte pas que des policiers municipaux soient placés sous le contrôle du parquet alors que ces agents sont financés par les collectivités locales. Il s'agit d'une question de séparation des pouvoirs, comme l'a déjà souligné le Conseil constitutionnel. Il s'agit donc d'une question d’état de droit.
L'APVF demande donc que soit défini un cadre des missions des polices municipales. Elle plaide ensuite pour que les maires puissent définir la doctrine d'emploi dans le cadre de la libre administration. L'APVF met en avant un principe de clarté et de responsabilité.

Programmation pluriannuelle de l'énergie
Cet article a été repris en intégralité du site de Localtis, partenaire de l’APVF. Conditions concrètes de sortie du pétrole ou du charbon, budget suffisant pour le fonds Chaleur, le fonds vert et MaPrimeRénov’, encouragement aux mobilités propres… : le Haut Conseil pour le climat (HCC) a livré ce 31 janvier ses recommandations au gouvernement …
Cet article a été repris en intégralité du site de Localtis, partenaire de l'APVF.
Conditions concrètes de sortie du pétrole ou du charbon, budget suffisant pour le fonds Chaleur, le fonds vert et MaPrimeRénov', encouragement aux mobilités propres... : le Haut Conseil pour le climat (HCC) a livré ce 31 janvier ses recommandations au gouvernement sur les points à muscler pour la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) mise en consultation publique en novembre dernier.
Après s’être autosaisi, le Haut Conseil pour le climat (HCC) a publié ce 31 janvier son avis(Lien sortant, nouvelle fenêtre) sur le projet de troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3). Soumise à consultation publique par le gouvernement en novembre dernier (lire notre article), la nouvelle PPE fixe des objectifs en matière de production et de consommation d'énergie pour la période 2025-2035. Dans son avis, l'organisme indépendant "alerte sur les leviers d'action indispensables qui ne semblent pas encore pleinement mobilisés". "Nous définissons six conditions de réussite pour la décarbonation du système énergétique et pour sa résilience au changement climatique", a détaillé son président, Jean-François Soussana, devant des journalistes.
L'avis égrène des propositions pour favoriser les mobilités propres, garantir les investissements, assurer l'accessibilité de la transition et la résilience au changement climatique ou renforcer la gouvernance de cette feuille de route. Les experts attendent aussi des précisions sur les chemins pour sortir concrètement à terme du charbon, du pétrole et du gaz fossile.
"Stress tests" pour éviter le recours à des sources d'électricité provenant d'énergies fossiles
Ils recommandent ainsi d’effectuer "des stress tests afin de disposer de plans de contingence en cas d’aléas touchant la production nucléaire (non-conformité de la sécurité) ou renouvelable (aléas climatiques) afin d’éviter de recourir à des sources d’électricité (nationales ou importées) provenant d’énergies fossiles". En complément du vecteur électrique, ils appellent à accélérer le Plan solaire thermique, la géothermie et les réseaux (chaleur, froid et gaz renouvelables, récupération de chaleur fatale) et à "adopter rapidement une Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB) qui intègre dans ses objectifs et leviers, la restauration des puits de carbone des forêts et des sols (…), la protection et la restauration de la biodiversité - compatible notamment avec la Stratégie nationale biodiversité (SNB) et le règlement européen sur la restauration de la nature."
Stabiliser les aides et "garantir des budgets suffisants et pérennes"
La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé ce 28 janvier la publication de la nouvelle PPE "au début du deuxième trimestre" (lire notre article). Cette "stratégie visera, d'ici 2035, à réduire d'un tiers notre dépendance aux énergies fossiles au bénéfice du nucléaire, des énergies renouvelables", a-t-elle vanté. Mais le HCC, constitué de scientifiques, multiplie les recommandations et mises en garde au gouvernement. À l'heure des coups de rabot budgétaires, il appelle à "mettre fin à l’instabilité des aides et des dispositifs" et réclame en particulier de "garantir des budgets suffisants et pérennes pour les mesures de transition", par exemple les "fonds Chaleur, fonds vert, MaPrimeRénov'". De manière générale, il insiste sur la nécessité de "s’assurer de la capacité des collectivités, administrations et opérateurs de l'État à mener la transition, en les préservant de plafonds d’emploi trop bas et de baisses de crédits trop fortes."
Revoir les "signaux prix"
Il préconise également de "supprimer rapidement les subventions aux énergies fossiles", de "revoir les signaux prix (accises, tarification, taxation) afin d’encourager l’utilisation des énergies bas carbone par rapport au gaz naturel et au fioul" et de "développer les outils économiques favorisant la sobriété (tels que le principe de tarification progressive)".
Les experts relèvent également des lacunes dans le volet consacré aux transports. Ils préconisent d'y "réintégrer le secteur aérien", tout en "développant une stratégie de mobilité longue distance et y intégrer le secteur maritime". Ils veulent aussi que soit rendu "effectif" l'arrêt des investissements dans les nouvelles infrastructures routières et aéroportuaires.
Ciblage des aides pour les ménages vulnérables
Le HCC préconise également d’"améliorer le ciblage des aides pour lutter contre la précarité énergétique et la précarité de l’accès à une mobilité décarbonée, en les mettant rapidement en œuvre". Dans la perspective de l’extension du système d’échange de quotas d’émissions de l’UE aux secteurs du transport et du logement, il faudrait ainsi "financer une sortie rapide du chauffage au fioul et au gaz des ménages vulnérables et renforcer les aides pour la rénovation énergétique sous plafond de revenu, ainsi que celles pour les transports décarbonés", souligne-t-il.
Retrouver cet article sur le site de Localtis

L'initiative #DesPagesJaunesEtBleues avec Edward Mayor, Président de Stand With Urkaine
Trois ans après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la lettre des petites villes ouvre ses colonnes à Edward Mayor, Président de Stand With Ukraine pour présenter l’initiative #DesPagesJaunesEtBleues Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022, Poutine nie l’existence même de l’Ukraine, de son identité, de sa culture. Pourtant, …
Trois ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la lettre des petites villes ouvre ses colonnes à Edward Mayor, Président de Stand With Ukraine pour présenter l'initiative #DesPagesJaunesEtBleues
Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022, Poutine nie l’existence même de l’Ukraine, de son identité, de sa culture. Pourtant, le peuple ukrainien continue à démontrer une résilience extraordinaire, où la culture occupe une place centrale dans sa résistance face à l’agression russe.
Le 24 février 2025 marquera le troisième anniversaire tragique du début de cette invasion. À l’approche de cette date, association Stand With Ukraine, en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF) et l’Ambassade d’Ukraine en France, propose aux villes françaises de témoigner leur solidarité avec l'Ukraine en intégrant dans leurs bibliothèques municipales une sélection d’ouvrages ukrainiens traduits en français.
Cette initiative, intitulée #DesPagesJaunesEtBleues, vise à célébrer la résistance culturelle ukrainienne, tout en permettant au public français de découvrir les chefs-d'œuvre classiques et contemporains de la littérature ukrainienne en les rendant accessibles dans les bibliothèques municipales partout en France.
Chaque ville et commune française peut contribuer à cette résistance culturelle en enrichissant ses bibliothèques d’ouvrages d’auteurs ukrainiens majeurs tels que Taras Shevchenko et Lessia Oukraïnka. Mais aussi de livres sur l’histoire de l’Ukraine, sa culture et son identité, permettant de comprendre les racines profondes de la nation et les défis auxquels elle est confrontée. Parmi les auteurs contemporains ukrainiens déjà considérés comme des classiques, citons Andriy Kourkov, Serhiy Zhadan, Lina Kostenko, la poétesse Liubov Yakymchuk, ainsi que Viktoria Amelina, écrivaine tuée lors d’une attaque russe à Kramatorsk en 2023.
Stand With Ukraine, avec l’expertise d’Iryna Dmytrychyn, historienne, traductrice et maître de conférences à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), où elle enseigne la littérature et la civilisation ukrainiennes, ont constitué une sélection d’une trentaine d’œuvres majeures de la littérature ukrainienne traduites en français. Ce choix met en avant des écrivains essentiels qui témoignent de la richesse culturelle et de l’histoire de l’Ukraine. Parmi eux figurent à la fois des classiques incontournables et des auteurs contemporains dont les récits explorent les réalités sociales et politiques du pays.
Cette sélection propose une diversité de genres allant de la poésie engagée au roman moderne, en passant par le théâtre, les récits historiques et les livres pour enfants. Elle permet aux lecteurs français de découvrir des voix littéraires puissantes et authentiques, qui portent les mémoires, les luttes et les espoirs de l’Ukraine.
En célébrant ces voix littéraires, nous réafifrmons que l’Ukraine existe, résiste, et que sa culture ne s’effacera jamais.
Ce projet, s’inscrit dans le cadre de l’initiative #MistoMatch, portée par Stand With Ukraine. Cette initiative a pour objectif de créer des liens solides et durables entre les villes françaises et ukrainiennes, tout en renforçant la solidarité culturelle et humaine entre la France et l’Ukraine.
Suivre ce lien pour participer à la campagne #DesPagesJaunesEtBleues
Suivre ce lien pour le site Stand With Ukraine

L’hôpital public en péril : une commission d’enquête pour rétablir l’accès aux soins
Le groupe LIOT de l’Assemblée nationale active son droit de tirage annuel pour instaurer une commission d’enquête sur les difficultés d’accès aux soins dans l’hôpital public. Face à la fermeture de lits, à la disparition de certains services et à la fuite des personnels, l’objectif est de comprendre et d’inverser la dégradation d’un service essentiel, …
Le groupe LIOT de l’Assemblée nationale active son droit de tirage annuel pour instaurer une commission d’enquête sur les difficultés d’accès aux soins dans l’hôpital public. Face à la fermeture de lits, à la disparition de certains services et à la fuite des personnels, l’objectif est de comprendre et d’inverser la dégradation d’un service essentiel, particulièrement vital dans nos petites villes.
La situation de l’hôpital public connaît une dégradation alarmante, surtout dans nos petites villes où l’accès aux soins devient un véritable défi. Dans ce contexte, le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) a décidé d’exercer son droit de tirage annuel pour demander la création d’une commission d’enquête. Lors de son intervention devant la commission des affaires sociales, le député Christophe Naegelen a dressé un constat sans concession : « La déliquescence de notre service public hospitalier se traduit par la fermeture de lits, la disparition de services essentiels – notamment en maternité – et l’exode massif des personnels soignants et médicaux. »
Selon lui, malgré un sursaut constaté durant la crise sanitaire, la situation se dégrade inexorablement. L’augmentation de l’absentéisme, le recours excessif à l’intérim et le délabrement des infrastructures hospitalières témoignent d’un effritement du système. Ce phénomène impacte fortement les territoires ruraux et périurbains, exacerbant le problème des déserts médicaux : les habitants, souvent isolés, doivent parcourir de longues distances pour accéder à des soins de qualité.
La commission d’enquête, qui regroupera trente députés représentatifs des divers groupes parlementaires, aura six mois pour mener ses investigations. Parmi les axes d’analyse, il s’agira notamment de mettre en lumière le manque de moyens, les investissements insuffisants et les décisions administratives ou politiques qui auraient contribué à ce délitement. Une comparaison avec le secteur privé viendra compléter cette analyse afin d’identifier des pistes concrètes de redressement.
Les préoccupations sont multiples et partagées par d’autres parlementaires. Le député Jérôme Guedj (Socialistes) insiste d’ailleurs sur la désertification médicale dans les territoires ruraux.
Pour nos petites villes, où l’hôpital public constitue souvent le seul point d’accès aux soins, cette commission d’enquête représente une opportunité cruciale. Il s’agit de faire émerger des solutions concrètes afin de redonner à notre système de santé la qualité et la proximité indispensables pour lutter efficacement contre la désertification médicale et garantir un accès aux soins équitable pour tous.
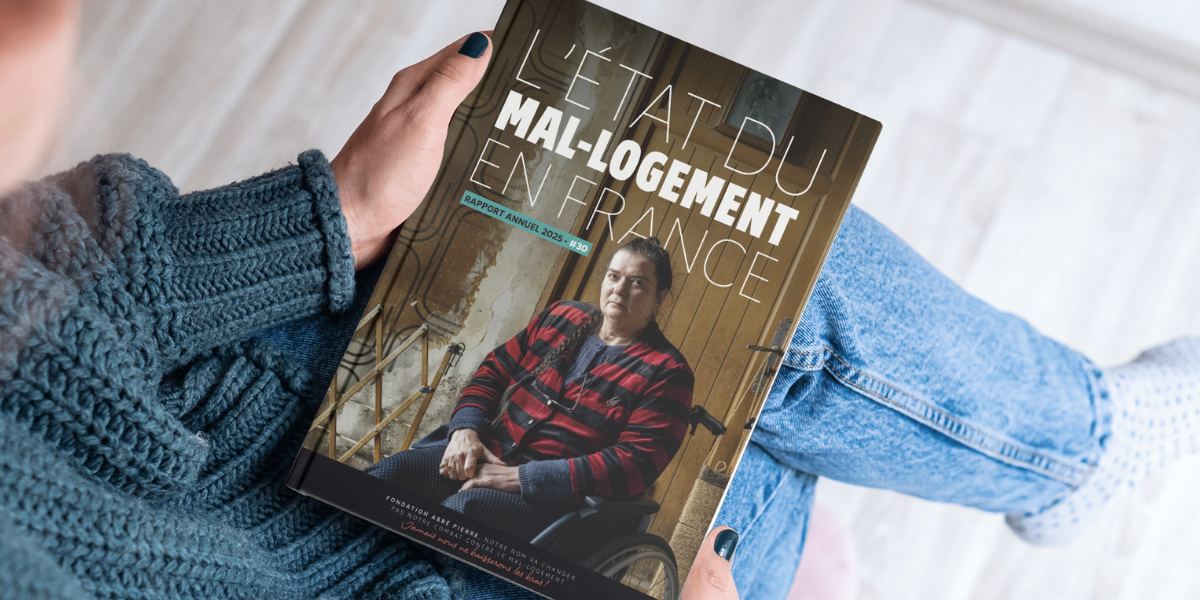
Mal-logement en France : un état des lieux préoccupant
Le 30e rapport de la Fondation pour le Logement (ex-Fondation Abbé Pierre), publié ce mardi 4 février 2025, met en lumière l’ampleur du mal-logement en France. Si les grandes agglomérations concentrent une partie des difficultés, les petites villes sont également confrontées à des défis spécifiques en matière d’accès et de qualité du logement. Une crise …
Le 30e rapport de la Fondation pour le Logement (ex-Fondation Abbé Pierre), publié ce mardi 4 février 2025, met en lumière l’ampleur du mal-logement en France. Si les grandes agglomérations concentrent une partie des difficultés, les petites villes sont également confrontées à des défis spécifiques en matière d’accès et de qualité du logement.
Une crise qui touche aussi les territoires intermédiaires
Dans un contexte de crise de la construction immobilière, le mal-logement continue de s'aggraver en France, avec une hausse du nombre de personnes sans domicile, passé de 143 000 en 2012 à 350 000 en 2024 (Rapport sur l’État du Mal-Logement, Fondation pour le Logement). Parallèlement, le nombre de demandeurs de logements sociaux continue de croître, dépassant en 2024 les 2,7 millions de ménages.
Dans les petites villes, l’accès au logement social peut s’avérer complexe en raison de la faible rotation dans le parc existant et de la baisse de la construction de nouveaux logements sociaux (à peine 84 000 en 2024 contre 124 000 en 2016). Si cette baisse de la construction s'explique en partie par le contexte inflationniste de l’économie française, certaines nouvelles règles, comme le dispositif de Zéro Artificialisation nette (ZAN), peuvent freiner le volontarisme des communes.
La précarité énergétique s’accentue également, touchant 30 % des ménages en 2024 contre 14 % en 2020. Dans les communes de taille intermédiaire, de nombreux logements anciens, mal isolés, exposent encore davantage leurs habitants aux vagues de froid et de chaleur.
Handicap et logement : un enjeu à prendre en compte
Le rapport 2025 de la Fondation met la focale sur la situation des personnes en situation de handicap. L’inadaptation des logements constitue un frein majeur à leur autonomie et à leur inclusion. Selon le rapport, environ 5 % des ménages vivent dans des logements inadaptés, soit plus de 220 000 foyers concernés. Dans les petites villes, l’absence parfois d’une offre diversifiée en logements accessibles et adaptés oblige de nombreuses personnes en situation de handicap à rester chez leurs proches ou à s’éloigner vers des centres spécialisés situés en dehors de leur bassin de vie.
Le mal-logement ne se limite pas aux métropoles et touche tout le territoire, y compris les petites villes. Le cœur de ce 30e rapport de la Fondation insiste sur le besoin d’adapter l’offre de logements aux réalités locales, en favorisant la rénovation énergétique tout en développant des logements accessibles.
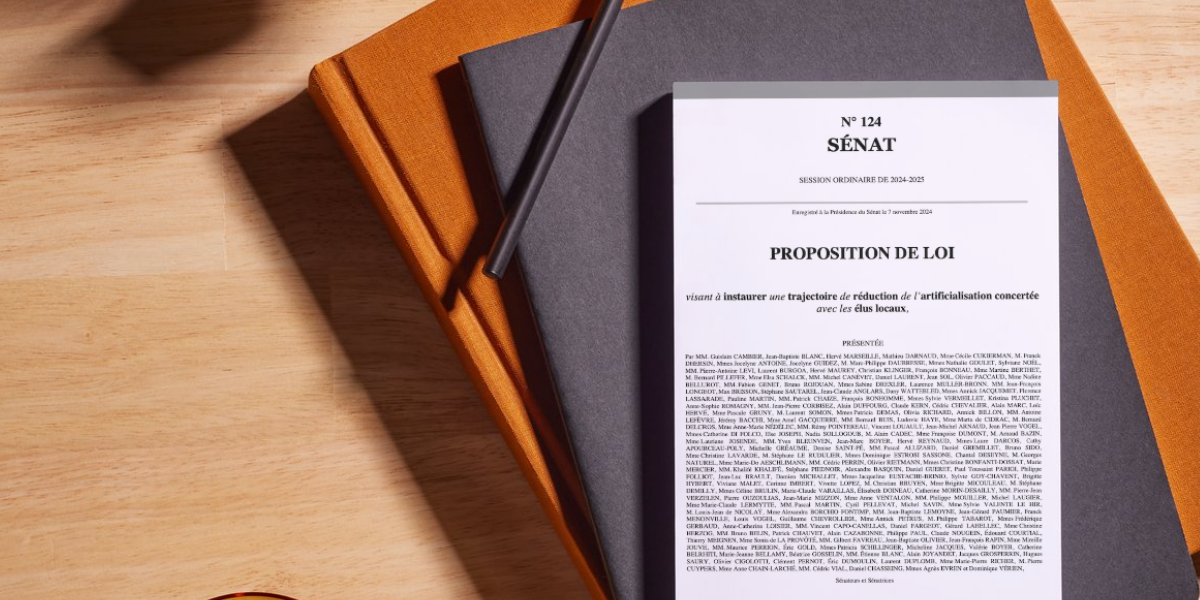
Entre ZAN et TRACE : l’artificialisation des sols de nouveau en question au Sénat
La proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation, concertée avec les élus (TRACE), sera examinée au Sénat les 12, 13 et 18 mars prochains. Portée par les sénateurs Jean-Baptiste Blanc (LR, Vaucluse) et Guislain Cambier (UC, Nord), elle a pour objectif d’assouplir la mise en œuvre du dispositif ZAN (Zéro …
La proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation, concertée avec les élus (TRACE), sera examinée au Sénat les 12, 13 et 18 mars prochains. Portée par les sénateurs Jean-Baptiste Blanc (LR, Vaucluse) et Guislain Cambier (UC, Nord), elle a pour objectif d’assouplir la mise en œuvre du dispositif ZAN (Zéro Artificialisation Nette) issu de la loi Climat et Résilience. La position de l’Association des Petites Villes de France, recueillie par le biais d’un questionnaire, a été prise en compte par les rapporteurs des commissions des affaires économiques et de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Un constat unanime : une application difficile du ZAN
Adoptée en 2021, la loi Climat et Résilience impose une réduction progressive de l’artificialisation des sols afin d’atteindre l’objectif de Zéro Artificialisation Nette d’ici 2050. Toutefois, de nombreux élus locaux ont alerté sur les difficultés d’application de cette mesure, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Le Président de l’APVF et Maire de Barentin (76), Christophe Bouillon, soulignait dès 2023 les nombreux obstacles à la réussite du ZAN, citant notamment « les contraintes techniques et réglementaires, le manque de financements et le besoin d’ingénierie ».
L’APVF : le relais des inquiétudes des maires des petites villes
Face à ces défis, l’APVF a très tôt relayé les inquiétudes des maires des petites villes et cherché à influer sur l’action gouvernementale, notamment par la voix de son Président et à travers la formulation de 15 propositions pour réussir ce dispositif. Celles-ci s’articulent autour de trois priorités : clarifier la mise en œuvre du ZAN en instaurant un véritable dialogue entre l’État et les collectivités, adapter ses objectifs aux réalités locales afin de ne pas freiner les projets structurants des petites villes, et renforcer les moyens financiers et techniques pour accompagner les communes dans la transition. Loin de remettre en cause l’ambition écologique du dispositif, l’APVF plaide pour une application pragmatique et équitable qui permette aux petites villes de concilier sobriété foncière et développement territorial.
Des ajustements souhaités pour une "trajectoire réaliste"
Le texte TRACE, en débat au Sénat en mars, propose plusieurs ajustements :
- Une simplification des modalités de comptabilisation de l’artificialisation des sols.
- Un assouplissement de la trajectoire de réduction entre 2021 et 2031, sans remettre en cause l’objectif final de 2050.
- Une territorialisation des objectifs en fonction des besoins et des projets des collectivités locales.
- La mutualisation de l’hectare communal à l’échelle des intercommunalités (EPCI) et des schémas de cohérence territoriale (SCoT).
- Une flexibilisation du cadre réglementaire, notamment en permettant aux Conférences régionales de gouvernance de s’affranchir du caractère prescriptif des schémas régionaux d’aménagement (Sraddet).
Un équilibre entre préservation des sols et développement territorial
Si la proposition de loi vise à introduire davantage de pragmatisme, le gouvernement rappelle que l’objectif de réduction de l’artificialisation doit rester prioritaire. Le ministre de l’Aménagement du territoire, François Rebsamen, a ainsi proposé de repousser de 2031 à 2034 le point d'étape intermédiaire afin de mieux évaluer les effets des mesures engagées.
La consommation des espaces artificialisés demeure un enjeu majeur : en moyenne, 20 000 hectares sont urbanisés chaque année, dont 66 % pour l’habitat, 24 % pour l’activité économique et 5 % pour les infrastructures routières. La concentration de cette consommation dans certaines communes en déclin démographique illustre la nécessité d’une meilleure planification et adaptation des politiques d’aménagement.
L’examen de cette proposition de loi au Sénat sera donc un moment clé pour l’avenir du ZAN. Il s’agira de trouver un équilibre entre la préservation des sols et le développement local, afin d’accompagner les collectivités vers une transition plus soutenable et réaliste.
