ESPACE MEMBRE

Rencontre Territoriale des Maires des petites villes de la région Hauts de France
L’Association des Petites Villes de France (APVF), présidée par Christophe Bouillon, maire de Barentin, organise le 11 décembre 2025 les Rencontres territoriales des maires des petites villes de la région Hauts-de-France, en partenariat avec La Banque Postale. Accueillie à l’Hôtel de Ville de Lille, cette rencontre régionale sera placée sous le thème :« Budgets communaux …
L’Association des Petites Villes de France (APVF), présidée par Christophe Bouillon, maire de Barentin, organise le 11 décembre 2025 les Rencontres territoriales des maires des petites villes de la région Hauts-de-France, en partenariat avec La Banque Postale.
Accueillie à l’Hôtel de Ville de Lille, cette rencontre régionale sera placée sous le thème :
« Budgets communaux : faire face aux chocs et préparer l’avenir ».
Cette matinée d’échanges sera consacrée à l’analyse des principales mesures du projet de loi de finances pour 2026, à leurs impacts pour les petites villes et aux stratégies locales permettant de consolider la trajectoire financière des communes.
Inscription à l'événement (attention places limitées)
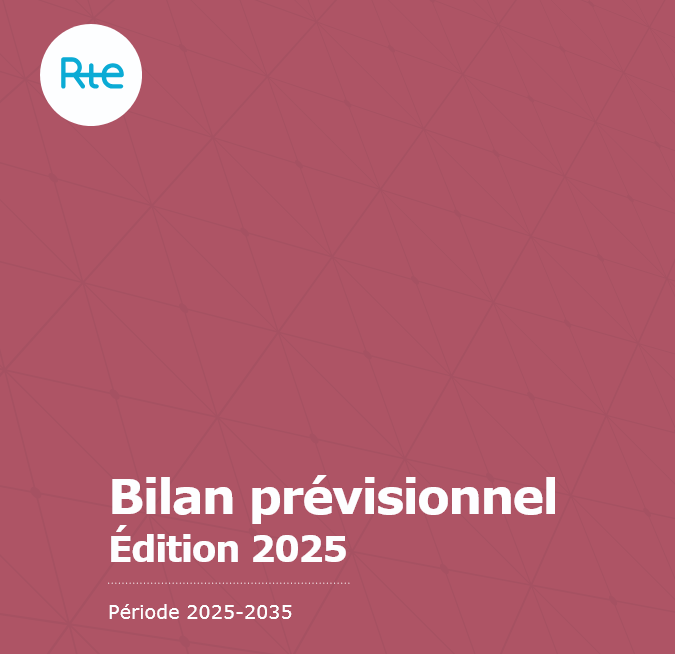
Bilan 2025-2035 de RTE : la France au défi de l'électrification
Le Bilan prévisionnel 2025 de RTE analyse l’évolution du système électrique français jusqu’en 2035 et met en évidence une situation atypique : une abondance d’électricité bas-carbone, issue de la bonne disponibilité du parc nucléaire, du retour à des niveaux normaux de l’hydraulique et de la croissance des énergies renouvelables, alors que la demande progresse trop …
Le Bilan prévisionnel 2025 de RTE analyse l’évolution du système électrique français jusqu’en 2035 et met en évidence une situation atypique : une abondance d’électricité bas-carbone, issue de la bonne disponibilité du parc nucléaire, du retour à des niveaux normaux de l’hydraulique et de la croissance des énergies renouvelables, alors que la demande progresse trop lentement.
Cette combinaison crée une surcapacité temporaire qui pourrait devenir un atout, mais qui risque d’être durable si l’électrification ne s’accélère pas.
RTE note que la consommation reste inférieure aux niveaux d’avant la crise sanitaire. Les économies d’énergie, la sobriété induite par la crise de 2022 et un niveau d’activité industrielle hétérogène expliquent cette hausse limitée. La faiblesse de la demande contraste avec une production robuste, ce qui conduit le rapport à souligner que l’électrification des usages avance aujourd’hui trop lentement pour absorber pleinement l’offre bas-carbone et pour aligner le pays sur ses objectifs climatiques.
La France dans une position avantageuse pour s'électrifier
Le document présente deux trajectoires principales. La première, dite de « décarbonation rapide », suppose une accélération marquée de l’électrification dans l’industrie, les bâtiments, le transport et l’hydrogène. Elle conduirait la demande autour de 510 TWh en 2030 et près de 580 TWh en 2035. Cette trajectoire est la seule compatible avec les ambitions climatiques, car elle maximise le remplacement des énergies fossiles. RTE souligne toutefois que le rythme d’électrification constaté actuellement est trop faible pour garantir l’atteinte d’un tel scénario sans mesures additionnelles.
La seconde trajectoire, de « décarbonation lente », prévoit une consommation plus modérée : environ 470 TWh en 2030 et légèrement plus de 500 TWh en 2035. Elle reflète un développement insuffisant des projets industriels électro-intensifs, un retard dans la production d’hydrogène bas-carbone et une progression plus faible dans les usages résidentiels et tertiaires. Selon RTE, suivre cette trajectoire compromettrait les objectifs climatiques nationaux et européens et laisserait persister une partie de la surcapacité actuelle.
Le rapport insiste sur les dynamiques sectorielles. L’industrie représente le principal potentiel de croissance, mais la concrétisation des projets reste lente. Les datacenters constituent un autre poste de consommation croissant, sans toutefois compenser le retard global des autres usages. Quant à l’hydrogène, son développement reste incertain, avec un écart notable entre les annonces et les projets prêts au raccordement.
L'enjeu de l'électrification des usages
Pour accompagner la transformation future, RTE prévoit une montée en puissance de ses investissements, sans chiffrage global de long terme dans ce bilan, mais en soulignant la nécessité d’adapter rapidement le réseau : modernisation d’infrastructures existantes, création de nouvelles liaisons, raccordement des énergies renouvelables — notamment l’éolien en mer — et renforcement des capacités d’accueil pour les grands projets industriels. Le rapport met en avant que ces évolutions sont indispensables pour soutenir une électrification accrue, et non l’inverse.
Le bilan mentionne également les besoins croissants en flexibilité, en stockage et en pilotage. La variabilité des renouvelables et la montée des usages industriels demandent de renforcer l’ensemble des mécanismes d’équilibrage. Le nucléaire reste déterminant pour sécuriser les pointes hivernales, mais son rôle doit s’articuler avec une montée en puissance des autres moyens pilotables et de la flexibilité.
Les risques identifiés incluent : une électrification qui demeurerait insuffisante, des retards de raccordement, la non-réalisation de projets industriels et une coordination imparfaite entre acteurs publics et privés. À l’inverse, une électrification réellement accélérée permettrait de transformer la surcapacité actuelle en un avantage compétitif et climatique.
En conclusion, le Bilan prévisionnel 2025 place la France devant une opportunité : disposer d’un excédent bas-carbone aujourd’hui. Mais cet excédent n’aura de valeur stratégique que si la dynamique d’électrification — actuellement jugée trop lente — s’intensifie rapidement.
RTE est partenaire de l'Association des Petites Villes de France.
Suivre ce lien pour accéder au résumé exécutif du Bilan prévisionnel 2025-2035 : La France est dans une position avantageuse pour s’électrifier et atteindre ses objectifs climatiques | RTE

Statut de l’élu : des avancées bienvenues, mais qui en appellent d'autres
La loi créant un statut de l’élu local a été définitivement adoptée à l’Assemblée nationale. Revalorisation des indemnités, protection renforcée, meilleure conciliation avec la vie professionnelle : le texte répond à plusieurs attentes anciennes des élus. Pour les maires des petites villes, toutefois, l’effort reste en deçà des responsabilités assumées au quotidien. L’Assemblée nationale a …
La loi créant un statut de l’élu local a été définitivement adoptée à l’Assemblée nationale. Revalorisation des indemnités, protection renforcée, meilleure conciliation avec la vie professionnelle : le texte répond à plusieurs attentes anciennes des élus. Pour les maires des petites villes, toutefois, l’effort reste en deçà des responsabilités assumées au quotidien.
L’Assemblée nationale a adopté le 8 décembre en seconde lecture, sans modification, la proposition de loi sur le statut de l’élu local. Le vote a été unanime, à l’exception des abstentions du groupe LFI. Après des mois de navettes parlementaires, marquées par les changements de gouvernement et les reports d’agenda, le texte arrive enfin au terme de son parcours. La publication est prévue d’ici la fin de l’année, à moins de quatre mois du scrutin municipal.
Le vote a été express : 18 amendements seulement étaient en discussion, tous retirés ou rejetés. Ce choix de la rapidité reflète un constat largement partagé : il était temps d’apporter des réponses aux élus locaux, dont près de 450 démissionnent chaque année, parfois épuisés par la pression, les violences ou l’impossibilité de concilier mandat, vie familiale et activité professionnelle.
Le texte comporte plusieurs avancées notables. Les indemnités des maires et adjoints des communes de moins de 20 000 habitants sont revalorisées, avec un dispositif dégressif favorable aux plus petites communes. Pour une ville de 2 000 habitants, l’indemnité maximale d’un maire sera fixée à 2 290 euros par mois. Trois trimestres supplémentaires de retraite pourront être validés sur un mandat, et les conditions d’exercice du mandat sont facilitées par le renforcement des autorisations d’absence, l’extension des remboursements de frais de garde ou la création d’un statut d’« élu étudiant ». La protection fonctionnelle devient automatique pour tout élu victime de menaces, d’outrages ou de violences dans l’exercice de ses fonctions. La sortie de mandat est également prise en compte, avec une amélioration de l’allocation de fin de mandat et l’instauration d’un contrat de sécurisation de l’engagement.
Plusieurs groupes parlementaires ont toutefois insisté sur la vigilance à porter aux décrets d’application. L’objectif affiché par le gouvernement est de publier l’ensemble des textes réglementaires avant les élections municipales, mais les délais seront serrés. Le financement des mesures suscite aussi des interrogations. La hausse de la dotation particulière élus locaux (DPEL), adoptée au Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, serait intégralement compensée par une réduction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. En revanche, l’indemnité annuelle de 500 euros versée à tous les maires au titre de leurs missions d’agents de l’État sera financée par l’État.
L’Association des Petites Villes de France se félicite de l’adoption du texte. Plusieurs de ses propositions de longue date ont été reprises, et l’urgence de moderniser les conditions d’exercice du mandat local est désormais reconnue. Mais pour les maires des petites villes, la revalorisation moyenne de 5 % des indemnités reste insuffisante. Les responsabilités assumées, le temps consacré au mandat et les sacrifices personnels qu’il implique ne sont pas pleinement compensés. Lorsque les conditions budgétaires le permettront, il faudra aller plus loin sur cette question, encore trop souvent considérée comme taboue.

3 questions à Didier Béé, Président de la Mutuelle nationale territoriale (MNT)
Alors que la proposition de loi sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents territoriaux doit être examinée le 11 décembre en séance publique à l’Assemblée nationale, Didier Bée, Président de la Mutuelle nationale territoriale (MNT) répond à nos questions. 1) Comment la MNT s’est-elle adaptée aux nouvelles exigences légales ? Comment les différentes transformations …
Alors que la proposition de loi sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents territoriaux doit être examinée le 11 décembre en séance publique à l’Assemblée nationale, Didier Bée, Président de la Mutuelle nationale territoriale (MNT) répond à nos questions.
1) Comment la MNT s’est-elle adaptée aux nouvelles exigences légales ? Comment les différentes transformations ont-elles été perçues par les agents ?
Dès le 1er janvier 2025, nous nous sommes mis en conformité avec le décret du 20 avril 2022 pour la prévoyance (participation employeur de 7 euros minimum par agent et par mois pour un panier à deux garanties qui est assez onéreux). Ce texte ne satisfait personne dans un marché où encore aujourd’hui c’est l’individuel qui est majoritaire. Dans cette situation, nous estimons que ce sont des dizaines de milliers d’agents qui ont décidé de quitter leur contrat prévoyance en 2025 préférant attendre que l’obligation de participation telle que définie dans l’Accord collectif national (ACN) du 11 juillet 2023 soit mise en œuvre et donc autant d’agents qui n’ont pas de couverture prévoyance, en contradiction avec la loi de février 2021 et l’’ACN.
2) La proposition de loi sur la PSC de retranscription de l’Accord du 11 juillet 2023 a été votée au Sénat et est actuellement examinée à l’Assemblée. Quelles sont vos attentes ?
Ce texte qui transpose l’Accord en prévoyance est une étape cruciale pour les agents : à partir du 1er janvier 2029, les collectivités territoriales auront l’obligation de prendre en charge au moins 50 % de la cotisation de prévoyance — couvrant deux garanties minimales : l’incapacité et l’invalidité — dans le cadre de contrats collectifs à adhésion obligatoire.
C’est une ambition forte que nous avons défendue depuis près de dix ans : bâtir une prévoyance universelle pour les 2 millions d’agents de la fonction publique territoriale. La MNT a défendu cette proposition de loi avec détermination, aux côtés de ses partenaires mutualistes, car elle reflète ce qui guide notre action depuis toujours : garantir une protection sociale équitable, solidaire et accessible à tous les agents territoriaux.
Nous sommes donc pleinement engagés pour que la proposition de loi soit votée conforme le 11 décembre prochain à l’Assemblée nationale. Il y a urgence. (interview réalisée fin novembre).
3) Vous évoquiez à propos de l’Accord, un certain nombre de sujets non traités ou insuffisamment explicités, mais indispensables à sa mise en œuvre. Ces éléments sont-ils clarifiés par la proposition de loi ?
Quelques inquiétudes demeurent en effet, en particulier concernant l’article 4, portant sur la succession des contrats et la question du maintien de salaire des agents, même si la loi Evin encadre déjà assez clairement ces situations, et s’il existe de la jurisprudence sur ce sujet. En effet, pour prévenir certains comportements déloyaux d’opérateurs, nous souhaitons que les cas particuliers soient mieux pris en compte, car derrière les successions de contrats, il y a des situations humaines souvent dramatiques. C’est pourquoi il est essentiel d’agir en amont pour prévenir la multiplication de ces contentieux et les ruptures d’indemnisation qui malheureusement les accompagnent.
Par ailleurs, nous insistons sur un point crucial : sans soutien spécifique aux petites collectivités, la réforme pourrait renforcer les inégalités d’accès à la prévoyance. C’est pourquoi nous plaidons depuis 2023 pour la création d’un fonds de soutien aux petites collectivités, pour les accompagner durablement dans la prise en charge de la PSC de leurs agents.

Roquelaure de la simplification : encore loin de la coupe aux lèvres
Mardi 5 décembre se tenait la deuxième édition du Roquelaure de la simplification, initiée par le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation. L’APVF était représentée par Antoine Homé, Premier Vice-président de l’APVF et Maire de Wittenheim. À l’issue de cette réunion, la ministre Françoise Gatel a annoncé, sous l’égide du Conseil national …
Mardi 5 décembre se tenait la deuxième édition du Roquelaure de la simplification, initiée par le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation. L’APVF était représentée par Antoine Homé, Premier Vice-président de l’APVF et Maire de Wittenheim.
À l’issue de cette réunion, la ministre Françoise Gatel a annoncé, sous l’égide du Conseil national d’évaluation des normes (CCEN), la mise en place d’un groupe de travail chargé d’identifier chaque année « des normes excessives, redondantes ou obsolètes ». Un méga-décret, annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu lors du Congrès des maires pour simplifier une trentaine de normes du niveau réglementaire, notamment en matière de droit de l’urbanisme, devrait être transmis en Conseil d’État avant publication.
Saluant la volonté de la ministre d’avancer concrètement vers une plus grande sobriété législative et réglementaire, Antoine Homé, pour l’Association des petites villes de France, a rappelé le coût des normes (14 milliards d’euros supplémentaires depuis 2005). Il a insisté sur le problème des décrets tertiaires, véritables « irritants » pour les collectivités territoriales, et appelé, dans le futur acte de décentralisation, à un renforcement du rôle du CCEN. Il a également dénoncé le fait que trop de décrets ayant reçu un avis défavorable du CCEN soient néanmoins mis en application.
« Le combat pour une action publique plus efficace et moins coûteuse est un combat de longue haleine », a-t-il conclu.

Baromètre vélo 2025 : les petites villes confirment leur rôle moteur dans la transition cyclable
La France des petites villes pédale à vive allure vers la transition cyclable. C’est l’un des enseignements majeurs de la 4ᵉ édition du Baromètre des Villes Cyclables, publiée après une enquête menée du 28 février au 2 juin 2025 par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). Plus grande consultation citoyenne au monde sur …
La France des petites villes pédale à vive allure vers la transition cyclable. C’est l’un des enseignements majeurs de la 4ᵉ édition du Baromètre des Villes Cyclables, publiée après une enquête menée du 28 février au 2 juin 2025 par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). Plus grande consultation citoyenne au monde sur les déplacements à vélo, le Baromètre continue de prendre le pouls du pays : celui d’une société où la mobilité active s’installe durablement dans les pratiques du quotidien.
Un thermomètre citoyen devenu incontournable
Tous les deux ans, cyclistes et non-cyclistes évaluent la qualité des déplacements à vélo dans leur commune. Sécurité, confort, services, efforts de la municipalité… Rien n’échappe au regard des usagers. Pour les collectivités, c’est un outil de démocratie participative devenu indispensable : un tableau de bord à ciel ouvert qui permet de mesurer, ajuster et parfois réorienter la politique cyclable locale.
Derrière ces retours, un objectif clair : coconstruire une politique de mobilité réellement inclusive, capable de répondre aux besoins des habitants, qu’ils vivent au cœur d’une métropole ou dans une petite commune rurale.
Participation en hausse : les petites villes en pleine accélération
L’édition 2025 confirme une tendance forte : les petites villes sont désormais pleinement engagées dans la dynamique cyclable nationale. Pas moins de 174 petites communes supplémentaires ont été qualifiées cette année, signe d’une mobilisation croissante des territoires.
Certaines collectivités tirent particulièrement leur épingle du jeu, souvent grâce au travail mené à l’échelle intercommunale. C’est le cas, par exemple, de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres, qui a investi massivement dans un réaménagement cyclable global, salué par les usagers.
Banlieues et petites villes : un climat vélo qui s’étend
Le climat vélo progresse de 6 % en moyenne dans les petites villes et communes de banlieue, atteignant une note globale encourageante de 3,16. Plusieurs communes proches de grandes agglomérations affichent même des bonds spectaculaires :
-
Thaon-les-Vosges : +32 %
-
Charenton-le-Pont : +29 %
-
Villeneuve-d’Ascq : +14 %
Ces résultats suggèrent un véritable effet de diffusion, comme une tache d’huile, à mesure que les grands pôles urbains renforcent leurs réseaux cyclables.
Top 3 2025 des petites villes
-
Andernos-les-Bains – 4,52
-
Brétignolles-sur-Mer – 4,45
-
Val-de-Reuil – 4,44
Des notes élevées qui reflètent un travail de long terme sur les infrastructures, la sécurité et les services proposés aux cyclistes.
Quelques chiffres qui parlent
-
918 petites villes étudiées (7,1 millions d’habitants)
-
464 qualifiées au Baromètre (3,9 millions d’habitants)
La forte participation confirme l’importance croissante accordée au vélo dans les stratégies locales de mobilité. Elle traduit aussi des attentes très nettes : des aménagements continus, sécurisés et adaptés à tous les usages, du vélotaf au loisir.
>> Les résultats complets, commune par commune, sont disponibles sur barometre-velo.fr.

Vœux du maire : les précautions à prendre en période préélectorale
À l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel an, en période préélectorale, plusieurs supports traditionnels de l’expression des élus sortants devront être surveillés : c’est le cas en particulier des cartes et cérémonies de vœux. La crainte des élus sortants quant au risque que font peser ces événements sur leur future élection doit être …
À l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel an, en période préélectorale, plusieurs supports traditionnels de l’expression des élus sortants devront être surveillés : c’est le cas en particulier des cartes et cérémonies de vœux.
La crainte des élus sortants quant au risque que font peser ces événements sur leur future élection doit être atténuée : s'ils prennent un minimum de précautions, ils passeront cet obstacle sans encombre.
Ainsi, le juge de l'élection ne sanctionnera l'avantage que tire (de ces supports festifs comme des autres supports) un candidat de sa fonction d'élu sortant que lorsqu'il constatera :
- soit une utilisation directement partisane,
- soit une rupture suspecte par rapport aux pratiques existant avant le 1er septembre 2025, date d’entrée dans la période préélectorale de surveillance de la communication publique.
Le critère de l'absence d'utilisation partisane est simple à respecter : ni la carte ni la cérémonie de vœux ne doivent faire référence à une candidature, aux programmes (c’est-à-dire aux décisions susceptibles d’être prises après mars 2026), ni servir de support à une critique de l'opposant. A ce titre, il est par exemple exclu que le slogan figurant sur la carte de vœux soit identique à celui qui figurera sur les professions de foi, les tracts ou la page de campagne du candidat sur les réseaux sociaux ;
Les cartes de vœux de la mairie ne poseront pas non plus de difficulté si elles ne font aucune référence à l'élection à venir et si elles sont identiques, dans leur facture et leur diffusion, à celles produites les années précédentes.
Ainsi, le Conseil d'État a jugé qu’était légale « La carte de voeux adressée, pour l'année 2004, par le maire et les membres du conseil municipal constitue un envoi traditionnel dont le contenu se situe très directement dans le prolongement des cartes adressées les années précédentes et ne contient aucune allusion, ni aux réalisations municipales, ni aux élections cantonales de mars 2004 » (CE, 20 mai 2005, Election cantonale du canton de Saint-Gervais, n°273749).
De même concernant la cérémonie de vœux, il conviendra de respecter la pratique annuelle de la Ville : ne devront augmenter en janvier 2026 ni le nombre de cérémonies, ni les catégories de personnes invitées, ni le nombre des invités, ni le budget global consacré à la cérémonie (en incluant l'animation et l'éventuel buffet), ni la durée du ou des discours (pris individuellement et pris globalement), ni le nombre des orateurs.
Le maire pourra prononcer un discours à cette occasion, y compris en dressant le bilan collectif des actions réalisées en 2025 et des projets déjà engagés pour le reste de l’année 2026, dès lors que cet exposé est présenté « en termes mesurés » (selon l’expression du Conseil d'État), sans formules inutilement valorisantes pour lui ou l'équipe sortante et sans attaques polémiques en direction de qui que ce soit, opposition ou associations locales.
Par exemple, le maire peut remercier, à l’occasion de cette cérémonie, les agents de la collectivité, sans que ceci ne constitue une valorisation des réalisations de l’équipe sortante interdite par le code électoral. Ainsi, pour le Conseil d'État : « il résulte de l’instruction, d’une part, que la cérémonie des vœux organisée le 27 janvier 2020 par le maire sortant n’a donné lieu qu’à un bref exposé par celui-ci du bilan des réalisations de la municipalité pendant l’année 2019, sans référence à un programme électoral et sans caractère polémique et, d’autre part, que les propos par lesquels, à l’occasion de ses vœux aux agents municipaux, le directeur général des services a fait le bilan des actions menées en 2019 dans la commune visaient seulement à remercier ces agents pour le travail accompli. Il résulte également de l’instruction que les moyens mis en œuvre pour ces évènements, qui revêtent un caractère traditionnel dans la commune de Tournefeuille, n’ont pas présenté de différence notable par rapport à ceux des éditions précédentes et que les dépenses engagées par la commune au cours de l’année 2020 pour diverses cérémonies correspondent au niveau des dépenses habituellement engagées lors des années précédentes. Ces cérémonies ne peuvent donc pas être regardées comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52 1 du code électoral » (CE, 15 juil. 2021, n° 451142).
Me Philippe BLUTEAU, avocat, Oppidum Avocats

Décembre ensemble : du bénévolat pour rompre l’isolement à côté de chez vous
La plateforme publique JeVeuxAider.gouv.fr, partenaire de l’APVF lance l’initiative “Décembre ensemble” pour encourager au bénévolat pour rompre la solitude. On parle beaucoup dans la presse “d’épidémie de solitude”. Et si on agissait pour inverser la tendance ? C’est l’idée de notre campagne Décembre Ensemble. Pendant, un mois, nous allons vous proposer le bénévolat le plus …
La plateforme publique JeVeuxAider.gouv.fr, partenaire de l'APVF lance l'initiative "Décembre ensemble" pour encourager au bénévolat pour rompre la solitude.
On parle beaucoup dans la presse “d’épidémie de solitude”. Et si on agissait pour inverser la tendance ? C’est l’idée de notre campagne Décembre Ensemble. Pendant, un mois, nous allons vous proposer le bénévolat le plus doux, et le plus réconfortant. Un café avec une personne âgée, une balade au parc, un BINGO lancé dans les airs. Les façons d’agir contre l’isolement sont infinies. Il y en a forcément une à côté de chez vous à découvrir.
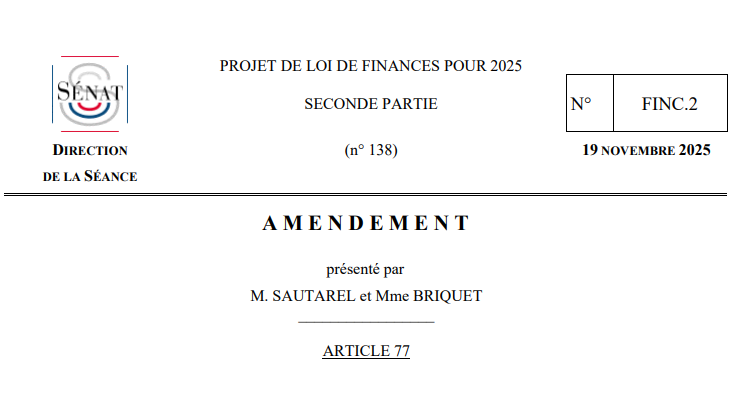
PLF 2026 : la contribution des communes au Dilico est annulée au Sénat
Les sénateurs avaient promis lors du congrès de l’Association des maires de France, de réduire de moitié en 2026 le mécanisme d’épargne forcée (« Dilico »), en le faisant passer de 2 milliards d’euros, dans le projet de budget pour 2026 déposé par le gouvernement, à moins de 1 milliard. Conformément à cette promesse, un amendement a …
Les sénateurs avaient promis lors du congrès de l'Association des maires de France, de réduire de moitié en 2026 le mécanisme d'épargne forcée (« Dilico »), en le faisant passer de 2 milliards d'euros, dans le projet de budget pour 2026 déposé par le gouvernement, à moins de 1 milliard.
Conformément à cette promesse, un amendement a été voté en commission des finances pour une contribution des collectivités de 890 millions d'euros au Dilico 2.
Au-delà du montant global, l'amendement adopté revoit également la répartition des contributions au Dilico entre les différentes catégories de collectivités territoriales. A la clé, les prélèvements sur les recettes des départements sont réduits de moitié (140 millions d'euros, contre 280 millions dans la copie du gouvernement).
Mais le bloc communal serait le grand bénéficiaire du geste voulu par le Sénat à destination des collectivités, avec l’annulation en totalité la charge de 720 millions d'euros prévue pour les communes, et de diviser par deux (de 500 millions à 250 millions) celle qui repose sur les intercommunalités.
En revanche, les sénateurs n'ont pas allégé la contribution des régions au Dilico, celle-ci demeurant à 500 millions d'euros.
A l'issu de l'examen par le Sénat, le texte poursuit son parcours parlementaire avec un retour à l'Assemblée nationale, reste à savoir si les dispositions adoptés par le Sénat seront conservés par l'Assemblée.
Télécharger l'amendement adopté par la commission des finances du Sénat en cliquant ici.

3 questions à...Frédéric Bernadet, Directeur Général du groupe SADE
Cette semaine, La Lettre des Petites Villes pose 3 questions à Frédéric Bernadet, Directeur Général du groupe SADE. 1. Pouvez-vous rappeler brièvement ce qu’est SADE et en quoi elle peut être utile aux petites villes ? SADE, filiale du Groupe NGE, est spécialiste du cycle de l’eau. Elle accompagne, depuis plus de 100 ans, des …
Cette semaine, La Lettre des Petites Villes pose 3 questions à Frédéric Bernadet, Directeur Général du groupe SADE.
1. Pouvez-vous rappeler brièvement ce qu’est SADE et en quoi elle peut être utile aux petites villes ?
SADE, filiale du Groupe NGE, est spécialiste du cycle de l’eau. Elle accompagne, depuis plus de 100 ans, des clients publics et privés dans la conception, la construction, la réhabilitation et l’entretien de leurs réseaux et de leurs infrastructures. Avec son maillage territorial dense (plus de 100 implantations en France), SADE est un partenaire de proximité pour les petites villes auxquelles elle sait proposer des solutions techniques sobres et innovantes pour des réseaux vertueux et des infrastructures décarbonées.
2. Les travaux sur les réseaux d’eau peuvent être longs et perturbants pour les habitants. SADE utilise-t-elle des techniques pour limiter les nuisances (interventions sans tranchée, délais réduits, etc.) ? Proposez-vous d’autres solutions innovantes pour limiter les nuisances ?
Nous savons bien que ces travaux nécessaires peuvent perturber le quotidien des usagers. C’est pourquoi depuis plus de 40 ans, SADE s’est engagée en matière de protection du cadre de vie et de réduction des nuisances pouvant provenir des chantiers.
Elle fait ainsi partie des précurseurs en matière de techniques de travaux éco-responsables limitant l’impact environnemental et les nuisances. Nous déployons notamment au quotidien en zone urbaine une large palette de techniques sans tranchée que ce soit pour des travaux neufs ou pour de la réhabilitation de conduites ou d’ouvrages (éclatement, tubage avec ou sans vide annulaire, chemisage, pose de coque, microtunnelage …). Précisons qu’au-delà de l’aspect environnemental et sociétal, ces techniques permettent aussi de s’affranchir des obstacles existants sur un tracé de travaux comme par exemple le passage sous voie ferrée ou le franchissement de cours d’eau.
Par ailleurs pleinement engagés dans la transition écologique, nous électrifions à grand pas notre parc matériel, véhicules et engins, sans oublier le petit outillage du quotidien pour un vrai gain en matière de réduction des nuisances sonores et d’émission de gaz à effet de serre.
Chez SADE, l’innovation se conçoit dans la continuité. Depuis la voiture à bras et son système de freinage, beaucoup d’innovations ont jalonné notre parcours. Et la dernière, qui a été développée par notre Direction de l’ingénierie intégrée en partenariat le laboratoire de Recherche et Développement du CEA à Grenoble vient d’être présentée au salon des Maires 2025 ! Il s’agit d’un robot d’à peine plus de 8 cm de diamètre qui facilite la réhabilitation des conduites de distribution d’eau potable de petit diamètre. Un grand pas en avant dans des environnements urbains à forte densité de réseaux qui permet non seulement de réduire les durées d’intervention et les nuisances associées au chantier, mais aussi de prolonger la durée de vie des réseaux en les régénérant. Une innovation, écologiquement vertueuse et économiquement adaptée, qui doit parler à tous les maîtres d’ouvrage et exploitants de réseaux qui souhaitent améliorer le rendement de leur réseau tout en valorisant l'existant !
3. Avez-vous une solution pour détecter les fuites sur les réseaux d’eau sans couper l’eau aux riverains ?
Notre technologie Inspect'O® permet d’inspecter, sans coupure d’eau, une conduite d’eau potable en charge, grâce à un passage caméra et à une sonde acoustique qui détecte les fuites.
Avec ce procédé qui inspecte une canalisation en temps réel et en fonctionnement, nous pouvons non seulement localiser les fuites avec certitude, mais aussi détecter les équipements non répertoriés, comprendre les causes des problèmes hydrauliques et de qualité d’eau, déterminer les zones de fragilité des conduites et établir un plan ciblé de renouvellement et de nettoyage des réseaux. C’est un procédé qui s’inscrit pleinement dans les enjeux de préservation de la ressource et d’anticipation des campagnes de renouvellement des réseaux qui animent toute collectivité !
Autant de solutions pour la transition écologique que nous serons heureux de présenter aux adhérents de l’Association des Petites Villes de France dans le cadre de prochaines matinées techniques !
Contact : Stéphane WUILQUE, Directeur du développement France du groupe SADE : stephane.wuilque@sade-cgth.fr
