ESPACE MEMBRE

XXVIIIe Assises des Petites Villes - 18 et 19 juin 2026
L’Association des Petites Villes de France a le plaisir de vous annoncer que les XXVIIIe Assises des Petites Villes se dérouleront à Château-Thierry les 18 et 19 juin 2026. Plus d’informations à venir prochainement.
L'Association des Petites Villes de France a le plaisir de vous annoncer que les XXVIIIe Assises des Petites Villes se dérouleront à Château-Thierry les 18 et 19 juin 2026.
Plus d'informations à venir prochainement.

PLF 2026 : les collectivités face aux arbitrages du gouvernement
Après l’imbroglio à l’Assemblée nationale et le recours à l’article 49.3 sur la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, état des lieux de la copie du gouvernement et de ses conséquences sur les budgets des collectivités territoriales. On peut noter que la dotation globale de fonctionnement (DGF) est maintenue à …
Après l'imbroglio à l'Assemblée nationale et le recours à l'article 49.3 sur la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, état des lieux de la copie du gouvernement et de ses conséquences sur les budgets des collectivités territoriales. On peut noter que la dotation globale de fonctionnement (DGF) est maintenue à son niveau de 2025 et que l'effort demandé aux collectivités en 2026 devrait s'élever entre 2 et 2,5 milliards d'euros.
Les principales mesures de la partie recettes de la version issue du 49.3 du PLF 2026 qui touchent les collectivités territoriales sont les suivantes :
- la dotation globale de fonctionnement (DGF) est rétablie dans son montant tel que voté au Sénat. À noter que, par rapport à la copie initiale, les sénateurs avaient abondé la DGF à hauteur de 290 millions d'euros. Elle s’établit ainsi à 27 405 973 591 euros ;
- à l'inverse, alors qu'elle avait été annulée au Sénat, la minoration de 180 millions d'euros de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions est rétablie dans la copie du gouvernement, en contrepartie d'une réduction de 200 millions d'euros de leur effort au Dilico. La minoration de la DCRTP du bloc communal est quant à elle maintenue ;
- FCTVA : c'est la version du rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Philippe Juvin, qui est retenue, avec notamment la suppression de l'éligibilité des opérations en régie (mais le maintien des dépenses de fonctionnement et des réseaux informatiques) ;
- réduction de la compensation « locaux industriels » : c'est la version légèrement assouplie du Sénat qui a été privilégiée par le gouvernement, avec l'application d'un coefficient de 0,807 au lieu de 0,75 ;
- TGAP : abaissement de la trajectoire haussière des tarifs prévue initialement ;
- révision des valeurs locatives cadastrales : décalage d’un an de l'intégration de l'actualisation des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels, et report de trois ans de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux d'habitation ;
- logements vacants : fusion des taxes sur les logements vacants (TLV) et de la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) en une taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH) ;
- CVAE : annulation de l'anticipation de la suppression progressive ;
- FNGIR : baisse de la compensation de 800 000 euros.
La partie dépenses du PLF devrait être connue le 23 janvier. De cette seconde partie, on sait que les modalités de fonctionnement du Dilico devraient être assouplies, avec notamment la suppression de la conditionnalité des reversements initialement prévue. Reste à savoir qui sera concerné et pour quels montants.
Pour tout savoir sur le PLF 2026, inscrivez-vous dès maintenant au webinaire sur les finances locales de l'APVF et de la Caisse d’Épargne, qui se tiendra le 12 février prochain, de 14h30 à 16h.

Réaffecter les voies rurales pour développer les mobilités actives
Comment mieux utiliser le réseau de voies existant dans les territoires ruraux pour favoriser le vélo et la marche du quotidien ? C’est à cette question centrale que répond le livret « Réaffectation de voies : valoriser le réseau rural au service des mobilités actives », publié par l’Association française pour le développement des véloroutes …
Comment mieux utiliser le réseau de voies existant dans les territoires ruraux pour favoriser le vélo et la marche du quotidien ? C’est à cette question centrale que répond le livret « Réaffectation de voies : valoriser le réseau rural au service des mobilités actives », publié par l’Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes (AF3V), avec le soutien de l’APVF.
Issu d’un travail mené avec des porteurs de projets et nourri par les échanges du colloque « Territoires ruraux : développons les mobilités actives ! » organisé à Rouen en septembre 2025, ce document s’adresse directement aux élus et techniciens des collectivités. Il propose une méthode claire pour transformer l’existant, en s’appuyant sur la connaissance fine du terrain, l’expertise des acteurs locaux et l’expérience des usagers.
Le livret invite à changer de focale : plutôt que de penser uniquement les grands flux pendulaires, il encourage à cibler les déplacements de proximité, à relier les bourgs, les zones d’habitat et les services, et à renforcer l’autonomie des habitants, en particulier celle des enfants. Il montre comment repérer les voies à potentiel, construire des projets partagés avec les communes, dialoguer avec les agriculteurs et lever progressivement les freins techniques ou culturels.
De nombreux retours d’expériences viennent illustrer cette démarche, à l’image de Caen-la-Mer ou de Plessé, où des aménagements simples, parfois temporaires, ont permis de sécuriser les usages et de faire évoluer les pratiques. Une véritable « boîte à outils » détaille des solutions légères et adaptées aux contraintes rurales : signalétique, barrières, organisation des carrefours, voies mixtes. Le livret ouvre également la réflexion sur les évolutions réglementaires nécessaires pour homogénéiser et sécuriser ces nouveaux aménagements.
Accessible, pragmatique et ancré dans la réalité des territoires, ce guide montre qu’il est possible d’agir rapidement, sans attendre de grands projets coûteux. Il constitue une ressource précieuse pour toutes les petites villes qui souhaitent engager une transition concrète vers des mobilités plus durables.
Le livret est disponible en téléchargement sur le site de l’AF3V.

3 questions à... Christelle Cubaud, Présidente de l’AF3V
Cette semaine La lettre des Petites Villes pose 3 questions à Christelle Cubaud, Présidente de l’AF3V, pour mieux comprendre les enjeux du vélo et des voies vertes dans nos collectivités Vous êtes présidente de l’AF3V. Quelle est la vocation de votre association ? L’AF3V, Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes, œuvre à …
Cette semaine La lettre des Petites Villes pose 3 questions à Christelle Cubaud, Présidente de l’AF3V, pour mieux comprendre les enjeux du vélo et des voies vertes dans nos collectivités
Vous êtes présidente de l’AF3V. Quelle est la vocation de votre association ?
L’AF3V, Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes, œuvre à la création d’un réseau ambitieux d’itinéraires cyclables et de voies dédiées aux mobilités actives. Son action vise à favoriser la transition écologique, l’inclusion sociale et l’amélioration de la santé publique.
Les véloroutes et les voies vertes relient villes et villages et permettent des déplacements à pied, à vélo ou en roller, aussi bien pour les trajets du quotidien que pour les activités de loisirs. Leur développement repose en grande partie sur la valorisation d’infrastructures existantes, comme les petites routes, les anciennes voies ferrées ou les chemins, y compris de halage. Le réseau doit ainsi être pensé pour les déplacements quotidiens, rester accessible aux publics en situation de fragilité sociale ou économique et répondre aux besoins de mobilité des personnes dépourvues de voiture.
Vous publiez le livret « Réaffectation de voies : valoriser le réseau rural au service des mobilités actives ». Pourquoi ce guide et à qui s’adresse-t-il ?
Je dirai d’abord ce qu’il n’est pas : ce guide n’est pas un rapport abstrait fait de calculs et de modélisations, certes utiles. Non ce guide s’appuie sur des expériences concrètes. Il est issu des échanges qui se sont déroulés lors de notre colloque à Rouen en septembre dernier et des entretiens préparatoires. Il rassemble les bonnes pratiques pour transformer des voies existantes en aménagements dédiés aux mobilités actives. Conçu comme un véritable outil d’aide à la décision, il accompagne chaque étape du processus en mettant au cœur de la démarche celles et ceux qui vivent le territoire : les habitants et les élus locaux.
Son ambition est simple : proposer des projets à la fois adaptés au territoire, sobres et efficaces.
- Sobres économiquement, car ils évitent les acquisitions foncières et la création d’infrastructures entièrement nouvelles.
- Sobres écologiquement, puisqu’ils s’appuient sur des réseaux déjà existants, sans recourir à des travaux lourds, gourmands en ressources et émetteurs de gaz à effet de serre.
- Sobres en délais, en évitant les études d’ingénierie et les procédures d’expropriation.
Les économies ainsi réalisées permettent de concentrer les efforts sur les points réellement complexes du tracé, lorsque c’est nécessaire.
Ce guide s’adresse en priorité aux élu(e)s, aux collectivités, aux associations, aux professionnels et, plus largement, à toutes les personnes engagées pour des mobilités actives plus sûres et plus inclusives. Il offre des solutions concrètes pour permettre à chacun de se déplacer sereinement — à pied, à vélo, en trottinette, en fauteuil roulant — là où l’absence d’aménagement sécurisé constitue aujourd’hui un obstacle majeur.
À l’approche des élections municipales, quels sont selon vous les principaux leviers pour développer les mobilités actives dans les petites villes ?
Le levier économique est indéniable. Se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture, c’est bon pour le porte-monnaie ! A condition d’avoir à sa disposition des itinéraires sécurisés et continus bien pensés qui rendent chaque trajet confortable et agréable.
La santé est également un enjeu primordial. Les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardio-vasculaire en 40 ans ! Le manque d’activité physique en est la cause principale. Se rendre sur son lieu d’étude ou aller voir les copains dans le village d’à côté, à pied ou à vélo et dans de bonnes conditions de sécurité, cela permet de bouger et donc de lutter contre la sédentarité et l’obésité. Cela vaut aussi pour les parents et les grands-parents ! Je pense aussi aux personnes à mobilité réduite. Quand on est en fauteuil, les possibilités de promenades sur un itinéraire sécurisé sont très souvent inexistantes. Pourtant, elles aussi ont besoin d’aller prendre l’air et de se déplacer en sécurité. J’ajoute pour terminer sur ce sujet essentiel que les gaz à effet de serre non produits en utilisant ses chaussures ou son vélo, plutôt que la voiture pour les petites distances, c’est un air plus respirable pour tous. C’est aussi bon pour la planète.
Enfin, l’acceptation de ces changements ne peut se faire sans l’implication des citoyens dans l’élaboration de ces politiques favorables aux mobilités actives. Faire participer celles et ceux qui se déplacent déjà à pied et à vélo ou qui ont une vraie volonté de le faire, intégrer leurs remarques et propositions, consulter les habitants, c’est s’assurer de viser juste.

À Nantes, aux BIS, Christophe Bouillon défend une culture de proximité au cœur des petites villes
À l’occasion de la 12ᵉ édition des Biennales Internationales du Spectacle (BIS), qui se tiennent ces 21 et 22 janvier 2026 à Nantes, Christophe Bouillon, Président de l’Association des petites villes de France (APVF) et maire de Barentin, a porté une parole forte en faveur du spectacle vivant et de la culture de proximité. Invité …
À l’occasion de la 12ᵉ édition des Biennales Internationales du Spectacle (BIS), qui se tiennent ces 21 et 22 janvier 2026 à Nantes, Christophe Bouillon, Président de l’Association des petites villes de France (APVF) et maire de Barentin, a porté une parole forte en faveur du spectacle vivant et de la culture de proximité. Invité par le syndicat de La Scène Indépendante, il est intervenu lors d’un débat consacré à la place du spectacle vivant privé indépendant dans les politiques territoriales à l’approche des élections municipales de 2026.
Dans un contexte de fortes tensions budgétaires — près de 50 % des collectivités ayant réduit leurs budgets culturels entre 2024 et 2025 selon l’Observatoire des politiques culturelles — Christophe Bouillon a rappelé le rôle fondamental de la culture dans les petites villes. « La culture n’est pas un supplément d’âme : elle nous permet de passer d’habiter un territoire à y vivre pleinement », a-t-il souligné. Spectacle vivant, lieux culturels, festivals et initiatives indépendantes constituent autant de services de proximité qui créent du lien social, structurent la vie collective et soutiennent l’économie locale.
Enfin, plusieurs intervenants ont alerté sur les risques de standardisation et de concentration du secteur culturel, liés notamment au développement des délégations de service public ou aux opérations de rachat par de grands groupes privés. La sénatrice de Loire-Atlantique Karine Daniel, membre de la commission de la culture du Sénat et rapporteure du budget 2026, a souligné l’importance d’une vigilance accrue des pouvoirs publics pour préserver la diversité de l’offre culturelle et soutenir les acteurs indépendants. Dans cette perspective partagée, Christophe Bouillon a rappelé que la commande publique et l'engagement des élus locaux pour "donner les clés" constituent des leviers essentiels pour garantir la pluralité culturelle, l’équilibre territorial et l’accès de toutes et tous à la création.
Aux BIS de Nantes, la voix des petites villes, croisée à celle des parlementaires, des élus locaux et des professionnels du spectacle vivant, a ainsi réaffirmé une conviction forte : la culture est un pilier de la démocratie locale et un moteur essentiel du « vivre ensemble » dans tous les territoires.

Logement, PLF 2026 et petites villes : des avancées pour un secteur en crise
Dans un contexte de fortes tensions sur le logement et d’incertitudes budgétaires, les annonces faites par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 16 janvier, puis la présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, ont suscité des réactions contrastées. Pour les petites villes, où le logement social est un levier central pour la …
Dans un contexte de fortes tensions sur le logement et d’incertitudes budgétaires, les annonces faites par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 16 janvier, puis la présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, ont suscité des réactions contrastées. Pour les petites villes, où le logement social est un levier central pour la cohésion sociale, ces arbitrages restent déterminants.
Des annonces pour desserrer l’étau sur les bailleurs sociaux
Le 16 janvier, afin d’éviter la censure du budget, le chef du gouvernement a présenté plusieurs mesures concernant le logement. La principale concerne les bailleurs sociaux, avec l’annonce d’un renforcement de leurs moyens à hauteur de 400 millions d’euros. L’objectif affiché est clair : permettre aux organismes HLM de construire davantage et de mieux rénover le parc existant.
Cette annonce s’est traduite, selon l’Union sociale pour l’habitat (USH), par une révision à la baisse de la réduction de loyer de solidarité (RLS), qui passerait de 1,3 milliard d’euros dans la version initiale du PLF à 900 millions d’euros en 2026, contre 1,1 milliard en 2025. Une inflexion saluée par la présidente de l’USH, Emmanuelle Cosse, qui y voit une « prise en compte des besoins » du secteur et un début de redéploiement des marges de manœuvre des bailleurs.
Le gouvernement a par ailleurs renoncé à l’année blanche envisagée pour les aides personnelles au logement (APL), évitant ainsi une nouvelle perte de pouvoir d’achat pour les ménages modestes. Enfin, le maintien du dispositif MaPrimeRénov’ a été confirmé, avec une volonté affichée de lutter plus fermement contre les fraudes.
Une stabilisation fragile confirmée par l’USH
Dans sa réaction publiée le 22 janvier, l’Union sociale pour l’habitat salue les progrès contenus dans la dernière version du PLF 2026, tout en appelant à la prudence. Si la baisse de la RLS constitue un signal positif, elle est partiellement compensée par une hausse très significative de la contribution au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), qui passerait de 75 millions d’euros en 2025 à 275 millions d’euros en 2026.
Au total, l’USH estime que ces arbitrages permettent une stabilisation globale des prélèvements sur les bailleurs sociaux au niveau de 2025. Une stabilisation jugée indispensable pour maintenir la dynamique de construction engagée l’an dernier, qui avait permis de programmer 115 000 logements neufs après une première baisse de la RLS.
En revanche, l’USH alerte sur le volet rénovation : les crédits exceptionnels mobilisés ces trois dernières années ne sont pas reconduits, ce qui pourrait fragiliser les efforts engagés pour améliorer la performance énergétique du parc social.
Des enjeux majeurs pour les petites villes
2,9 millions de familles attendent aujourd’hui un logement social adapté. Dans ce contexte, l’Association des petites villes de France reste particulièrement vigilante face aux débats qui émergent autour d’un possible affaiblissement de la loi SRU. Pour les territoires, la production de logements sociaux ne relève pas d’une contrainte idéologique, mais d’une nécessité concrète pour garantir la cohésion sociale et l’égalité territoriale.
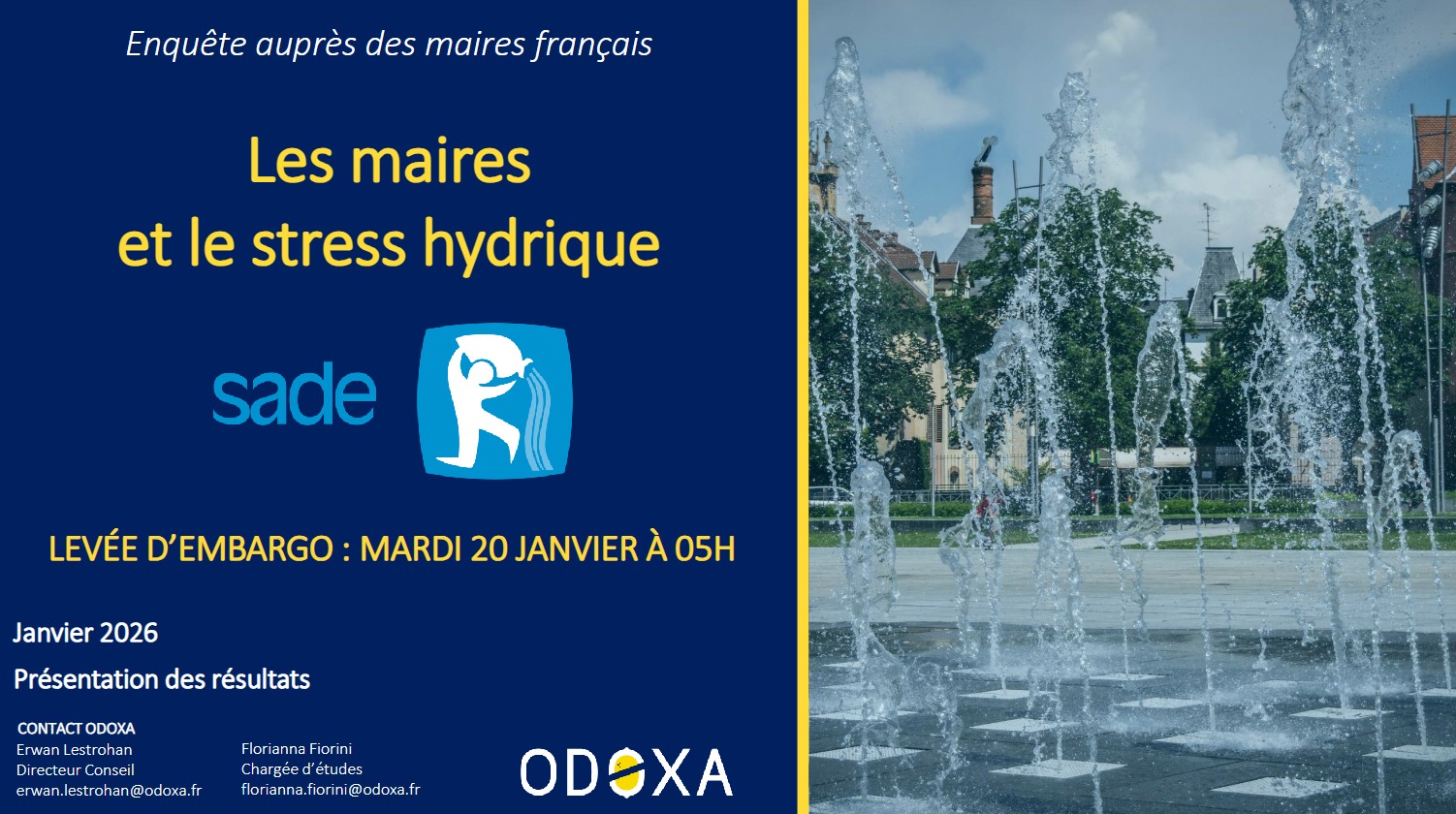
Stress hydrique : 4 maires sur 10 s’inquiètent pour le prochain mandat
À l’approche des élections municipales, la question de la ressource en eau s’impose comme un enjeu structurant pour l’ensemble des collectivités, et tout particulièrement pour les petites villes, souvent en première ligne face à la raréfaction de l’eau et au vieillissement des infrastructures. Partenaire de l’APVF, la SADE a présenté, avec l’institut Odoxa, une enquête …
À l’approche des élections municipales, la question de la ressource en eau s’impose comme un enjeu structurant pour l’ensemble des collectivités, et tout particulièrement pour les petites villes, souvent en première ligne face à la raréfaction de l’eau et au vieillissement des infrastructures. Partenaire de l’APVF, la SADE a présenté, avec l’institut Odoxa, une enquête nationale inédite qui mesure l’ampleur des inquiétudes des maires et des citoyens face au risque de stress hydrique. Les résultats confirment la nécessité d’anticiper dès aujourd’hui les solutions techniques, financières et organisationnelles adaptées aux réalités des territoires.
Selon l’enquête Odoxa réalisée pour la SADE, 36 % des maires estiment que leur commune pourrait être confrontée à une situation de stress hydrique au cours du prochain mandat municipal. Cette donnée nationale recouvre l’ensemble des strates communales et traduit une prise de conscience partagée, qui concerne pleinement les petites villes, où la sécurisation de l’accès à l’eau potable et la continuité du service public constituent des priorités essentielles pour l’attractivité résidentielle et économique.
L’inquiétude atteint 45 % dans les villes moyennes et grandes et 48 % dans le quart Sud-Est, territoires particulièrement exposés aux tensions sur la ressource. Mais les petites villes, souvent gestionnaires de réseaux étendus et parfois vieillissants, sont tout autant concernées par la nécessité d’investir dans la modernisation des infrastructures, la réduction des pertes en réseau et le développement de solutions de réemploi.
La population exprime une sensibilité comparable : 39 % des Français estiment qu’une situation de stress hydrique pourrait toucher leur commune dans les six prochaines années. L’inquiétude est particulièrement marquée chez les moins de 50 ans (49 %), signalant une attente croissante d’actions locales concrètes en faveur de la préservation de la ressource.
Pour les petites villes, cette convergence entre élus et habitants souligne l’importance de construire des stratégies territoriales lisibles, associant sobriété, sécurisation des captages, interconnexions et modernisation des équipements.
Interrogés sur leurs priorités, 37 % des maires déclarent se concentrer d’abord sur les inondations et la protection des biens et des personnes, tandis que 34 % privilégient la raréfaction de la ressource en eau et les solutions de réemploi. 29 % affirment accorder une vigilance équivalente aux deux enjeux.
Cette répartition illustre une réalité bien connue des petites villes : la nécessité de concilier prévention des risques climatiques et sécurisation des services essentiels, dans un contexte budgétaire contraint et face à des infrastructures parfois anciennes.
L’enquête met également en lumière les positions des maires sur la tarification de l’eau. 66 % se déclarent favorables à un prix identique sur l’ensemble du territoire communal, et 61 % à une tarification modulée selon l’usage. En revanche, une majorité reste réservée face à un prix variant selon le niveau de stress hydrique (55 %) ou selon le budget des familles (62 %).
Pour les petites villes, ces résultats rappellent l’importance d’un modèle économique soutenable, garantissant à la fois l’équilibre financier des services d’eau et l’acceptabilité sociale des politiques tarifaires.

Les vœux du Président de l’APVF : Nos petites villes, pôles d’équilibre et de stabilité
C’est en présence d’un public nombreux et avec la participation de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, Madame Françoise Gatel, que le Président de l’APVF, Christophe Bouillon, a présenté les vœux de l’APVF pour 2026, mardi 20 janvier au siège de la Maison des Travaux Publics à Paris. Il a notamment …
C’est en présence d’un public nombreux et avec la participation de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, Madame Françoise Gatel, que le Président de l’APVF, Christophe Bouillon, a présenté les vœux de l’APVF pour 2026, mardi 20 janvier au siège de la Maison des Travaux Publics à Paris.
Il a notamment présenté ce qu’il nomme les douze « travaux d’Hercule » de l’APVF pour cette nouvelle année :
-
Conforter et développer les partenariats institutionnels de l’association
-
Participer à la réflexion pour un nouveau modèle de financement et de fiscalité locale
-
Peser en faveur d’un partage de l’effort budgétaire plus juste et équitablement partagé
-
Demander de la prévisibilité et de la visibilité pour les collectivités territoriales
-
Œuvrer en faveur d’une décentralisation véritablement aboutie
-
Accélérer les mesures de simplification et mettre fin à l’inflation normative
-
Rouvrir le chantier des retraites et des indemnités des Maires de petites villes pour améliorer le statut de l’élu local
-
Conforter le rôle des petites villes, collectivités d’équilibre et de stabilité
-
Demander la prolongation et la pérennisation du programme « Petites Villes de Demain »
-
Œuvrer à une X des débats de la vie politique comme cela est le cas dans les collectivités territoriales
-
Demander à ce que la cohésion territoriale ne soit pas sacrifiée dans les prochains programmes européens
-
Inviter tous les maires de petites villes, réels ou nouvellement élus, aux prochaines Assises des Petites Villes à Château-Thierry les 18 et 19 juin prochains
Anticipant une année complexe et incertaine pour les collectivités territoriales, Christophe Bouillon a cité une maxime de La Fontaine tirée « du Loup, du Lion et du Renard » : « Les prudents qui se fient à leurs observations évitent les obstacles ».

PLF 2026 : imbroglio à l'Assemblée nationale
Depuis le 13 janvier, le projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026) est discuté en séance publique à l’Assemblée nationale. Dans une lettre ouverte, l’APVF a rappelé ses lignes rouges et ses attentes aux députés, qui pour certaines ont été suivies. Les amendements de la partie recettes relatifs aux collectivités territoriales ont été …
Depuis le 13 janvier, le projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026) est discuté en séance publique à l’Assemblée nationale. Dans une lettre ouverte, l’APVF a rappelé ses lignes rouges et ses attentes aux députés, qui pour certaines ont été suivies.
Les amendements de la partie recettes relatifs aux collectivités territoriales ont été appelés en priorité par le gouvernement. Hier, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a été indexée sur les prévisions d'inflation à partir 2026 et de manière pérenne. En 2026, cela devait revenir à un abondement de 400 millions environ. Mais, quelques heures après, les députés ont voté un autre amendement, sensiblement inverse, réduisant de 4,9 milliards d'euros la DGF. Ce revirement résulte d'un amendement "surprise" adopté à 57 voix pour et 47 contre, grâce à la mobilisation des rangs du Rassemblement national et de l'Union des droites pour la République, les autres groupes étant très faiblement représentés. Si ce vote n'est pas définitif et qu'un correctif est attendu, cet imbroglio politique éloigne toute perspective de compromis à l'Assemblée nationale.
Conformément aux demandes formulées par l'APVF, les députés ont voté le maintien des dépenses d’entretien de la voirie et de celles engagées pour la fourniture de services en informatique dans l'assiette du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ils ont en revanche exclu les travaux d'investissement réalisés en régie qui avait été ajoutés au Sénat. Comme l'APVF le demandait, la minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du bloc communal a également été annulée, ainsi que l'ensemble des baisses de variables d'ajustement.
A noter qu'un amendement du gouvernement a été adopté pour reporter d'un an l'intégration de l'actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels et acte le report de trois ans la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. La taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et la taxe d'habitation sur les logements vacants en zone non tendue sont fusionnée en une seule taxe affectée au bloc communal, distincte de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).
D'autres sujets sont attendus : Dilico, abattements "locaux industriels", avant l'éventualité d'un 49.3.

1.732 communes classées en zone de revitalisation des centres-villes en 2026
Cet article a initialement été publié dans le média Localtis, partenaire de l’APVF. 1.732 communes sont classées au titre du dispositif de zone de revitalisation des centres-villes, selon un arrêté du 26 décembre 2025 publié au Journal officiel du 31 décembre 2025. Peu utilisé, le dispositif ne peut être compensé par l’État, les exonérations étant …
Cet article a initialement été publié dans le média Localtis, partenaire de l'APVF.
1.732 communes sont classées au titre du dispositif de zone de revitalisation des centres-villes, selon un arrêté du 26 décembre 2025 publié au Journal officiel du 31 décembre 2025. Peu utilisé, le dispositif ne peut être compensé par l'État, les exonérations étant laissées à l'initiative des collectivités.
67 communes entrent dans le dispositif, 18 en sortent. L'arrêté
du 26 décembre 2025, publié au Journal officiel du 31 décembre 2025, actualise la liste des communes classées en zone de revitalisation des centres-villes. Pour 2026, ce seront au total 1.732 villes qui seront concernées par le dispositif. Dans le détail, certains départements voient un nombre important de communes entrer : 31 communes pour la Gironde, dont Monségur, Pauillac, La Réole et Rions, 24 communes pour la Creuse dont Crozant, Gouzon et Jarnages, 13 pour le Tarn-et-Garonne et 11 pour le Loir-et-Cher. À l'inverse, 4 communes des Hautes-Alpes (Briançon, Gap, Laragne-Montéglin, Serres) et 4 de Côte-d'Or (Brazey-en-Plaine, Losne, Saint-Jean-de-Losne, Seurre) en sortent.
Instauré en 2020, avec moins de 300 communes alors classées, ce dispositif permet aux élus, par délibération, d'exonérer partiellement ou totalement de CFE, de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les entreprises commerciales ou artisanales. Il a été prolongé jusqu'en 2026 par la loi de finances pour 2024. Pour y prétendre, les communes doivent répondre à deux critères : avoir conclu une convention ORT (opération de revitalisation du territoire) et avoir un revenu fiscal médian par unité de consommation inférieur à la médiane nationale. Les communes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte sont exemptées de ce dernier critère. Il n'y a pas de critère de population. La liste mêle ainsi des villes de taille différente.
Un dispositif peu utilisé et non compensé
Si le nombre de communes qui entrent augmente chaque année depuis 2020, "le dispositif n'est en réalité que peu utilisé jusqu'à présent", comme l'a souligné Jean-Pierre Verzelen, sénateur Les Indépendants de l'Aisne, dans une question écrite au gouvernement publiée le 23 janvier 2025. "Souvent méconnu, les communes ne sont parfois pas informées qu'elles font partie du zonage alors que ce dernier a d'ailleurs été étendu", précise le sénateur. Il regrette par ailleurs que les ZRCV ne fassent l'objet d'aucune compensation, à l'inverse des Zorcomir (zones de revitalisation des commerces en milieu rural). Dans sa réponse, du 10 avril 2025, le gouvernement avait donné une fin de non-recevoir à cette requête, expliquant que les exonérations de fiscalité, en dehors des transferts de compétences, ne donnent pas nécessairement lieu à compensation, "d'autant qu'en l'espèce, il s'agit d'une exonération laissée à l'initiative de la collectivité".
Retrouver l'article d'
Télécharger l'arrêté du 26 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2020 constatant le classement de communes en zone de revitalisation des centres-villes, publié au Journal officiel du 31 décembre 2025.
