ESPACE MEMBRE
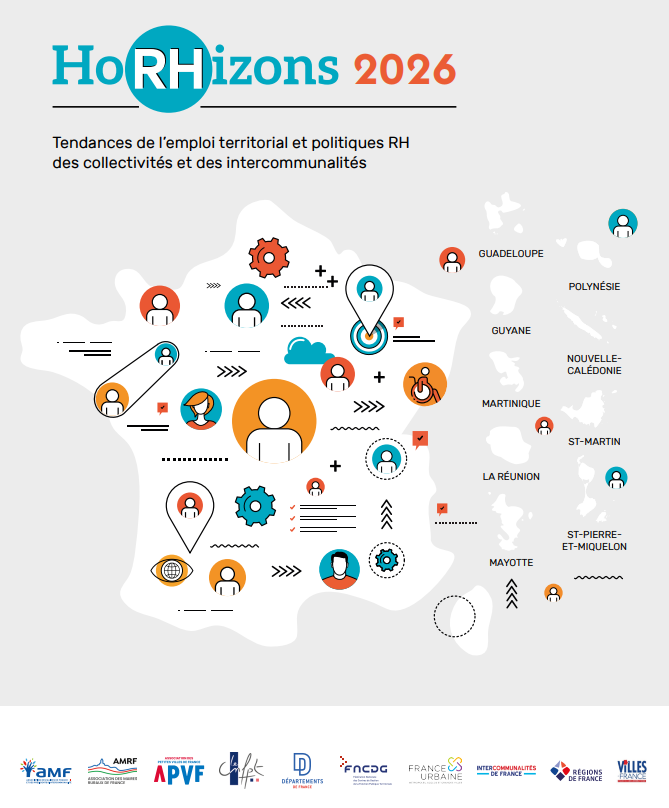
Les employeurs territoriaux gardent le cap sur leurs objectifs en matière de ressources humaines !
Les membres de la Coordination des employeurs territoriaux (CET) publient la 10ᵉ édition du Baromètre HoRHizons à la veille des élections municipales. Réalisée entre novembre et décembre 2025, cette enquête, menée auprès de 1 006 collectivités employeurs, analyse les tendances de l’emploi territorial et la politique RH des collectivités et intercommunalités. Dans un contexte singulier …
Les membres de la Coordination des employeurs territoriaux (CET) publient la 10ᵉ édition du Baromètre HoRHizons à la veille des élections municipales. Réalisée entre novembre et décembre 2025, cette enquête, menée auprès de 1 006 collectivités employeurs, analyse les tendances de l’emploi territorial et la politique RH des collectivités et intercommunalités.
Dans un contexte singulier de fin de mandat du bloc local, les membres de la CET ont fait le choix, d’une édition au format resserré, centrée sur les indicateurs clés dans la stratégie de ressources humaines des employeurs territoriaux. À l’heure des bilans, le Baromètre HoRHizons 2026 restitue ainsi les tendances et éléments clés sur cinq thématiques principales : la stratégie RH mise en œuvre pendant le mandat, la masse salariale, le recrutement, la formation et la protection sociale complémentaire.
Les employeurs territoriaux gardent le cap sur leurs objectifs en matière de ressources humaines.
À la veille des élections municipales, et dans un contexte financier très incertain, cette édition spéciale du baromètre HoRHizons porte principalement sur la stratégie menée par les employeurs territoriaux tout au long de ce mandat. Il s’agit de porter un regard sur les priorités mises en œuvre depuis 2020 mais aussi sur les enjeux et obstacles qu’ont dû appréhender les collectivités territoriales pour maintenir un service public local efficient.
Les élus locaux ont affiché une volonté forte de définir des lignes politiques claires en matière de gestion des ressources humaines et de s’y tenir.
Ainsi, l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents territoriaux a été une préoccupation permanente pour répondre aux enjeux d’attractivité, mais également à la nécessité de maîtriser la masse salariale. Dans un contexte où les charges de fonctionnement ont progressé sous l’effet de différents facteurs notamment l’augmentation substantielle imposée par l’État de la cotisation des employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), différents leviers ont été activés pour s’adapter à un monde professionnel en évolution : nouveaux besoins sociétaux, mur du vieillissement, intelligence artificielle, etc.
Le baromètre confirme deux préoccupations essentielles des employeurs territoriaux : la fidélisation des agents indispensables à la continuité du service public et la capacité à continuer de proposer des perspectives de carrière attractives.
Ce baromètre met en évidence le choix qui a été fait par les communes et intercommunalités de maintenir à un niveau élevé l’effort de formation professionnalisante mais aussi de compenser les inégalités d’accès à la protection sociale complémentaire.
L’enjeu du mandat qui débutera pour les communes et les intercommunalités dans les prochaines semaines transparaît clairement dans cette publication : comment les employeurs territoriaux pourront-ils offrir des perspectives d’emploi et des conditions de travail renouvelées au sein des collectivités territoriales malgré un contexte financier incertain ?
Les membres de la Coordination des employeurs territoriaux sont aux côtés des élus pour répondre à ces nouveaux défis.

La loi de finances pour 2026 sur le point d'être promulguée
Le projet de loi de finances pour 2026 a été définitivement adopté le 2 février par le Parlement, en attendant l’examen par le Conseil constitutionnel. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a utilisé une dernière fois l’article 49.3, le 2 février, lors de l’examen du texte en lecture définitive au Parlement, accélérant alors la perspective du …
Le projet de loi de finances pour 2026 a été définitivement adopté le 2 février par le Parlement, en attendant l'examen par le Conseil constitutionnel. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a utilisé une dernière fois l'article 49.3, le 2 février, lors de l'examen du texte en lecture définitive au Parlement, accélérant alors la perspective du vote.
La contribution initiale de 4,6 milliards d'euros est ramenée à 2 milliards d'euros, selon les chiffres du gouvernement. La diminution de la contrainte aura notamment été portée par l'exonération des communes au dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités (Dilico), dont le montant devait passer, dans la version initiale, à 2 milliards d'euros, dont 720 millions d'euros pour les seules communes. Au final, le Dilico est fixé à 740 millions d'euros, avec 350 millions pour les régions, 140 millions pour les départements et 250 millions pour les intercommunalités. Cette exonération pourrait ne pas convenir aux Sages du Conseil constitutionnel...
Les variables d'ajustements reviennent à leur niveau initial, à 527 millions d'euros, alors que les sénateurs avaient choisi de minorer la baisse pour les régions. Dans la partie « dépenses » du texte, les régions sont cependant sorties gagnantes d'un arbitrage finançant la création de places en instituts de formation sanitaire et sociale à hauteur de 215 millions d'euros.
Les intercos sont, quant à elles, en colère par rapport à la baisse de la compensation de la réduction des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI), dont le coefficient de baisse est fixé à 19,3 %, quand le gouvernement, dans le texte initial, prévoyait une réduction de 25 %.
Sur le reste, le gouvernement a confirmé le maintien, dans l'assiette du fonds de compensation pour la TVA, des dépenses de fonctionnement liées à l'entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux, ainsi qu'à la fourniture de services informatiques. Le gouvernement a également fusionné la taxe sur les logements vacants (TLV) et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV). La mise en œuvre de cette fusion sera l'un des dossiers de l'année.
En outre, différentes mesures visant à sécuriser le versement de la taxe d'aménagement aux collectivités figurent également dans le texte final comme sollicité par les associations d'élus, dont l'APVF.
Sur les dotations d'investissement, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » baissent de 3,9 %. Le fonds vert, pour sa part, subit une baisse marquée par rapport à 2025, mais moins pire que celle prévue. Enfin, le gouvernement n'est pas revenu sur la suppression de l'article visant à instaurer un fonds d'investissements des territoires, actée par les sénateurs.
Avec le retard pris par l'adoption du budget après le 1er janvier, l'exécutif a incorporé plusieurs mesures afin de sécuriser des dispositions du texte, notamment, le versement de la DGF. Dans un amendement, il explique que les modifications vont permettre « de pouvoir procéder le plus rapidement possible à la répartition de la DGF et, in fine, [sans] nuire à la continuité du service public ».
En attendant la décision du Conseil constitutionnel et la publication de la loi au « Journal officiel », les collectivités sont désormais fixées sur leur sort. Et si elles ne sortent pas indemnes du débat budgétaire, elles seront soulagées d'avoir un PLF avant les élections municipales de mars, et pourront élaborer leurs budgets un peu plus sereinement.
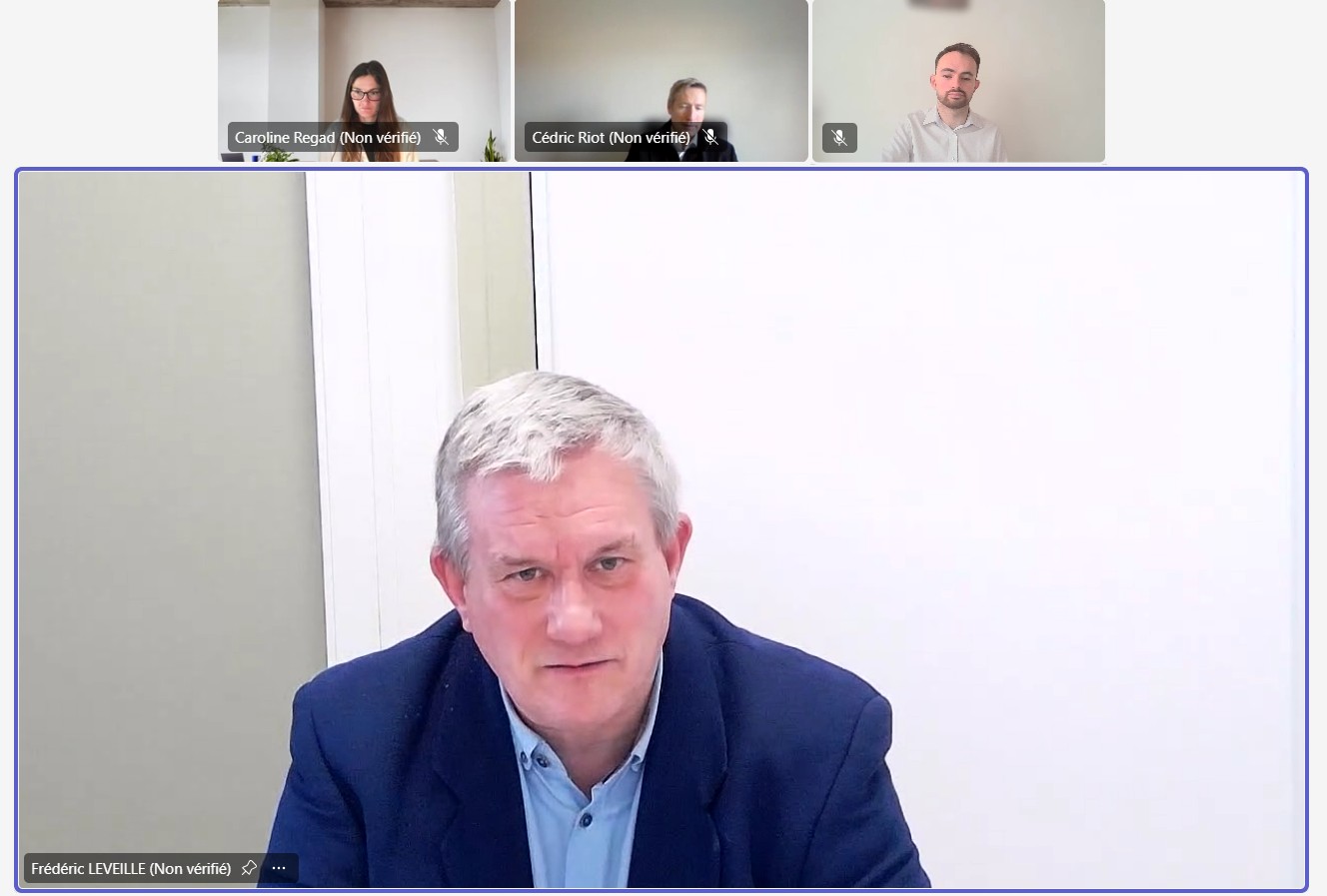
Audition de Frédéric Leveillé par l’Assemblée de la Terre : « Il faut libérer l’intelligence économique des petites villes »
Auditionné par l’Assemblée de la Terre, espace de réflexion universitaire consacré aux politiques du vivant et aux trajectoires de transition écologique, Frédéric Leveillé, Maire d’Argentan et membre du Bureau de l’APVF, a porté la voix des petites villes. L’occasion de rappeler leur rôle central dans l’action climatique locale, d’identifier les freins qu’elles rencontrent et de …
Auditionné par l’Assemblée de la Terre, espace de réflexion universitaire consacré aux politiques du vivant et aux trajectoires de transition écologique, Frédéric Leveillé, Maire d’Argentan et membre du Bureau de l’APVF, a porté la voix des petites villes. L’occasion de rappeler leur rôle central dans l’action climatique locale, d’identifier les freins qu’elles rencontrent et de défendre des moyens adaptés à leurs capacités d’investissement et d’ingénierie.
À l’invitation de l’Assemblée de la Terre, dispositif pluridisciplinaire réunissant chercheurs et praticiens autour des enjeux du droit du vivant et de la soutenabilité, l’Association des Petites Villes de France a participé à une audition consacrée à la contribution des collectivités locales aux objectifs climatiques et environnementaux. Cet échange visait à confronter les approches théoriques aux réalités de terrain et à mieux comprendre les conditions concrètes de mise en œuvre des politiques publiques locales.
Représentant l’APVF, Frédéric Leveillé, Maire d’Argentan et membre du Bureau, a rappelé la place stratégique des communes de 2 500 à 25 000 habitants dans l’organisation des territoires. Villes-centres, bourgs structurants ou pôles de services, elles assurent des fonctions essentielles pour des bassins de vie souvent étendus en matière de services publics, de santé, de mobilités, de commerces et d’activité économique. À ce titre, elles constituent un maillon décisif de la transition écologique.
Sur le terrain, les actions engagées sont d’abord pragmatiques et directement opérationnelles. Les petites villes agissent sur les leviers qu’elles maîtrisent : rénovation énergétique des bâtiments publics, modernisation de l’éclairage, développement d’énergies renouvelables locales, sobriété des services, renaturation des espaces urbains, reconversion de friches, soutien aux circuits courts et aux mobilités du quotidien. Ces politiques produisent des effets immédiats, à la fois sur la réduction des émissions, l’adaptation aux risques et l’amélioration du cadre de vie.
L’audition a toutefois mis en évidence les limites auxquelles ces collectivités sont confrontées. Les investissements nécessaires sont élevés pour des budgets contraints. Le manque d’ingénierie spécialisée, la complexité des procédures et la multiplication des appels à projets freinent la mise en œuvre des initiatives. Les élus doivent en permanence concilier transition écologique, maintien des services de proximité et pouvoir d’achat des habitants, ce qui rend les arbitrages particulièrement sensibles.
Face à ces constats, l’APVF a plaidé pour des solutions structurelles plutôt que ponctuelles. Des financements plus lisibles et pluriannuels, moins dépendants de dispositifs concurrentiels, une ingénierie territoriale mutualisée et pérenne, ainsi qu’une simplification normative effective constituent des conditions indispensables pour accélérer les projets. L’objectif est de sécuriser l’action locale et de donner aux petites villes des capacités d’intervention stables.
Au-delà des aspects techniques, le message porté s’inscrit dans une vision plus large du rôle des territoires. Les petites villes ne sont pas uniquement des exécutantes des politiques nationales. Elles sont aussi des espaces d’innovation économique et sociale, capables d’expérimenter des solutions adaptées aux réalités locales. Comme l’a souligné Frédéric Leveillé au cours des échanges, « il faut libérer l’intelligence économique des petites villes ». Leur capacité à articuler transition écologique, développement local et cohésion sociale en fait de véritables laboratoires de la transformation territoriale.

Polices municipales : enfin l'aboutissement du Beauvau ?
Près de trois décennies après la loi Chevènement, le régime juridique encadrant l’action des polices municipales et des gardes champêtres s’apprête à évoluer en profondeur. Le projet de loi relatif à l’extension de leurs prérogatives, de leurs moyens et de leur organisation est examiné en séance publique au Sénat depuis le mercredi 4 février 2025, …
Près de trois décennies après la loi Chevènement, le régime juridique encadrant l’action des polices municipales et des gardes champêtres s’apprête à évoluer en profondeur. Le projet de loi relatif à l’extension de leurs prérogatives, de leurs moyens et de leur organisation est examiné en séance publique au Sénat depuis le mercredi 4 février 2025, après un passage remarqué en commission des Lois, qui a largement enrichi le texte initial.
Ce texte est l’aboutissement d’un long processus engagé il y a près de deux ans avec le lancement, en avril 2024, du « Beauvau des polices municipales ». Son examen intervient dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement sensible, à un mois et demi des élections municipales, alors que les attentes des élus locaux en matière de sécurité du quotidien sont fortes.
Un texte profondément remanié en commission des Lois
La commission des Lois du Sénat a en effet substantiellement étoffé le projet de loi, en adoptant une quarantaine d’amendements, souvent à l’initiative des rapporteures Jacqueline Eustache-Brinio (LR, Val-d’Oise), auteure d’un rapport sur les polices municipales publié en mai 2025, et Isabelle Florennes (UC, Hauts-de-Seine).
Parmi les évolutions majeures figure l’élargissement des compétences de police judiciaire des policiers municipaux et des gardes champêtres. La liste initiale de neuf « délits du quotidien » pouvant être constatés sans acte d’enquête a été complétée. Elle inclut désormais notamment :
-
la conduite sans permis ;
-
la conduite sans assurance ;
-
le port ou le transport d’armes blanches ;
-
certains délits commis dans les enceintes sportives (intrusion sur une aire de compétition, introduction de boissons alcoolisées) ;
-
les très grands excès de vitesse ;
-
l’installation non autorisée sur un terrain en vue d’y établir une habitation, une disposition visant en particulier les installations illicites des gens du voyage. En 2024, 569 installations illégales ont ainsi été recensées.
Les policiers municipaux pourront également procéder à des dépistages de stupéfiants, au même titre que les contrôles d’alcoolémie déjà prévus dans le texte initial. En revanche, les sénateurs ont choisi d’écarter la possibilité de constater le délit de conduite malgré invalidation du permis, estimant que cette infraction nécessite des actes d’enquête et ne peut donner lieu à une amende forfaitaire délictuelle.
Accès élargi aux fichiers et nouveaux pouvoirs opérationnels
Ces nouvelles compétences s’accompagnent d’un élargissement de l’accès à certains fichiers. Les policiers municipaux pourraient ainsi consulter le fichier des véhicules assurés (FVA) pour constater la conduite sans assurance, ainsi que le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle étant conditionné à l’absence de récidive légale.
Autre évolution notable : les infractions relevant de la compétence de police judiciaire élargie ne seraient plus limitées à la voie publique, mais pourraient également être constatées dans des enceintes privées.
Les sénateurs proposent par ailleurs d’étendre les possibilités de relevé d’identité, qui ne seraient plus cantonnées aux seules infractions constatables par les policiers municipaux, mais élargies à l’ensemble des crimes et délits flagrants.
Le texte autorise également, sous réserve du consentement des personnes concernées, les inspections visuelles de bagages, les palpations de sécurité et les inspections de véhicules dans le cadre de manifestations sportives, culturelles ou récréatives, ainsi que dans les périmètres de protection et les transports.
Enfin, dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages, policiers municipaux et gardes champêtres pourraient recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) pour constater certaines contraventions liées à l’abandon de déchets.
Un enjeu majeur pour les petites villes
Pour l’Association des petites villes de France, cette réforme soulève des enjeux majeurs. Comme l’avait montré une enquête de l’APVF dès 2015, le choix de se doter d’une police municipale relève avant tout d’une décision politique, largement déconnectée de critères strictement démographiques ou sécuritaires. De nombreuses petites villes ont fait ce choix malgré les contraintes budgétaires qu’il implique, tandis que d’autres privilégient des modèles alternatifs ou intercommunaux.
Dans ce contexte, l’APVF rappelle que l’extension des prérogatives des polices municipales ne saurait constituer un prétexte à un désengagement supplémentaire de l’État de ses missions régaliennes. Pour les petites villes, déjà confrontées à de fortes tensions financières et à une hausse des attentes de la population en matière de sécurité, la question des moyens humains, financiers et de la formation reste centrale.
L’examen du texte en séance publique sera donc suivi avec attention par les élus des petites villes, attentifs à l’équilibre entre renforcement de la sécurité du quotidien et respect du rôle fondamental de l’État dans les politiques de sécurité.

Lancement du Programme Best Tourism Villages de l’ONU
Le programme Best Tourism Villages (BTV) lancera prochainement son édition 2026, portée par l’ONU Tourisme. Ce programme vise à valoriser les villages ruraux de moins de 15 000 habitants engagés dans une démarche de tourisme durable et la préservation de leur patrimoine naturel et culturel. En 2025, la France a participé pour la première fois …
Le programme Best Tourism Villages (BTV) lancera prochainement son édition 2026, portée par l’ONU Tourisme. Ce programme vise à valoriser les villages ruraux de moins de 15 000 habitants engagés dans une démarche de tourisme durable et la préservation de leur patrimoine naturel et culturel.
En 2025, la France a participé pour la première fois à ce dispositif, et le village de Pont-Croix a été retenu parmi les lauréats internationaux. Quelques informations la publication officielle de l’appel à candidatures par l’ONU Tourisme attendue pour les prochains jours.
- Présélection nationale (février – mars 2026)
Les villages intéressés devront remplir un formulaire de présélection en ligne, qui sera disponible fin janvier/début février 2026 (dès que l’ONU Tourisme publiera les modalités de l’édition 2026). Date limite de dépôt : mars 2026 (date à confirmer).
- Accompagnement et candidature officielle (avril – mai 2026)
Jusqu’à huit villages seront retenus à l’issue de la présélection. La DGE les accompagnera pour finaliser leur dossier de candidature avant envoi à l’ONU Tourisme. Date limite de dépôt final : mi-mai 2026 (date à confirmer).
Un webinaire d’information sera organisé le 10 février par la Direction générale des entreprises (DGE) pour présenter :
- les différentes étapes du processus de candidature ;
- les modalités de présélection nationale ;
- les attendus du dossier officiel à soumettre à l’ONU Tourisme.
Le webinaire sera enregistré et pourra être visionné ultérieurement.
Pour en savoir plus sur le programme Best Tourisme Villages
Lien de connexion pour le webinaire de la Direction Générale des Entreprises, du 10 février 2026 (12h-13h)

Lancement de l'initiative "Février pour protéger" de JeVeuxAiger.gouv.fr
La plateforme publique de bénévolat, partenaire de l’APVF, JeVeuxAiger.gouv.fr, lance l’initiative “Février pour protéger”. Cette nouvelle opération nationale mettra à l’honneur le bénévolat en faveur de la prévention, du secourisme et de la santé, en partenariat avec La Protection Civile, La Croix-Rouge, l’ANPS, et l’association Prévention Routière. Une présentation de l’initiative par JeVeuxAider.gouv.fr Au programme …
La plateforme publique de bénévolat, partenaire de l'APVF, JeVeuxAiger.gouv.fr, lance l'initiative "Février pour protéger". Cette nouvelle opération nationale mettra à l’honneur le bénévolat en faveur de la prévention, du secourisme et de la santé, en partenariat avec La Protection Civile, La Croix-Rouge, l’ANPS, et l’association Prévention Routière.
Une présentation de l'initiative par JeVeuxAider.gouv.fr
Au programme : donner le bras, tendre l’oreille et devenir plus endurants collectivement. Car comme disait récemment Timothée Chalamet en interview : “Life doesn’t come at you, it comes from you” ce qu’on traduit par “la vie ne vient pas à vous, mais de vous”.
Pssst : cliquez sur l’annonce de bénévolat qui vous correspond puis sur "Je propose mon aide" pour être mis en relation avec le responsable de la mission 😉
| Découvrez les missions qui prennent soin de la vie. |
|
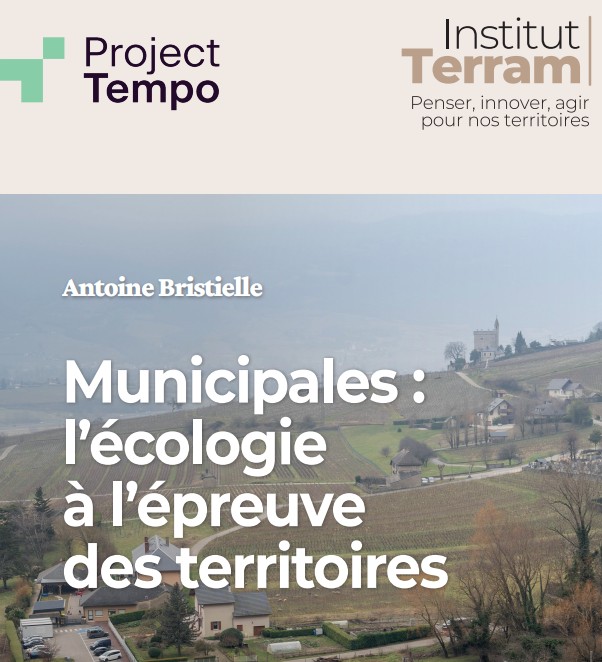
Municipales 2026 : dans les petites villes, l’écologie devient une question de sécurité et de cadre de vie
D’après une étude récente de l’Institut Terram et de l’ONG Project Tempo, l’environnement demeure une préoccupation majeure des électeurs à l’approche des municipales. Loin d’être cantonnée aux métropoles, cette préoccupation traverse aussi les petites villes, où elle se mêle aux enjeux très concrets de santé, d’eau, de services et de protection du quotidien. Pour les …

Aménagement du territoire : Pour une mobilisation coordonnée État-Collectivités
Remis à la ministre chargée de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, le rapport confié à Dominique Faure, Maire de Saint-Orens de Gameville et ancienne ministre, appelle à relancer une véritable politique nationale d’aménagement du territoire. Il plaide pour une action publique plus cohérente, moins sectorisée et davantage construite avec les collectivités locales, une …
Remis à la ministre chargée de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, le rapport confié à Dominique Faure, Maire de Saint-Orens de Gameville et ancienne ministre, appelle à relancer une véritable politique nationale d’aménagement du territoire. Il plaide pour une action publique plus cohérente, moins sectorisée et davantage construite avec les collectivités locales, une orientation qui concerne directement les petites villes, en première ligne pour garantir l’accès aux services et la cohésion territoriale.
Face aux fractures territoriales persistantes, aux tensions sociales et à l’urgence écologique, la mission dresse un constat sans ambiguïté. L’action publique demeure puissante, mais elle s’est progressivement fragmentée. Les politiques de logement, de santé, de mobilités, d’environnement ou de développement économique sont encore trop souvent pensées séparément, alors qu’elles s’exercent sur les mêmes territoires et mobilisent les mêmes élus.
Cette organisation en silos nourrit une forme de complexité permanente. Les collectivités doivent composer avec une multitude de dispositifs, d’appels à projets et de financements ponctuels, parfois difficiles à articuler entre eux. Le rapport défend donc moins un nouvel outil qu’un changement de méthode : simplifier, coordonner et donner un cap commun.
L’État est ainsi invité à retrouver un rôle de stratège. Non pour prescrire uniformément, mais pour fixer une vision nationale à long terme, accompagner les dynamiques locales et mieux articuler ses politiques. L’objectif est clair : passer d’une logique descendante à une logique partenariale État-Collectivités.
Plusieurs leviers sont proposés. L’élaboration d’une stratégie nationale d’aménagement du territoire à horizon 2035 et 2050, une gouvernance associant l’ensemble des strates de collectivités, une contractualisation plus lisible fondée sur des engagements réciproques, ainsi qu’une coordination interministérielle renforcée afin d’éviter la dispersion des initiatives.
Au cœur de cette approche figure une idée simple : partir des projets de territoire. Plutôt que d’empiler des dispositifs sectoriels, il s’agit d’organiser l’action publique autour des priorités définies localement, avec les élus, les services de l’État et les acteurs socio-économiques. Le territoire devient le point d’entrée de l’action publique, et non plus sa simple zone d’application.
Pour les petites villes, cette orientation est particulièrement concrète. Situées à la charnière entre ruralité et centralités de services, elles doivent simultanément maintenir l’accès aux soins, soutenir le commerce de proximité, moderniser leurs équipements, rénover le bâti public, adapter leurs réseaux aux effets du changement climatique et préserver l’attractivité de leurs centres-bourgs. Ces enjeux dépassent largement le cadre communal et exigent une coopération étroite avec l’État et les intercommunalités.
Dans ce contexte, la stabilité des financements, la clarté des compétences et l’accès à l’ingénierie apparaissent comme des conditions essentielles d’efficacité. Les petites villes n’attendent pas une nouvelle couche de dispositifs, mais davantage de lisibilité et de capacité d’action pour mener des projets dans la durée.
En filigrane, le rapport rappelle que l’aménagement du territoire ne peut plus se réduire à des mécanismes de soutien ponctuel. Il doit redevenir un projet collectif structurant, articulant cohésion sociale, transition écologique et développement économique.
Pour l’APVF, ces orientations rejoignent directement les attentes exprimées par les maires des petites villes. Donner de la cohérence aux politiques publiques, reconnaître le rôle pivot du bloc local et contractualiser sur le long terme sont des leviers décisifs pour garantir l’égalité d’accès aux services publics sur l’ensemble du territoire.
À l’heure où se prépare le prochain mandat municipal, cette réflexion sur la méthode de l’action publique prend une dimension stratégique. Les petites villes ne sont pas de simples relais d’exécution.

PLF 2026 : les communes exonérées du Dilico mais les intercos paieront !
Après son adoption à l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances est examiné ce matin au Sénat avant de repartir devant les députés. Les mesures touchant les collectivités sont a priori quasi définitives. Focus sur la partie “dépenses” du PLF. Concernant le Dilico, le gouvernement s’est aligné sur la version du Sénat : les communes …
Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances est examiné ce matin au Sénat avant de repartir devant les députés. Les mesures touchant les collectivités sont a priori quasi définitives. Focus sur la partie "dépenses" du PLF.
Concernant le Dilico, le gouvernement s’est aligné sur la version du Sénat : les communes sont totalement exonérées du Dilico. Les prélèvements des intercommunalités et des départements sont fixés respectivement à 250 millions d’euros (contre 500 millions dans la copie de départ) et 140 millions d’euros (contre 280 millions initialement). Le gouvernement renonce également au durcissement des modalités des reversements aux collectivités ponctionnées. Ils seront effectués sans condition, par tiers chaque année. Seule une part de 10 % sera affectée aux dispositifs de péréquation financière entre les collectivités (contre 20 % dans la copie initiale). Le gouvernement, en revanche, accorde un allègement aux régions en établissant leur ponction à 350 millions d’euros contre 500 millions voté au Sénat. Au total, le gouvernement passe l’effort de 2 milliards d’euros dans la première version du texte à 740 millions d’euros. Si l’APVF se félicite de l’exonération des communes, elle regrette un effort encore injuste et incohérent qui va peser essentiellement sur les intercommunalités, déjà très impactées par la baisse des compensations « locaux industriels » et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).
Par ailleurs, le fonds d'investissement pour les territoires (FIT) qui avait été supprimé par les sénateurs, n'est pas réapparu dans la copie presque finale. Ce fonds s’accompagnait d’une diminution de 200 millions d’euros de l’enveloppe. Les dotations de soutien à l’investissement de droit commun sont donc préservées dans leur structure et leur montant.
Toujours sur l’investissement, et comme promis par le Premier ministre, le fonds vert est réhaussé à 837 millions d'euros en autorisation d'engagement (AE) et 1,070 milliard en crédits de paiement (CP).
Pour tout savoir sur le PLF 2026, inscrivez-vous dès maintenant au webinaire sur les finances locales de l'APVF et de la Caisse d’Épargne, qui se tiendra le 12 février prochain, de 14h30 à 16h.

Fermeture du réseau Cuivre : lancement du lot 5
Dans le cadre de la fermeture progressive du réseau de cuivre, le lot 5, composé de 10470 communes, est désormais concerné. Cette fermeture se déroulera en deux temps, conformément au cadre de la régulation définie par l’Arcep dans la décision d’analyse des marchés en date du 14/12/2023 : La fermeture commerciale des offres cuivre : plus …
Dans le cadre de la fermeture progressive du réseau de cuivre, le lot 5, composé de 10470 communes, est désormais concerné.
Cette fermeture se déroulera en deux temps, conformément au cadre de la régulation définie par l’Arcep dans la décision d’analyse des marchés en date du 14/12/2023 :
- La fermeture commerciale des offres cuivre : plus aucune prestation d’accès à la boucle locale cuivre d’Orange ne sera commercialisée.
- La fermeture technique des offres cuivre : toutes les prestations d’accès à la boucle locale cuivre d’Orange devront avoir été résiliées par les opérateurs.
La liste des communes identifiées pour ce lot 5 se trouve dans le fichier "Trajectoire de Fermeture du réseau cuivre.xlsx" sur le site internet d’Orange à l’adresse http://oran.ge/documentation, dans la rubrique "Plan de Fermeture du réseau de boucle locale cuivre".
Compte tenu des volumes importants du lot 5, afin de sécuriser les opérations de fermeture, Orange décompose ce lot en 3 sous-lots de fermeture technique de façon similaire au lot 4.
Les communes seront identifiées comme suit :
- Le champ lot contiendra les valeurs 5_1, 5_2, 5_3
- Les dates de fermeture technique contiendront les valeurs suivantes :
- 31/01/2029 pour le sous-lot « 5_1 »
- 31/05/2029 pour le sous-lot « 5_2 »
- 31/10/2029 pour le sous-lot « 5_3 »
La mise à jour du fichier trajectoire inclut également la date de mise en œuvre de l'adaptation SAV, pour toutes les communes dont la fermeture commerciale est fixée au 31 janvier 2026 et dont la fermeture technique est dans moins de 2 ans, en tenant compte du délai de prévenance de 6 mois.
