ESPACE MEMBRE

Les maires des petites villes se mobilisent pour la culture dans nos territoires
Dans une tribune publiée par Le Monde, les maires de l’Association des Petites Villes de France (APVF), aux côtés des professionnels de La Scène Indépendante, réaffirment avec force l’importance de la culture dans les territoires à taille humaine. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, les signataires rappellent qu’investir dans la culture, c’est investir dans …
Dans une tribune publiée par Le Monde, les maires de l’Association des Petites Villes de France (APVF), aux côtés des professionnels de La Scène Indépendante, réaffirment avec force l’importance de la culture dans les territoires à taille humaine.
Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, les signataires rappellent qu’investir dans la culture, c’est investir dans la cohésion sociale, l’éducation, la santé, l’attractivité et le vivre-ensemble. Les équipements, festivals, salles de spectacles et lieux de création constituent autant de points d’ancrage essentiels pour la vitalité de nos communes et le lien entre leurs habitants.
Le spectacle vivant occupe, à ce titre, une place centrale : il rassemble, crée du commun, génère des émotions partagées, irrigue la vie locale et contribue à l’économie territoriale. Les maires et professionnels alertent sur les risques liés aux réductions budgétaires envisagées, qui pourraient fragiliser durablement cette dynamique culturelle.
Les signataires appellent ainsi le gouvernement et les parlementaires à préserver les moyens dédiés au spectacle vivant, à maintenir les engagements annoncés et à garantir un financement adapté aux besoins réels des petites villes.
La culture n’est pas une option : c’est un bien commun, un pilier de cohésion et d’émancipation, au cœur du projet des petites villes de France.
> Lire la tribune complète publiée dans Le Monde :
« Nous, élus de petites villes de France et acteurs du spectacle vivant privé, réaffirmons l’importance fondamentale de la culture dans nos territoires »

CNRACL : le Gouvernement peut sauver dès à présent les retraites des fonctionnaires territoriaux sans étrangler les collectivités
Réunies à l’occasion du 107ème Congrès des maires, les associations d’élus du bloc local ont tenu le 19 novembre, aux côtés des présidents des délégations parlementaires aux collectivités territoriales du Sénat et de l’Assemblée nationale, Bernard Delcros et Stéphane Delautrette, à exprimer d’une seule voix leur inquiétude quant aux perspectives de redressement financier de la …
Réunies à l’occasion du 107ème Congrès des maires, les associations d'élus du bloc local ont tenu le 19 novembre, aux côtés des présidents des délégations parlementaires aux collectivités territoriales du Sénat et de l’Assemblée nationale, Bernard Delcros et Stéphane Delautrette, à exprimer d’une seule voix leur inquiétude quant aux perspectives de redressement financier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et leur détermination à porter les solutions propres à garantir l’avenir de la caisse, sans étrangler les collectivités.
Une mesure brutale et injuste, imposée sans concertation
Sans dialogue préalable, le Gouvernement a décidé en janvier 2025 une hausse de 12 points sur quatre ans du taux de cotisation des employeurs territoriaux et hospitaliers. Cette mesure représentera en 2028 plus de 4,5 milliards d’euros de charges supplémentaires pour les budgets locaux, soit une hausse de 40 % des dépenses de retraites supportées par les collectivités et leurs établissements. Aucune entreprise privée ne pourrait résister à un tel choc. Nos collectivités non plus. Cette décision met directement en péril la capacité des communes et intercommunalités à assurer leurs missions de service public et à investir dans les transitions indispensables à notre pays. Elle traduit une approche purement paramétrique, qui transfère le déficit de la protection sociale vers les finances locales, sans résoudre le problème structurel du régime, alors même que la caisse a contribué à la solidarité nationale vers les autres régimes à hauteur de 100
milliards depuis 50 ans.
Un constat partagé, des solutions connues
Les inspections générales et la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale convergent pourtant sur le diagnostic comme sur les solutions à court terme, et en particulier :
• la reprise de la dette de la CNRACL par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) ;
• la révision de la formule de compensation démographique, sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (COR) ;
• l’alignement sur le régime général du financement des avantages spécifiques relevant de la politique familiale et de l’invalidité.
Ces pistes sont documentées, partagées, prêtes à être mises en œuvre. Le Gouvernement ne peut plus se contenter d’augmenter les cotisations ; il doit désormais agir sur ces leviers.
Un appel solennel au Gouvernement et au Parlement
Les associations d’élus demandent l’ouverture immédiate d’un véritable espace de concertation, afin de construire une réforme pérenne de la CNRACL qui sauvegarde les retraites de nos agents sans étrangler les budgets locaux. Elles appellent le Gouvernement à intégrer dans le PLFSS 2026 les mesures urgentes de gestion nécessaires au redressement du régime, telles qu’elles découlent des rapports déjà existants et en soutenant les amendements déposés par les délégations parlementaires aux collectivités.
Enfin, le temps que ces mesures prennent effet et qu’un véritable dialogue s’installe, elles réclament le gel de la hausse des cotisations prévue pour 2026.
Télécharger le communiqué de presse de la Coordination des employeurs territoriaux en cliquant ici.

Sécurité du quotidien : les associations d’élus appellent à renforcer la complémentarité avec l’État
À l’approche des élections municipales, la sécurité s’impose comme une préoccupation majeure des habitants. Dans un communiqué commun, les membres du Collectif inter-associatif des élus pour la sécurité et la prévention (CIAESP) rappellent que si les maires jouent un rôle essentiel pour la prévention de la délinquance et la tranquillité publique, leur action demeure complémentaire …
À l’approche des élections municipales, la sécurité s’impose comme une préoccupation majeure des habitants. Dans un communiqué commun, les membres du Collectif inter-associatif des élus pour la sécurité et la prévention (CIAESP) rappellent que si les maires jouent un rôle essentiel pour la prévention de la délinquance et la tranquillité publique, leur action demeure complémentaire de la mission régalienne exercée par l’État. Jean-Pierre Bouquet, Membre du Bureau, Référent sécurité de l'APVF représentait les petites villes.
À l’issue de l'échange autour de la sécurité organisé au Congrès des maires le 18 novembre 2025, plusieurs enjeux prioritaires ont été identifiés : un meilleur partage des données de délinquance, une coopération renforcée avec les forces de sécurité intérieure, une association plus étroite des élus aux stratégies territoriales, ainsi qu’un accompagnement financier adapté.
Modernisation des polices municipales : une attente forte des élus
Le CIAESP souligne l’importance d’avancer rapidement sur le projet de loi de modernisation des polices municipales et des gardes-champêtres, indispensable pour adapter leurs missions, leurs moyens – notamment numériques – et leur coordination avec l’État. Les élus mettent toutefois en garde : cette modernisation ne doit en aucun cas conduire à un désengagement de l’État dans la sécurité du quotidien.
Alors que le texte vient d’être déposé au Sénat, l’absence de calendrier d’examen fait craindre un renvoi après les municipales, au détriment des collectivités.
Prévention de la délinquance : un pilier négligé
Les membres du CIAESP alertent également sur l’affaiblissement de la prévention de la délinquance, pourtant cœur de l’action locale, notamment face aux fragilités psychiques des jeunes, à l’errance, aux radicalisations, aux violences intrafamiliales ou encore à la traite des êtres humains.
Le collectif appelle à relancer la Stratégie nationale de prévention de la délinquance (SNPD), aujourd’hui à l’arrêt, et demande une véritable concertation avec les associations d’élus pour bâtir une stratégie pragmatique laissant aux territoires une marge d’action.

« Gare à l’asphyxie de nos communes » : les maires de l’APVF sonnent l’alarme au Congrès des maires
Réunis en salle Nation à l’occasion du 107ᵉ Congrès des maires, les membres du Conseil d’administration de l’Association des Petites Villes de France (APVF) ont exprimé une préoccupation unanime : l’avenir financier des petites communes est en jeu. Dans un climat de grande franchise et d’inquiétude partagée, les maires présents ont rappelé combien les budgets …
Réunis en salle Nation à l’occasion du 107ᵉ Congrès des maires, les membres du Conseil d’administration de l’Association des Petites Villes de France (APVF) ont exprimé une préoccupation unanime : l’avenir financier des petites communes est en jeu. Dans un climat de grande franchise et d’inquiétude partagée, les maires présents ont rappelé combien les budgets locaux, déjà fragilisés par les crises successives, ne peuvent supporter une nouvelle vague de contraintes sans mettre en péril l’action publique de proximité.
Sous la présidence de Christophe Bouillon, maire de Barentin, l’APVF a adopté une motion forte, dénonçant la pression budgétaire imposée par le projet de loi de finances 2026. Les élus pointent un effort demandé de 4,7 milliards d’euros, jugé « injuste et disproportionné », et alertent sur les conséquences directes pour la capacité d’investissement, la transition écologique et la qualité des services publics locaux.
La motion détaille les mesures les plus problématiques notamment le doublement du DILICO, la baisse des compensations fiscales ou encore le gel de la dynamique de TVA et appelle gouvernement et Parlement à revoir en profondeur le texte. L’APVF propose que l’effort demandé aux collectivités soit ramené à 2 milliards d’euros, comme proposé par le Sénat, et que le DILICO soit réduit de moitié.
Au-delà du budget, les maires réaffirment aussi leurs attentes en matière de décentralisation, de clarification des compétences et de confiance retrouvée entre l’État et les territoires.
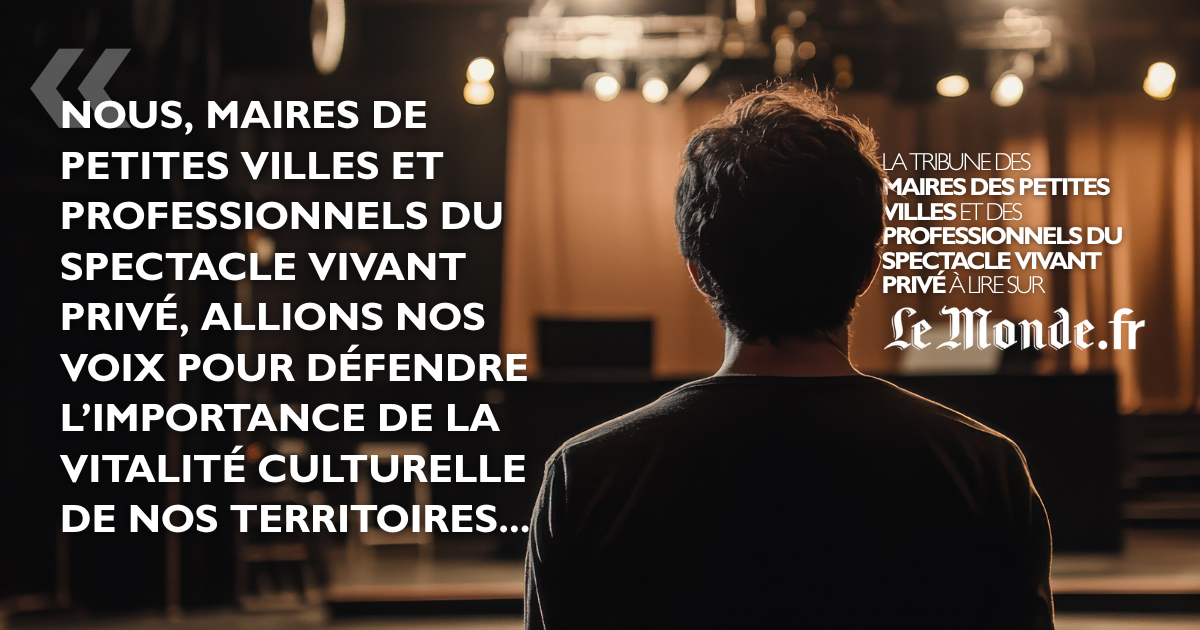
« Nous, élus de petites villes de France et acteurs du spectacle vivant privé, réaffirmons l’importance fondamentale de la culture dans nos territoires » - SIGNATAIRES
Une tribune de l’APVF et de la Scène Indépendante à lire sur Le Monde.fr à lire sur Le Monde.fr Premiers signataires Christophe Bouillon, Président de l’APVF, Maire de Barentin (76), ancien Député de Seine-Maritime. Fabrice Roux, Président de « La Scène Indépendante », Syndicat national des entrepreneurs de spectacles privés, directeur-gérant de la salle …
Une tribune de l'APVF et de la Scène Indépendante à lire sur Le Monde.fr
Premiers signataires
Christophe Bouillon, Président de l’APVF, Maire de Barentin (76), ancien Député de Seine-Maritime.
Fabrice Roux, Président de « La Scène Indépendante », Syndicat national des entrepreneurs de spectacles privés, directeur-gérant de la salle de musique L’Archipel (Paris), directeur du Théâtre des Vents (Avignon).
| Nathalie Nieson, Vice-présidente trésorière de l’APVF, Maire de Bourg-de-Péage (26).
Philippe Laurent, Vice-président de l’APVF, Maire de Sceaux, Président d’honneur de la FNCC (92).
Pierre-Alain Roiron, Vice-Président de l’APVF, Sénateur d’Indre-et-Loire, ancien Maire de Langeais (37).
Patrick Malavieille, Vice-président Culture du Département du Gard, ancien Maire de La Grand-Combe (30), ancien Député du Gard.
Pierre Aschieri, Maire de Mouans-Sartoux (06). Benoît Baranger, Maire de Bourgueil (37). Eric Berlivet, Maire de Roche-la-Molière (42). Charlotte Blandiot-Faride, Maire de Mitry-Mory (77). Jean-Michel Catelinois, Maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux (26). Jean-Pierre Chateau, Maire de Guérigny (58). Romain Colas, Maire de Boussy Saint-Antoine (91). Bastien Coriton, Maire de Rives-en-Seine (76). Daniel Cornalba, Maire de L’Etang-la-Ville (78). Hervé Chérubini, Maire de Saint-Rémy-de-Provence (13). Jean-Pierre de Faria, Maire de Saint-Ambroix (30). Benjamin Dumortier, Maire de Cysoing (59). Sébastien Eugène, Maire de Château-Thierry (02). Fabienne Fonteneau, Maire de Saint-Denis-de-Pile (33). Anne Gallo-Kerleau, Maire de Saint-Avé (56). Jérôme Guilhem, Maire de Langon (33). Eric Houlley, Maire de Lure (70). Didier Lechien, Maire de Dinan (35). Philippe Le Goff, Maire de Guingamp (22). Frédéric Leveillé, Maire d'Argentan (61). Christophe Lubac, Maire de Ramonville-Saint-Agne (31). Claude Morel, Maire de Caumont-sur-Durance et Vice-Président du Grand Avignon. Jean-Michel Perret, Maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas (30). Brice Ravier, Maire d'Amboise (37). Christophe Rouillon, Maire de Coulaines (72). Stéphan Rossignol, Maire de La-Grande-Motte (34). Igor Semo, Maire de Saint-Maurice (94). Fabrice Verdier, Maire de Chateaudun (28). Anthony Zilio, Maire de Bollène (84). |
Matthieu DROUOT, Vice-président Musique de La Scène Indépendante. PDG/CEO de Gérard Drouot Productions, organisateur du festival "Heavy week-end". Frédéric BIESSY, Vice-président Théâtre de La Scène Indépendante. Producteur. Directeur général de La Scala Paris, La Scala Provence, La Scala Music, Scala Productions & Tournées. Fondateur de l’ESAR. Valentine MABILLE, Vice-présidente Humour de La Scène Indépendante. Productrice Fourchette Suisse Production. Marion GENDRON-DURAND, Secrétaire générale de La Scène Indépendante. Productrice Robin Production. François VOLARD, Trésorier de La Scène Indépendante. Producteur Acte 2. Loïc BONNET, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Directeur des Théâtres à l’Ouest (Rouen, Caen, Auray, Lyon). Producteur Complètement à l’Ouest. Président des TPR – Théâtres Privés en Région. Céline GARNIER, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Directrice générale du Zénith d’Amiens Métropole. David HAMELIN, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Responsable d’exploitation de l’Alhambra Paris. Christophe LACAU, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Producteur La Petite Manhattan. Jean-Claude LANDE, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Producteur Marilu Production. Hugues LEFORESTIER, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Auteur, comédien et producteur (Compagnie Fracasse). Délégué général des Molières. Guy MARSEGUERRA, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Directeur du Théâtre Sébastopol (Lille). Producteur Verone Productions. Damien NOUGAREDE, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Producteur Backstage Event / Backstage Concept. Christophe SEGURA, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Directeur de La Comédie Bastille (Paris). Producteur Marilu Production. Jessie VARIN, Membre du comité de direction de La Scène Indépendante. Directrice artistique de La Nouvelle Seine (Paris). Productrice. Cofondatrice du Festival "Plus fort.es ensemble". Mathilde BOURBIN, Comédienne, autrice, metteuse en scène. Signataire pour le Collectif Attention Fragile, organisateur du festival "Made in Sceaux". Productrice d’actions culturelles. Jean-Philippe DAGUERRE, Auteur, metteur en scène. Directeur artistique de la Compagnie Le Grenier de Babouchka. |

Comment l’application mobile a transformé le budget participatif d’une commune de 10 000 habitants ?
Le Beausset, commune varoise de 10 000 habitants, a su faire évoluer son budget participatif grâce à une stratégie numérique efficace. Interview de Marie Vidal-Michel, conseillère municipale en charge du budget participatif de cette commune, membre de l’APVF. Pourquoi avoir misé sur votre application mobile pour accompagner le budget participatif ? Nous avons rapidement compris …
Le Beausset, commune varoise de 10 000 habitants, a su faire évoluer son budget participatif grâce à une stratégie numérique efficace. Interview de Marie Vidal-Michel, conseillère municipale en charge du budget participatif de cette commune, membre de l’APVF.
Pourquoi avoir misé sur votre application mobile pour accompagner le budget participatif ?
Nous avons rapidement compris que pour toucher un maximum de citoyens, il fallait aller là où ils sont : sur leur smartphone. L’application mobile Lumiplan nous permet de centraliser toutes les étapes du budget participatif, du dépôt des projets jusqu’au vote final. C’est un outil à la fois large et de proximité qui vient renforcer nos canaux physiques utilisés pour informer la population et leur permettre de participer (magazine municipal et votes papier).
Quels résultats concrets avez-vous observés ?
Aujourd’hui, 70% des foyers ont téléchargé l’application mobile. En 2024 et 2025, plus de 50 % des votes ont été réalisés via l’application. C’est clairement le canal principal de participation. Sans elle, nous aurions eu bien moins de retours.
Comment l’application facilite-t-elle le processus ?
Elle nous permet de :
- Favoriser la participation pour le dépôt des projets et les votes,
- Expliquer les règles du budget participatif,
- Centraliser les votes,
- Envoyer des notifications pour relancer la participation,
- Créer une tuile dédiée mise à jour régulièrement pour que les habitants puissent suivre les différentes étapes.
Quels types de projets ont été retenus grâce à cette démarche ?
Nous avons vu une belle évolution : aire de musculation pour adultes, aire de jeux pour enfants et espace de détente familial au City stade, végétalisation du centre ancien, parc pour les promeneurs et leurs animaux de compagnie… Des projets concrets, portés par les habitants, qui répondent à leurs besoins.
Comment gérez-vous la validation des projets ?
Les habitants déposent un dossier entre janvier et février. Un comité d’élus examine les propositions en mars, suivi d’un comité technique constitué d’agents. Nous vérifions la faisabilité, le respect de l’enveloppe (passée de 40 000€ en 2024 à 50 000€ en 2025), et l’intérêt général. Certains projets non retenus sont réorientés vers d’autres dispositifs municipaux car la majorité des projets proposés sont pertinents.
Quels autres usages faites-vous de l’application pour favoriser la participation citoyenne ?
Nous l’utilisons aussi pour des sondages. Par exemple, pour choisir le nom du stade de foot et d’athlétisme. Nous sommes aussi très fiers de la possibilité qu’ont désormais les citoyens de faire remonter des signalements de terrain quotidiennement. C’est un excellent outil pour prendre le pouls de la population. Nous ne pouvons être partout, l’application nous aide à mieux entretenir notre commune.
Pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux comme Facebook ?
Facebook ne garantit pas que les votants soient des résidents. Avec l’application, nous avons une authentification plus fiable. Cela préserve l’intégrité démocratique du vote.
Quel conseil donneriez-vous aux communes qui hésitent à franchir le pas ?
Lancez-vous ! L’application mobile est utile, constructive et favorise la proximité. Elle renforce le lien entre élus et citoyens, tout en dynamisant la vie locale. Au Beausset, elle fait partie des réussites incontestables de notre mandat !

Réforme des fonds de Cohésion : la Confédération des Petites Villes Européennes lance l'alerte !
La Confédération des Petites Villes de l’Union Européenne (CTME), dont l’Association des Petites Villes de France (APVF) est fondatrice, s’est réunie à Paris le 6 novembre dernier. Christophe Rouillon, maire de Coulaines, membre du Bureau de l’APVF en a été élu Président. Outre l’élection de Christophe Rouillon, maire de Coulaines, à la présidence de la …
La Confédération des Petites Villes de l'Union Européenne (CTME), dont l'Association des Petites Villes de France (APVF) est fondatrice, s'est réunie à Paris le 6 novembre dernier. Christophe Rouillon, maire de Coulaines, membre du Bureau de l'APVF en a été élu Président.
Outre l'élection de Christophe Rouillon, maire de Coulaines, à la présidence de la Confédération des Petites Villes de l'Union Européenne (CTME), cette rencontre a été l'occasion d'accueillir un nouveau membre avec l'Union Croate des Municipalités. M. Božo Lasić, vice-président et secrétaire général de l'Union croate des municipalités, est ainsi devenu vice-président de la CTME.
Le Vice-Président du Sénat, Loïc Hervé, Président Délégué de l'APVF, ainsi que Christophe Chaillou, Sénateur du Loiret, membre du Bureau de l'APVF, ont également accueillis les membres de la Confédération au Sénat.
Cette réunion a également été l'occasion de prendre une position ferme sur la réforme de la politique de cohésion présentée par la Commission européenne. En effet, la fusion des fonds structurels européens existants en plans de partenariat nationaux et régionaux entrave le modèle européen de développement social et territorial. Non seulement cette réforme constitue un levier pour réduire le financement global du développement territorial, mais la recentralisation sous-jacente de ces financements menace directement le principe de subsidiarité.
A l'issue des échanges, la Confédération des Petites Villes de l'Union Européenne a adopté les demandes suivantes auprès de la Commission :
- De garantir que le budget de la politique de cohésion après 2027 ne sera pas réduit et de maintenir la part actuelle de ses allocations dans la structure du futur budget européen. La visibilité et un engagement à long terme sont nécessaires pour un investissement local durable.
- De respecter le principe de subsidiarité en maintenant une gestion décentralisée des fonds de cohésion par les autorités locales, et d'accroître le rôle des villes et des municipalités dans la gouvernance afin que les besoins de tous les territoires, urbains, ruraux et d'outre-mer, soient pris en compte. Les libertés locales dans toute l'Europe sont en jeu.
- Maintenir les priorités stratégiques et territoriales des principaux instruments financiers de la politique de cohésion, en particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE+), ainsi que le programme LEADER.
- Supprimer tous les obstacles administratifs et réglementaires qui pèsent lourdement sur les promoteurs de projets, en particulier dans les petites villes et les communes.
La Confédération des Petites Villes de l'Union Européenne rassemble les associations représentatives des petites villes de France, d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie, de Roumanie et désormais de Croatie.

PLF 2026 : Le cout n'a jamais été aussi élevé pour les collectivités
L’APVF, représentée par Daniel Cornalba, maire de L’Étang-la-Ville et membre du Bureau, a été auditionnée dans le cadre d’une table ronde réunissant les associations représentatives des communes, par les rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » du Sénat, M. Sautarel et Mme Briquet. À cette occasion, l’APVF a rappelé que …
L’APVF, représentée par Daniel Cornalba, maire de L’Étang-la-Ville et membre du Bureau, a été auditionnée dans le cadre d’une table ronde réunissant les associations représentatives des communes, par les rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » du Sénat, M. Sautarel et Mme Briquet.
À cette occasion, l’APVF a rappelé que les petites villes connaissent depuis plusieurs années une chute nette et continue de leur capacité de financement et de leur fonds de roulement, entraînant un besoin de financement depuis 2023, et ce pour la troisième année consécutive :
– entre 2021 et 2024, la capacité de financement des petites villes est passée de 1,3 milliard d’euros à – 500 millions d’euros (source : OFGL) ;
– sur la même période, le fonds de roulement est passé de 1 milliard d’euros à – 648 millions d’euros (source : OFGL).
Pour 2026, les tendances devraient rester similaires, voire s’aggraver si le PLF 2026 n’est pas profondément revu. L’APVF a alerté sur les conséquences majeures qu’auraient Dilico 2 et la baisse du prélèvement sur les recettes liées aux locaux industriels. Les calculs réalisés pour les membres de son Conseil d’administration montrent que :
– Dilico 2 représenterait 8,107 millions d’euros de pertes ;
– la baisse des allocations de compensation atteindrait 14,86 millions d’euros, sans aucune pondération ni dispositif d’atténuation.
De nombreux élus de petites villes soulignent qu’ils sont actuellement engagés dans un rattrapage de leurs investissements, après les retards provoqués par les crises sanitaire et énergétique.
L’APVF continuera de sensibiliser le gouvernement et les parlementaires. Si la suppression de Dilico 2 n’est pas obtenue, la mesure doit a minima être réduite de moitié. L’association demande également d’annuler la baisse de 25 % de la compensation de l’État liée à l’abattement de CFE et de TFPB pour les locaux industriels, une mesure brutale qui touche plus de la moitié des communes, en particulier les petites villes industrielles.
L’APVF appelle enfin à une revalorisation de la DGF du bloc communal sur la base des prévisions d’inflation, ainsi qu’à la sortie de la DRCTP du champ des variables d’ajustement, cette dernière pesant 1,74 million d’euros pour les communes représentées au sein de son Conseil d’administration.
Dans son intervention, Daniel Cornalba a alerté sur les risques pesant sur le bon fonctionnement des services publics et sur la diminution de la capacité d’action des collectivités territoriales, notamment en matière de logement. Il a souligné que des efforts trop brutaux pourraient fragiliser la France. Il a également insisté sur le besoin de visibilité et de prévisibilité pour les collectivités, confrontées à des règles budgétaires qui évoluent chaque année.

Accès aux soins : feu vert des députés pour le lancement du réseau France Santé
L’Assemblée nationale a adopté la création du réseau France Santé, nouvelle initiative destinée à structurer l’offre de soins de proximité autour de critères renforcés de disponibilité et d’accessibilité. Malgré un investissement de 130 millions d’euros et un objectif de 5 000 structures labellisées à l’horizon 2027, plusieurs groupes parlementaires estiment que cette réponse demeure insuffisante …
L’Assemblée nationale a adopté la création du réseau France Santé, nouvelle initiative destinée à structurer l’offre de soins de proximité autour de critères renforcés de disponibilité et d’accessibilité. Malgré un investissement de 130 millions d’euros et un objectif de 5 000 structures labellisées à l’horizon 2027, plusieurs groupes parlementaires estiment que cette réponse demeure insuffisante face à la progression des déserts médicaux.
Les députés ont validé ce week-end, dans le cadre de l’examen du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), la mise en place du réseau France Santé, présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu comme l’un des leviers du plan gouvernemental pour améliorer l’accès aux soins dans tous les territoires. Le dispositif repose sur une logique de labellisation de structures locales – maisons et centres de santé principalement – auxquelles pourraient s’ajouter, dans certains territoires peu dotés, des pharmacies engagées dans des dispositifs de téléconsultation.
Pour être reconnues « France Santé », ces structures devront respecter un socle d’exigences : présence d’un médecin et d’une infirmière, absence de dépassements d’honoraires, ouverture minimale de cinq jours, et capacité à offrir un rendez-vous en 48 heures à moins de 30 minutes du domicile. Chaque structure certifiée percevra un forfait annuel d’environ 50 000 euros, sur une enveloppe totale de 130 millions d’euros. L’exécutif fixe un calendrier ambitieux : 2 000 structures d’ici l’été 2026, et 5 000 en 2027.
Le gouvernement met en avant un objectif de lisibilité de l’offre pour les usagers, dans un paysage local souvent difficile à appréhender. Toutefois, la mesure fait débat. Si certains élus saluent une étape positive, les groupes de gauche soulignent que la labellisation de structures déjà existantes ne crée pas de nouvelles forces médicales et ne répond donc pas au cœur du problème. Plusieurs parlementaires alertent également sur le risque d’un élargissement trop large du label, intégrant acteurs publics, privés non lucratifs ou lucratifs, susceptible d’alimenter une logique de marchandisation du soin.

PLF 2026 : l’APVF et les associations d’élus mobilisées pour protéger la cohésion sociale
Alors que le débat parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2026 se poursuit, l’APVF, aux côtés des autres associations d’élus alerte sur des mesures budgétaires susceptibles d’affaiblir la politique de la ville et la cohésion des territoires. Les associations pointent notamment la hausse des cotisations retraite des agents locaux, la baisse des …
Alors que le débat parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2026 se poursuit, l’APVF, aux côtés des autres associations d’élus alerte sur des mesures budgétaires susceptibles d’affaiblir la politique de la ville et la cohésion des territoires.
Les associations pointent notamment la hausse des cotisations retraite des agents locaux, la baisse des dotations aux communes, ainsi que la réduction des crédits pour des dispositifs structurants tels que missions locales, Pass Sport, Pass Culture ou Colos apprenantes. Elles expriment aussi leurs inquiétudes sur le regroupement de plusieurs dotations au sein d’un Fonds d’investissement unique, pouvant nuire à la visibilité des crédits destinés aux quartiers prioritaires.
L’APVF appelle le Gouvernement et le Parlement à consolider les moyens des communes, maintenir une dotation politique de la ville identifiable et renforcer les dispositifs efficaces pour garantir l’égalité de services et de droits sur l’ensemble du territoire.
Pour lire le communiqué complet, cliquez ici.
