ESPACE MEMBRE

Elections législatives : le choix des assesseurs
L’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » et l’article R. 2121-5 du même code précise que, pour obtenir cette démission d’office, le …
L’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » et l’article R. 2121-5 du même code précise que, pour obtenir cette démission d’office, le maire doit saisir le tribunal dans le délai d’un mois après avoir constaté le refus de l’élu de remplir ses fonctions. Cette procédure peut-elle être engagée par un maire confronté au refus d’un conseiller municipal d’assurer la présidence ou les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote lors des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet 2024 ?
Une obligation légale
En vertu de l’article R.43 du Code électoral, « les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau ». L’usage du mode indicatif (« sont présidés ») établit le caractère obligatoire d’une telle présidence, à laquelle les élus municipaux ne sauraient, sauf excuse valable, se soustraire.
Le Conseil d’État a ainsi jugé que « la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu des dispositions de l’article R.43 du Code électoral, constitue l’une des fonctions dévolues à ces élus » par la loi (CE, 21 octobre 1992, n° 138437) ; en conséquence, un conseiller municipal désigné par le maire pour présider un bureau de vote et qui écrit au maire : « Je n’assurerai pas la présidence du bureau de vote le dimanche 22 mars, quelle que soit la tranche d’horaire », sans justifier ce refus par une excuse quelconque, doit être considéré comme ayant expressément déclaré qu’il refuse d’exercer l’une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux et encourt, par conséquent, la perte de son mandat ; c’est donc à bon droit qu’il a été démis d’office de son mandat de conseiller municipal (même arrêt).
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé qu’il en allait de même de l’exercice de la fonction d’assesseur d’un bureau, sur désignation du maire.
Ainsi, en vue des élections régionales des 14 et 21 mars 2010, un maire avait désigné une conseillère municipale, dixième dans l’ordre du tableau des conseillers municipaux de la commune, comme assesseur d’un bureau de vote. Or, cette élue ne s’est présentée au bureau de vote ni au premier tour, ni au second tour et, en conséquence, le maire a demandé au tribunal administratif de déclarer l’élue démissionnaire d’office.
Dans un premier temps, la cour administrative d’appel de Versailles avait considéré que « si un conseiller municipal peut être amené à participer au fonctionnement d’un bureau de vote en tant qu’assesseur supplémentaire sur désignation du maire, cette fonction, qui incombe au premier chef aux électeurs du département et n’est pas inhérente à l’exercice du mandat, ne peut être regardée comme lui étant dévolue par la loi au sens de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales et justifiant, en cas de refus de l’exercer, la mise en œuvre de la procédure de démission qu’il prévoit »( CAA Versailles, 3 mars 2011, n° 10VE02001). Mais le Conseil d’État a annulé cet arrêt, en adoptant une position radicalement contraire.
Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’en vertu de l’article R.44 du Code électoral, si « chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département », par ailleurs, « des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ». Pour la haute juridiction, il résulte de ces dispositions que « la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales » et que « dès lors, en jugeant que cette fonction n’était pas inhérente à l’exercice du mandat de membre du conseil municipal et ne pouvait être regardée comme lui étant dévolue par les lois au sens de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit » (CE, 26 novembre 2012, n°349510).
Les précautions à prendre par le maire
La démission d’un conseiller municipal ne peut être prononcée par le tribunal administratif que s’il est établi que l’élu aurait refusé d’exercer une fonction qui lui est dévolue par la loi et que ce refus n’est pas justifié par une excuse valable, les règles de priorité pour la composition des bureaux de vote devant, par ailleurs, être prises en compte.
Le refus du conseiller municipal doit avoir été exprimé de façon expresse ou, à défaut, donner lieu à un avertissement préalable de la part de l’autorité chargée de la convocation (CE, 20 février 1985, n° 62778).
C’est au maire qu’il appartient d’établir la preuve de la réception de la demande adressée au conseiller municipal et de l’existence d’un refus formulé de manière expresse par l’intéressé d’exercer les fonctions d’assesseur (CAA Douai, 25 novembre 2010, n° 10DA00587).
Le juge administratif recherche, en outre, si le conseiller municipal auquel il a été demandé d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote a été désigné conformément à l’ordre du tableau (CAA Bordeaux, 15 février 2011, n° 10BA01311).
La Cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé qu’il appartient au maire de prouver, lorsqu’il demande à un conseiller municipal de présider un bureau de vote, qu’il a respecté l’ordre du tableau : « d’une part, le maire n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait, pour désigner l’intéressé en qualité de président de bureau de vote, respecté l’ordre du tableau ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que seulement quatre bureaux de vote devant être organisés, à l’occasion de cette élection cantonale, sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, d’autres membres du conseil municipal, qui en compte trente-neuf, auraient pu être désignés alors même que M. X avait exprimé le souhait de se rendre dans les différents bureaux en sa qualité de conseiller général ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme justifiant, au sens des dispositions sus-rappelées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, d’une excuse valable résultant des manœuvres du maire tendant à le placer dans la situation où il pourrait être déclaré démissionnaire d’office» (CAA Versailles, 16 juillet 2012, n° 11VE02571).
Les excuses valables du conseiller
Lorsque l’existence d’un refus ou l’abstention persistante d’un conseiller municipal après avertissement est établi, le juge doit également rechercher si l’intéressé justifie d’une excuse valable.
Cette excuse valable est établie lorsqu’est produit un certificat médical attestant de l’impossibilité, pour le conseiller municipal, d’assurer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote (CAA Versailles, 30 décembre 2004, n° 04VE01719).
Le juge administratif admet la production, en cours d’instance, de justificatifs établissant l’impossibilité pour le conseiller municipal d’exercer ses fonctions, alors même qu’ils n’auraient pas été adressés à l’autorité territoriale.
Dans un jugement du 3 juin 2010, le Tribunal administratif de Melun a jugé qu’un conseiller municipal qui avait informé oralement le secrétariat de la mairie qu’il ne pouvait exercer ses fonctions d’assesseur en raison de l’exercice de son activité professionnelle le dimanche justifie également d’une excuse valable : « Considérant qu’il résulte également de l’instruction que le maire de Courpalay a, en vue de l’organisation du second tour des élections régionales le 21 mars 2010, adressé à M. Y une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant d’être présent de 12h à 14h au bureau de vote ; que M. Y a averti le secrétariat de la mairie par téléphone de son refus d’être présent pour des « raisons personnelles et professionnelles » ; que toutefois, M. Y fait valoir en défense sans être nullement contredit, qu’en sa qualité de commerçant, il travaille le dimanche et ne peut pas se permettre de fermer son commerce ; qu’il fait également valoir que son épouse venait d’accoucher le 11 mars 2010 et qu’il souhaitait pouvoir être auprès d’elle ; qu’ainsi, M. Y doit être regardé comme justifiant d’une excuse valable au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que par conséquent, la requête du maire de Courpalay tendant à faire déclarer M. X Y démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Courpalay doit être rejetée » (TA Melun, 3 juin 2010, n° 1002773).
La solution retenue dans ce jugement ne peut qu’être approuvée puisque l’exercice d’une activité professionnelle à laquelle un conseiller municipal ne peut se soustraire constitue une cause objective le mettant dans l’impossibilité d’assurer les fonctions d’assesseur. Si l’excuse est valable concernant un commerçant – qui est pourtant en principe libre de ses décisions d’ouvrir ou non son commerce le jour de l’élection – elle l’est également, a fortiori, lorsqu’elle est invoquée par un salarié, qui est, lui, placé dans une position de subordination vis-à-vis de son employeur.
Le Conseil d’État a, par ailleurs, jugé que le conseiller municipal justifie d’une excuse valable lorsqu’il établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou des comportements du maire destinés à provoquer le refus d’exercer des fonctions de président de bureau de vote : « Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code ; qu’il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; que peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse pour l’application des dispositions susrappelées un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office » (CE, 21 mars 2007, n° 278437).
L’insistance d’un maire à exiger d’un conseiller municipal sa participation à un bureau de vote, à une date où celui-ci devait participer à une manifestation familiale à caractère exceptionnel, alors qu’aucune difficulté pour l’organisation du scrutin n’existait compte tenu du nombre de de volontaires s’étant manifestés constitue ainsi une manœuvre de nature à caractériser une excuse valable de l’intéressé (CAA Nantes, 2 octobre 2007, n° 07NT01704).
Les principes relatifs à la composition des bureaux de vote doivent également être pris en compte. L’existence de manœuvres de nature à caractériser une excuse valable est établie lorsque le maire persiste à exiger d’un conseiller municipal qui avait signalé son absence le jour du scrutin, sa participation en qualité d’assesseur d’un bureau de vote, alors qu’il n’existait aucune difficulté d’organisation et de fonctionnement et que le manque de volontaires pour assurer cette fonction n’était pas démontré (CAA Nantes, 2 octobre 2007, n° 07NT01704).
Philippe Bluteau, Avocat au Barreau de Paris
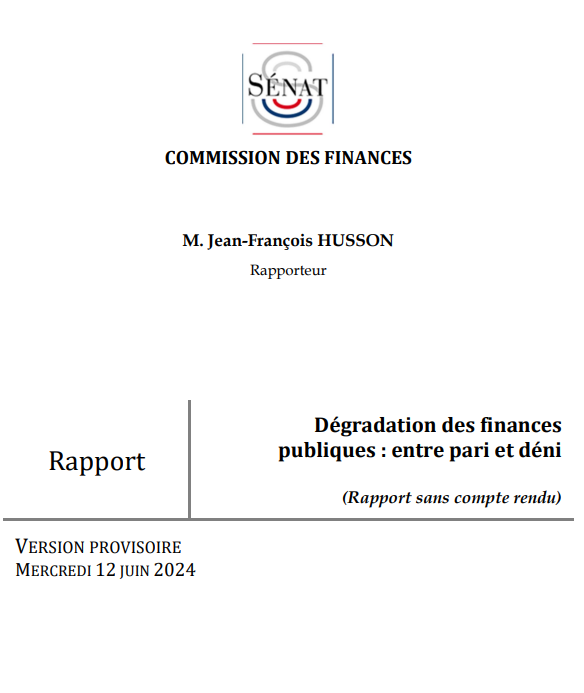
Les collectivités locales ne sont pas responsables de la dégradation des comptes publics !
Suite à la révélation par voie de presse, le 20 mars dernier, d’un déficit public susceptible de s’établir à 5,6 % du PIB en 2023, contre une prévision en fin d’année dernière de 4,9 %, la Commission des finances du Sénat a lancé une mission d’information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023. Le …
Suite à la révélation par voie de presse, le 20 mars dernier, d’un déficit public susceptible de s’établir à 5,6 % du PIB en 2023, contre une prévision en fin d’année dernière de 4,9 %, la Commission des finances du Sénat a lancé une mission d’information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023. Le rapport, passé presque inaperçu en raison de l’actualité, a été rendu public le 13 juin. Voici les principaux constats établis par son rapporteur, Jean-François Husson.
Un niveau de déficit inédit en 2023 porté essentiellement par l’Etat
Le déficit public entre 2017 et 2023 a connu une augmentation massive, passant de 3,4 % (et même 2,3 % en 2018) à 5,5 % du PIB, et, en milliards d’euros, de 77 à 154 milliards d’euros, soit un doublement.
Le rapport évoque un niveau « inattendu » et « inédit » hors période de crise, avec des répercussions en 2024.
Cette évolution reposerait, en outre, essentiellement sur l’Etat et ses opérateurs. Par conséquent, le rapport considère qu’il est « éminemment contestable de rendre les collectivités territoriales responsables de la dégradation des comptes publics ».
Des écarts entre prévisions et exécution liés à l’atonie des recettes
L’écart de 0,6 point de PIB entre les prévisions (- 4,9 %) et le solde exécuté (- 5,5 %) est « inédit » : sur les 25 dernières années, un tel écart n’a été observé qu’en 2008, lors de la crise financière.
Alors qu’en 2008, cet écart s’expliquait par une erreur de prévision de croissance (celle-ci s’étant élevée à + 0,9 % en 2023, proche du + 1 % prévu), « mais à un niveau de recettes plus faible qu’espéré. »
Le déficit budgétaire de l’État, prévu à 164,9 milliards d’euros par la loi de finance initiale pour 2023 a finalement été de 173,0 milliards d’euros en exécution, soit 8 milliards de plus que prévu initialement. Cela correspond exactement à la moins-value constatée sur les recettes par rapport à la prévision de fin d’année : - 7,8 milliards d’euros.
Dans le détail, plusieurs recettes fiscales du budget de l’Etat auraient mal été estimées, c’est le cas de la contribution sur la rente inframarginale (CRIM) de la production d’électricité et de l’impôt sur les sociétés (IS). Dans une moindre mesure, la tendance baissière des DMTO au bénéfice des collectivités, a également été sous-estimée.
Une répercussion attendue pour 2024
Selon le rapport, cette forte dégradation du déficit pour 2023 aura, du fait d’un effet base, un impact important sur l’année 2024. En particulier, si les recettes ont été moindre qu’attendues en 2023, c’est que la base taxable sur laquelle elles sont assises a évolué moins vite que prévue et que, conséquemment, elle sera également moins large que prévue pour 2024.
L’évolution des recettes est toujours tributaire de la dimension cyclique de l’élasticité des prélèvements obligatoires au PIB, évaluée pour le moment à 0,8 pour 2024, mais soumise à de fortes incertitudes. Le rapport donne l’exemple suivant : le mauvais résultat sur l’impôt sur les sociétés en 2023 permet d’ores et déjà de craindre un produit de cet impôt inférieur aux prévisions.
Téléchargez le rapport complet en cliquant ici.
Téléchargez la synthèse en cliquant ici.
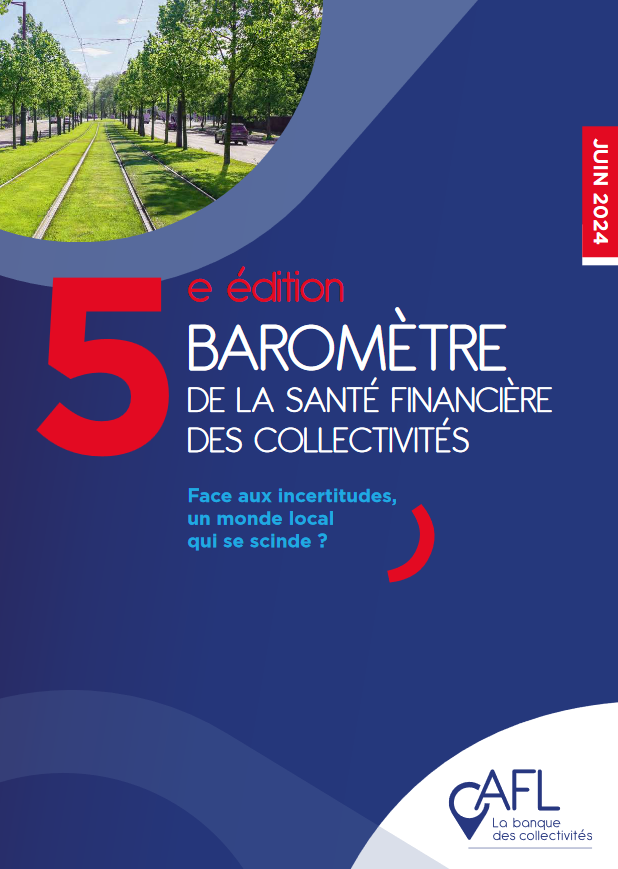
Baromètre financier de l'AFL : la résistance du bloc local
L’Agence France Locale (AFL), partenaire de l’APVF, a publié son baromètre financier pour l’année 2024. En dépit d’une conjoncture difficile, le bloc local résiste. Les collectivités en 2 blocs Premier enseignement du baromètre 2024 sur l’état financier des collectivités : le bloc local, constitué des communes et de leurs intercommunalités, résistent mieux financièrement que les …
L'Agence France Locale (AFL), partenaire de l'APVF, a publié son baromètre financier pour l'année 2024. En dépit d'une conjoncture difficile, le bloc local résiste.
Les collectivités en 2 blocs
Premier enseignement du baromètre 2024 sur l'état financier des collectivités : le bloc local, constitué des communes et de leurs intercommunalités, résistent mieux financièrement que les départements et les régions. Lorsque l'on compare leur "note financière" - la note financière est l'indicateur utilisé par l'AFL ; il prend en compte la solvabilité, l'endettement et les marges de manœuvre financières de la collectivité étudiée - la note moyenne des communes est en progression, ce qui atteste de leur solidité, tandis que celle des départements chute fortement.
Les contraintes financières sur les collectivités
L'AFL identifie plusieurs facteurs ayant contribué au "stress" sur les finances locales. L'inflation a continué à peser en 2023 sur les dépenses générales des collectivités. De façon plus général, c'est l'ensemble des dépenses de fonctionnement qui ont cru, du fait, par exemple, de la revalorisation du point d'indice.
Néanmoins, du point de vue des recettes, la situation est beaucoup plus disparate. Ainsi, le bloc local a pu bénéficier de la revalorisation des bases, ainsi que des effets de l'inflation. En revanche, les départements et les régions ont eu des recettes moins dynamiques. Les départements, en particulier, ont dû faire face à l'effondrement des DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux).
La solidité du bloc communal
La note financière attribuée par l'AFL aux communes continue de s'améliorer pour l'année 2023, signe de la solidité du bloc local. Ainsi, même si les situations demeurent très disparates entre des communes qui forment un tout très hétérogène, les notes s'améliorent quelle que soit la strate de considérée. Il est à noter que les petites villes (au sens de l'APVF, c'est-à-dire entre 2 500 et 25 000 habitants) disposent désormais d'une note supérieure à la moyenne nationale.

Service d'accès aux soins : le décret relatif à la généralisation publié
Un décret en date du 14 juin définit l’organisation et le fonctionnement du service d’accès aux soins (SAS). Le décret indique que le SAS “assure une régulation médicale (…) des demandes d’aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire”. Pour rappel, le SAS peut …
Un décret en date du 14 juin définit l’organisation et le fonctionnement du service d’accès aux soins (SAS).
Le décret indique que le SAS "assure une régulation médicale (…) des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire". Pour rappel, le SAS peut être joint en composant le 15 sur son téléphone,
Tout d'abord, "le service procède à la qualification, par un assistant de régulation médicale, de chaque appel". Deux options à la suite de cette qualification : soit la personne est prise en charge soit par le service d’aide médicale urgente, soit elle est prise en charge "par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés".
La "régulation de médecine ambulatoire" est ainsi définie : le médecin peut, par téléphone, "donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription adressée au patient ou à une pharmacie" ou "orienter" le patient vers une consultation spécifique dabs "un établissement de santé en admission directe" ou "une structure des urgences", ou bien encore avec un infirmier ou avec un pharmacien
Dans un communiqué de presse en date du 17 juin le ministère de la Santé précise qu' "actuellement au nombre de 74 en fonctionnement, les SAS couvrent 87% de la population".
A noter plusieurs évolutions que le décret du 14 juin apporte par rapport au cadre existant dans le cadre de la généralisation du SAS :
- la mise à disposition d’une plateforme numérique qui a été développée par l’État
- la "régulation à distance" (permettant au médecin généraliste de participer à la régulation "depuis son cabinet, son domicile ou une plateforme d’appel dédiée", sans avoir à se rendre "physiquement sur le plateau du centre 15")
- "la possibilité de maintenir les numéros d’appels spécifiques" en plus du 15.
Retrouvez le décret du 14 juin relatif à la généralisation du SAS en cliquant ici

Conjoncture immobilière au 1 er trimestre 2024
Selon la dernière note de conjoncture immobilière de juin de la Banque des territoires, le marché immobilier dans son ensemble fait face à des difficultés persistantes au premier trimestre 2024. Le changement de politique monétaire amorcé par la banque centrale européenne en ce début juin pourrait toutefois apporter un peu de soutien aux conditions de …
Selon la dernière note de conjoncture immobilière de juin de la Banque des territoires, le marché immobilier dans son ensemble fait face à des difficultés persistantes au premier trimestre 2024. Le changement de politique monétaire amorcé par la banque centrale européenne en ce début juin pourrait toutefois apporter un peu de soutien aux conditions de financements.
Le marché du neuf
Le marché du logement neuf serait le plus affecté par les conditions adverses. Tant les délivrances de permis de construire que les mises en chantier se situent ces derniers mois à des niveaux affaiblis. En avril, 358 200 logements ont été autorisés en glissement annuel, bien en deçà des moyennes long-terme 5 et 10 ans (respectivement 430 800 et 438 300).
Les maisons notamment connaissent une chute importante sur un an (-24 %). Les logements collectifs sont également en fort recul (-18 %).
La désolvabilisation de la demande par les taux d’intérêts ainsi que les retouches apportées aux dispositifs PTZ et Pinel ont donc particulièrement affecté ses segments du marché, les logements en résidence étant un peu moins fortement touchés (- 11 %).
Le marché de l’ancien
Le marché de l’ancien traverserait également une conjoncture difficile. Quelques signes de frémissements apparaissent cependant en ce printemps. Les transactions, estimées à 812 000 sur un an en avril, sont toujours en recul marqué (-21 %). Ce sont donc 68 000 transactions en moyenne qui sont enregistrées chaque mois sur l’année écoulée. Un niveau d’activité similaire à celui de l’automne 2016.
Selon les chiffres provisoires INSEE-Notaires, les prix des logements anciens poursuivent au premier trimestre leur baisse : -1,6 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Ce qui porte leur recul au total à 5,2 % sur un an. L’érosion des prix se poursuit donc.
Par ailleurs, on assiste depuis le mois de février à un reflux des taux de crédits d’environ 10 points de base par mois. Le taux d’intérêt moyen (hors frais et assurances) des nouveaux crédits à l’habitat (hors renégociations) se situe à 3,89 % en avril contre 4,17 % en janvier (source Banque de France).
Téléchargez la note de conjoncture immobilière de la Banque des territoires en cliquant ici.

Elections législatives : comment se préparer dans sa commune ?
Suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République, les préfets ont reçu une circulaire présentant les modalités d’organisation des élections législatives. Un certain nombre de dispositions concernent les maires. La circulaire en date du 11 juin rappelle que le scrutin se tiendra le 30 juin pour le premier tour …
Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République, les préfets ont reçu une circulaire présentant les modalités d'organisation des élections législatives. Un certain nombre de dispositions concernent les maires.
La circulaire en date du 11 juin rappelle que le scrutin se tiendra le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour - et les 29 juin et 6 juillet dans certains territoires ultramarins.
Les dispositions en amont de l'élection
La circulaire précise notamment les modalités de publication des listes de candidats qui devront être portées à la connaissance des maires, ainsi que les conditions d'affichage. Ainsi, la communication auprès des maires doit se faire dès enregistrement des candidatures, dans un ordre qui sera celui des affichages.
S'agissant de la communication de la propagande électorale en mairie, il est rappelé que la commission de propagande est chargée de transmettre dans chaque mairie de département, dans le même délai que pour les électeurs, les bulletins de vote au nombre au moins égal aux électeurs inscrits.
En matière d'affichage, les candidats doivent pouvoir disposer d'emplacements dédiés, attribués par la commune, dans l'ordre résultant du tirage au sort. Depuis la loi du 2 décembre 2019, le maire peut, pour réduire l'affichage en dehors des espaces autorisés, et après mise en demeure du candidat, faire retirer les affiches se trouvant en dehors des espaces prévus à cet effet.
Pendant les élections
L'instruction aux préfets renvoie vers une autre circulaire : celle du 16 janvier 2020, qui précise le déroulement des opérations électorales au suffrage universel. L'ensemble des modalités pratique d'organisation du vote y sont rappelées.
Il est à noter que dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants seront instituées par les préfets des commissions de contrôle des opérations de vote (CCOV). Elles devront faire l'objet d'une notification aux maires concernés au plus tard le 26 juin prochain.
La constitution des offices de bureau de vote relève de la responsabilité des maires.
A la suite des élections
Les préfets doivent préciser aux maires les conditions dans lesquelles doivent être transmis les résultats. Cette transmission se fait en qualité, pour les maires, de représentants de l'Etat.
L'organisation des opérations électorales représentant un coût pour les communes, elles sont dédommagées par le biais d'une subvention. Cette subvention est fixée pour chaque tour de scrutin à:
- 44,73 € par bureau de vote;
- 0,10 € par électeur inscrit sur les listes arrêtées le jour du scrutin.
Cette subvention doit être reçue par la commune, sans demande préalable de sa part.
Retrouver la circulaire du 11 juin 2024 du Ministère de l'Intérieur
Retrouver la circulaire du 16 janvier 2020 du Ministère de l'Intérieur

Mode d'exercice et disponibilité des médecins : le ministère de la Santé publie une étude
Dans une publication récente, la direction des études du ministère de la Santé s’intéresse à la disponibilité des médecins pour les patients selon leur mode d’exercice. Retour sur les principaux enseignements de cette étude. Les formes d’exercice des médecins peuvent prendre des formes variées : seuls, en groupe avec d’autres généralistes ou encore avec des …
Dans une publication récente, la direction des études du ministère de la Santé s'intéresse à la disponibilité des médecins pour les patients selon leur mode d’exercice. Retour sur les principaux enseignements de cette étude.
Les formes d'exercice des médecins peuvent prendre des formes variées : seuls, en groupe avec d’autres généralistes ou encore avec des paramédicaux.
L'étude met en exergue une dégradation de l'accès à un médecin traitant : deux médecins sur trois déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients comme médecin traitant ; ils étaient un peu plus d’un sur deux en 2019. A noter que les refus de nouveaux patients en tant que médecin traitant sont plus fréquents de la part des médecins en groupe monodisciplinaire, c'est à dire des médecins qui exercent en groupe mais uniquement avec d'autres médecins généralistes.
L'exercice en groupe présente des avantages, ainsi les médecins en groupe, et plus particulièrement ceux en MSP, s’appuient surtout sur le collectif pour la prise en charge des soins non programmés. Cependant, les médecins en groupe sont aussi plus fréquemment amenés à refuser des patients occasionnels ou à allonger les délais de rendez-vous.
Dans l'ensemble, l’appartenance à une structure d’exercice coordonnée, destinée à faciliter la collaboration et la coordination, apparaît jouer un rôle favorable sur la disponibilité des médecins.
Pour en savoir plus sur l'étude cliquez ici

ZAN : la liste des 175 projets d’envergure nationale ou européenne dévoilée
Après plusieurs semaines d’attente, la liste des projets d’envergure nationale ou européenne (Pene) présentant un intérêt général majeur a été dévoilée dans un arrêté publié au “Journal officiel”, le 9 juin dernier. L’artificialisation de 175 projets ne sera ainsi pas imputée aux régions mais sera comptabilisée à part dans une enveloppe nationale. Transmis aux régions …
Après plusieurs semaines d’attente, la liste des projets d'envergure nationale ou européenne (Pene) présentant un intérêt général majeur a été dévoilée dans un arrêté publié au "Journal officiel", le 9 juin dernier. L’artificialisation de 175 projets ne sera ainsi pas imputée aux régions mais sera comptabilisée à part dans une enveloppe nationale.
Transmis aux régions fin décembre 2023, le projet d’arrêté avait ensuite été soumis à consultation publique jusqu'au 2 mai. Il s’agit du dernier texte réglementaire majeur pour la mise en œuvre du "zéro artificialisation nette" des sols (ZAN).
Pour mémoire, la loi Climat et Résilience de 2021 a fixé l'objectif d'atteindre le ZAN en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.
Au total, les 175 projets listés dans l’arrêté du 9 juin représentent déjà plus de 11 870 hectares (ha) sur les 12 500 ha du forfait national disponibles pour la période 2021-2030.
En termes de secteurs, les projets d’infrastructures représentent plus de la moitié des 175 projets listés (58,8 % des projets identifiés pour 7 127 ha). Ils comprennent ainsi des infrastructures routières (27,6 %), des infrastructures portuaires (18,7 %) ainsi que des infrastructures ferroviaires (10,6%). Les projets industriels représentent, quant à eux, 16,6 % des projets sélectionnés, pour une consommation foncière d’environ 2 019 ha. Arrivent ensuite les projets d’aménagement et d’habitat (11,7 %), les projets liés au nucléaire (6,6 %), les projets concernant la défense nationale et la sécurité intérieure (3,7%) et enfin, les établissements pénitentiaires (2,5%).
Sur le plan spatial, la région Hauts-de-France est la mieux dotée avec douze projets représentants 2 138 ha. L’Occitanie se place en deuxième position avec 22 projets pour un total de1 620 ha. La Région Normandie se place, quant à elle, en troisième place du podium avec 1 265 ha répartis sur 16 projets.
A noter qu’une deuxième liste, située en annexe 2 de l’arrêté, identifie 312 autres projets « à titre indicatif et de façon non exhaustive ». Selon la note de présentation du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ces 312 projets supplémentaires sont « susceptibles d’intégrer l’annexe 1 au fur et à mesure de leur niveau d’avancement et de maturité »
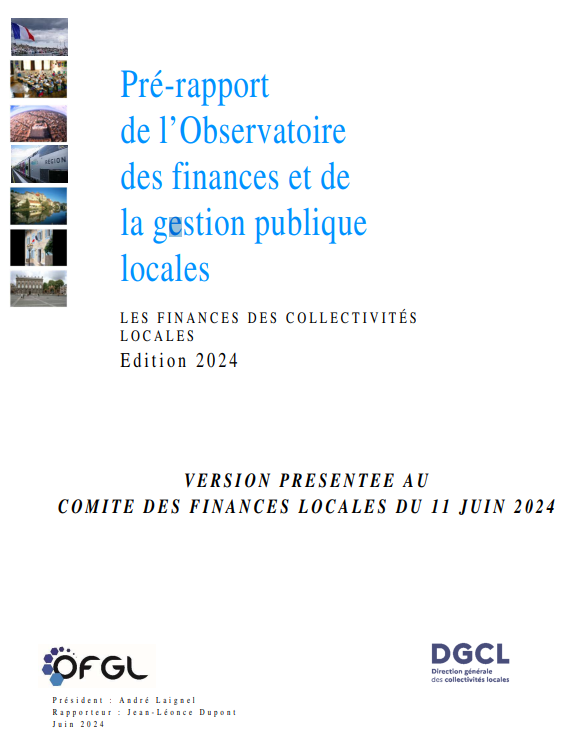
Finances locales : vers une impasse ?
Si le pré-rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales sur les comptes 2023 confirme la bonne gestion des élus locaux, le Président Laignel lance un signal d’alerte en raison de la fragilisation des budgets locaux de l’ensemble des collectivités territoriales. Un contexte général incertain Les finances locales sont encore impactées …
Si le pré-rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales sur les comptes 2023 confirme la bonne gestion des élus locaux, le Président Laignel lance un signal d’alerte en raison de la fragilisation des budgets locaux de l’ensemble des collectivités territoriales.
Un contexte général incertain
Les finances locales sont encore impactées par l’inflation et les conséquences des trois ou quatre années de crise. Tandis que la croissance continue à s’essouffler en 2023 et que le déficit s’accroît, André Laignel perçoit des « signaux d’alerte forts » d’une dégradation durable de la situation financière de l’ensemble des collectivités, et ce indépendamment de leur « bonne gestion globale ».
Une dégradation des finances locales
Avec un besoin de financement des administrations publiques locales pour la première fois depuis 2014 (le solde est passé de + 4,8 milliards d’euros en 2022 à - 4 milliards en 2023), et une baisse sensible de l’épargne brute des collectivités territoriales (- 9 % en 2023), on peut craindre une impasse financière avant la fin de l’année. Ce risque n’est pas certain, comme le précise le rapporteur Jean-Léonce Dupont, mais ce risque est « probable ».
Toutes les catégories de collectivités sont concernées par cette dégradation, y compris le bloc communal même si c’est dans une moindre mesure : leur besoin de financement en 2023 est de 0,2 milliards d’euros, contre - 2,1 milliards d’euros pour les départements et -1,7 milliards d’euros pour les régions. L’épargne brute augmente en 2023 seulement pour les communes.
Mais, comme le montre le pré-rapport, des disparités existent au sein des communes en raison de leur taille. Ainsi, la hausse de l’épargne brute des communes est surtout portée par les communes moyennes, et particulièrement les communes entre 20 000 et 50 000 habitants (+ 12%), et les communes de plus de 100 000 habitants (+ 23%, yc Paris). Selon l’enquête de terrain de l’APVF sur la situation financière des petites villes 2023 et les perspectives 2024, 40 % des petites villes répondantes ont subi une baisse de leur épargne nette en 2023, contre près de 54 % en 2024.
Un phénomène qui pèse sur l’investissement
Sur l’ensemble des collectivités territoriales, les dépenses réelles de fonctionnement (+ 5,8 %) ont augmenté plus rapidement que les recettes réelles de fonctionnement (+ 3,3 %).
Les dépenses, encore très impactées par l’inflation (avec un panier du maire en hausse de 6 %), sont principalement touchées par les augmentations de frais de personnels avec l’augmentation du point d’indice décidé par l’Etat (+ 4,7 %), d’achats et charges externes (+ 9,6 %), dont l’essentiel est porté par l’énergie et l’électricité (en progression de plus de 29 %), mais également des charges financières liées à la hausse des taux (+ 29,4 %). Face à cette hausse des dépenses, les recettes ont été moins dynamiques, et particulièrement les DMTO, en baisse de 21,8 % entre 2022 et 2023.
Le niveau d’investissement, en forte hausse en 2023, est en réalité encore très marqué par l’effet rattrapage des années de crises successives et amplifié par les prix élevés des matières premières. Hors inflation, l’investissement serait même en baisse. Notre enquête sur la situation financière des petites villes de mai dernier semble annoncer une contraction généralisée de l’investissement en 2024, malgré une mobilisation accrue de la trésorerie et de l’emprunt, et contrairement au cycle d’investissement observé lors des mandats précédents.
Téléchargez le pré-rapport de l'OFGL en cliquant ici.
Téléchargez le communiqué de presse de l’APVF en cliquant ici.
Téléchargez l’enquête de l’APVF en cliquant ici.

Elections législatives : trouver des assesseurs avec JeVeuxAider.gouv.fr
Avec la dissolution de l’Assemblée nationale, les maires se voient dans l’obligation de préparer les prochaines élections législatives dans leur commune. L’APVF est partenaire de la Réserve Civique qui porte la plateforme publique JeVeuxAider.gouv.fr. La plateforme publique et gratuite JeVeuxAider.gouv.fr permet de trouver des bénévoles sur un territoire donné. Ainsi, après s’être inscrits les maires …
Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, les maires se voient dans l'obligation de préparer les prochaines élections législatives dans leur commune. L'APVF est partenaire de la Réserve Civique qui porte la plateforme publique JeVeuxAider.gouv.fr.
La plateforme publique et gratuite JeVeuxAider.gouv.fr permet de trouver des bénévoles sur un territoire donné.
Ainsi, après s'être inscrits les maires peuvent poster des missions comme la recherche d'assesseurs. Les bénévoles du territoire inscrits sur la plateforme en sont directement informés. La plateforme accompagne en effet à la communication autour des événements organisés. L'outil propose également de gérer les participants.
Pour en savoir plus retrouver le kit des élections de JeVeuxAider.gouv.fr
Plus d'informations sur les assesseurs sur la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr
