ESPACE MEMBRE

Plan mercredi : le ministère de l’Éducation nationale vient d'en préciser la mise en œuvre
Vendredi dernier, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a publié une instruction, datée du 26 novembre dernier, relative à la mise en œuvre du « Plan mercredi ». Pour rappel, le « Plan mercredi » vise à associer les communes et leurs groupements au sein d’une politique locale faisant du mercredi « un temps éducatif utile aux …
Vendredi dernier, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a publié une instruction, datée du 26 novembre dernier, relative à la mise en œuvre du « Plan mercredi ». Pour rappel, le « Plan mercredi » vise à associer les communes et leurs groupements au sein d’une politique locale faisant du mercredi « un temps éducatif utile aux enfants, conçu dans le respect de leurs rythmes et en relation avec le socle commun de culture, de connaissances et de compétences ».
Dans un premier temps, l’instruction détaille les aides financières à la disposition des collectivités : il est ainsi rappelé que le fonds de soutien au développement des activités périscolaires mis en place depuis 2013 est pérennisé pour toutes les communes qui ont conservé une organisation du temps scolaire (OTS) comprenant 5 matinées. De fait, les communes dont les écoles fonctionnent sur 4 jours ne sont plus éligibles à ce fond. Le montant de cette aide demeure de 50 € par élève et par an, avec une bonification de 40 € supplémentaire pour les communes éligibles à la DSU cible, la DSR cible et dans les outre-mer.
Par ailleurs, une aide de la CAF : l’ASRE (aide spécifique au rythme éducatif) peut être toujours mobilisée pour financer « au maximum trois heures de temps d’accueil périscolaire » correspondant aux TAP/NAP au sein des communes dont l’organisation du temps scolaire comprend toujours 5 matinées. Pour rappel : pour bénéficier de cette aide, les activités prévues doivent être déclarées en accueil de loisirs sans hébergement.
A noter qu’en ce qui concerne les activités du mercredi en période scolaire, qui relèvent du temps périscolaire depuis la dernière rentrée, une bonification de 46 centimes par heure et par enfant de la « prestation de service ordinaire accueil de loisirs sans hébergement » (PSO ALSH), actuellement de 0,54 euro, est accordée par la CAF, quelque soit l’organisation du temps scolaire décidée par la commune. Ainsi, la prestation de service s’élève à 1€. Mais comme vient le préciser l’instruction : « seuls les gestionnaires d’accueils de loisirs labellisés « Plan mercredi » bénéficiant de la PSO ALSH sont éligibles à la bonification, laquelle s’applique pour toutes les heures nouvelles développées sur le temps du mercredi à compter de la rentrée scolaire 2018 ».
Pour les communes revenues à quatre jours à la rentrée 2017, la bonification est possible à compter de la rentrée 2018 à condition que l’accueil de loisirs ne soit pas déjà bonifié par le contrat enfance – jeunesse, et pour les seules heures nouvelles.
Autre information à connaître : les communes sont en droit de demander un versement rétroactif dans les cas où la convention relative au Plan mercredi serait conclue « avant la fin du mois de décembre 2018 ».
En termes de d’accompagnement opérationnel, le bloc local a vocation à être épaulées par des structures appelées GAD pour « groupe d’appui départementaux », dont la mission consiste à piloter l’élaboration des conventions relatives au projet éducatif territorial et à la « charte qualité Plan mercredi ».
Pour finir, l’instruction revient sur la procédure à suivre s’agissant des déclarations relatives à l’accueil de loisirs élaborées dans le cadre du Plan mercredi : « Tous les accueils de loisirs se déroulant le mercredi devront être déclarés comme des accueils périscolaires, qu'il y ait ou non école et quelle que soit la durée de l'accueil ce jour-là », par l’intermédiaire de l’application Siam (système d’information relatif aux accueils de mineurs) dont la mise à jour est imminente. Aussi, les collectivités qui auraient déjà déclaré un accueil extrascolaire devront modifier celle-ci aux fins de la transformer en déclaration d’accueil périscolaire, afin de pouvoir s’inscrire dans la démarche du Plan mercredi.
Pour retrouver l'intégralité de cette instruction, merci de cliquer ici.

« Gilets jaunes » : l’APVF appelle un plan ambitieux de lutte contre les fractures territoriales
Par voie de communiqué en date de mardi dernier, c’est à la suite d’un week-end marqué par de graves violences qui ont touchées toute la France en marge du mouvement des « gilets jaunes » que l’APVF a appelé le Gouvernement à envoyer des signes forts et concrets permettant de faire retomber la température de …
Par voie de communiqué en date de mardi dernier, c’est à la suite d’un week-end marqué par de graves violences qui ont touchées toute la France en marge du mouvement des « gilets jaunes » que l’APVF a appelé le Gouvernement à envoyer des signes forts et concrets permettant de faire retomber la température de la crise sociale et politique qui secoue le pays depuis maintenant une quinzaine de jours.
Bien que les récentes annonces du Gouvernement constituent un premier pas, l’APVF constate que le mouvement des « gilets jaunes » est avant tout le révélateur des profondes fractures sociales et surtout territoriales qui n’ont cessé de s’aggraver depuis une trentaine d’années. Selon l’analyse de l’APVF, cette crise découle des conséquences d’une métropolisation mal maîtrisée et d’une politique visant à mettre en concurrence les territoires.
En effet, c’est dans la France des petites villes et de l’étalement urbain que le mouvement des « gilets jaunes » est le plus présent et, dans tous les cas, le plus soutenu. C’est cette France-là, où la disparition des services publics, la désertification médicale, la dévitalisation des cœurs de ville, et les questions d’accès au numérique et à la mobilité se posent avec le plus d’acuité, qui attend des réponses de fond.
C’est pourquoi, l’APVF a avancé à l’attention du Gouvernement plusieurs pistes pour un plan d’ensemble ambitieux contre les inégalités territoriales :
- Renforcer les solidarités territoriales, notamment à travers des mécanismes concrets de péréquation financière tel que le « 1 % métropole » : 1 % des recettes de la fiscalité économique des métropoles les plus plus riches dédiées au financement de projets structurants sur le reste du territoire ;
- Rendre effectif le « droit à la mobilité » à travers des solutions de financement pérennes en faveur de la mobilité dans les territoires dits « périphériques » et la remise à flot des petites lignes ferroviaires avec un vrai soutien financier de l’Etat ;
- Lutter contre la désertification médicale en régulant les modalités d’installation des médecins libéraux ;
- Revitaliser les centres-villes à travers l’extension du plan « Action Coeur de Ville » à l’ensemble des collectivités concernées par cette situation ;
- Conjuguer écologie, justice sociale et égalité territoriale en impliquant les territoires et en leur accordant les moyens pour mener la transition écologique, notamment à travers un véritable soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.
Pour l’APVF, ce plan doit avant tout être le fruit d’un véritable débat national, décliné localement dans chaque commune de France, permettant de faire remonter les idées et les doléances de nos concitoyens.
Par ailleurs, la future Agence nationale de Cohésion des territoires doit dans cette optique être un outil véritablement opérationnel, au service des territoires les plus fragiles, disposant de nouveaux moyens financiers, à la hauteur des enjeux que révèlent cette crise.
Enfin, l’APVF s’est associée à l’AMRF afin de proposer aux maires qui le souhaiteraient, en fonction de la situation locale, qu'ils sont seuls à même d'apprécier :
- d'ouvrir leur mairie, samedi 8 décembre prochain, pour recueillir les « doléances et les propositions » des citoyens ;
- de donner la possibilité aux citoyens d’exprimer leur opinion, qu’ils se reconnaissent ou non dans la mobilisation des mouvements plus ou moins organisés, en facilitant l’expression de celles et ceux qui sont empêchés (exclusion numérique, etc.) ;
- de transmettre les doléances et propositions à leur association pour en faire une synthèse départementale et la diffuser auprès du Gouvernement et du Parlement.
L'APVF estime que les maires sont, avant tout, des médiateurs et que, partout dans le dialogue républicain, le sens de l'écoute et le respect, doivent prévaloir.
Téléchargez le communiqué de presse en cliquant ici.

L’APVF dévoile sa nouvelle plaquette de présentation 2019
L’APVF fêtera en 2019 son trentième anniversaire et profite de cette nouvelle année pour diffuser une plaquette de présentation relative à ses missions, ses objectifs et à son fonctionnement. Intitulée « Exigeants et constructifs », cette plaquette a naturellement vocation à expliquer la démarche de notre association. Face à la métropolisation, l’APVF vise à fédérer et rassembler …
L’APVF fêtera en 2019 son trentième anniversaire et profite de cette nouvelle année pour diffuser une plaquette de présentation relative à ses missions, ses objectifs et à son fonctionnement. Intitulée « Exigeants et constructifs », cette plaquette a naturellement vocation à expliquer la démarche de notre association.
Face à la métropolisation, l’APVF vise à fédérer et rassembler les élus des petites villes pour défendre leurs collectivités ainsi qu’une conception équilibrée de l’aménagement du territoire : un discours qui revêt une dimension particulière au regard de l’actualité.
De façon libre et indépendante, avec conviction mais sans démagogie, l’APVF porte la voix des petites villes et de leurs élus dans tous les lieux du pouvoir. Avec votre soutien, nous serons, dans les débats cruciaux qui s’annoncent : « exigeants et constructifs »
Retrouvez la plaquette d’adhésion 2019 : https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/Plaquette-2019-WEB.pdf et faîtes connaitre votre association autour de vous

Actualité parlementaire intéressant les petites villes : semaine du 10 décembre
Retrouvez l’ensemble des textes et initiatives parlementaires intéressant les petites villes pour la semaine du 10 décembre 2018. Assemblée nationale A noter, le dépôt de deux nouvelles propositions de loi : Proposition de loi visant à étendre le dispositif d’accès direct au fichier des objets et des véhicules signalés et au fichier des personnes …
Retrouvez l’ensemble des textes et initiatives parlementaires intéressant les petites villes pour la semaine du 10 décembre 2018.
Assemblée nationale
A noter, le dépôt de deux nouvelles propositions de loi :
Proposition de loi constitutionnelle visant à valoriser les territoires ruraux
A noter également que la Délégation aux collectivités a créé un groupe de travail, ouvert à l’ensemble des membres de la Délégation, et s’est saisie pour avis sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle a désigné Didier MARTIN (Côte-d’Or) en qualité de responsable de ce groupe de travail et de rapporteur pour avis de ces deux propositions de loi.
Retrouvez l'actualité de la Délégation de l’Assemblée nationale aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Sénat
En séance publique :
Vote solennel du Projet de loi de finances pour 2019 (11 décembre)
Examen de la Proposition de loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (11 et 13 décembre)
Examen du Projet de loi d’orientation des mobilités (11 à 13 décembre)
À venir la semaine d’après (semaine du 17 décembre) :
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le Projet de loi de finances pour 2019 ou nouvelle lecture (19 décembre)
Retrouvez l’actualité de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation

PLF 2019 : quelles avancées au Sénat ?
Le projet de loi de finances pour 2019 est en cours de discussion au Sénat. Après avoir voté la première partie du texte, ils examinent maintenant la seconde partie. On sait qu’à l’Assemblée nationale, peu de batailles ont été remportées. Qu’en est-il au Sénat ? Le volet « recettes » (première partie du PLF 2019), sensiblement remanié par …
Le projet de loi de finances pour 2019 est en cours de discussion au Sénat. Après avoir voté la première partie du texte, ils examinent maintenant la seconde partie. On sait qu’à l’Assemblée nationale, peu de batailles ont été remportées. Qu’en est-il au Sénat ?
Le volet « recettes » (première partie du PLF 2019), sensiblement remanié par les sénateurs, a été adopté, le 29 novembre dernier, à 206 voix pour et 92 voix contre.
Les amendements adoptés, concernant les collectivités territoriales, ont pour objet :
1. d’instaurer un dispositif dérogatoire au régime d’indemnité pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants, tout en maintenant le droit existant pour les autres élus (cet amendement fait écho à l’une des 10 propositions de l’APVF sur le statut de l’élu) : ils pourront déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu 1,25 fois le montant de l'indemnité versée aux maires de communes de moins de 1 000 habitants, soit 1 499,87 euros ;
2. de rétablir le dégrèvement exceptionnel adopté en LFI 2018 pour la « demi-part des veuves » et l’élargir aux contribuables ayant bénéficié de la sortie en sifflet de l'exonération de taxe d'habitation en 2017 et dont les revenus sont parmi les 20 % les plus élevés ;
3. de sécuriser l'intégration, dans le calcul de la TEOM, les charges indirectes supportées par la commune ou par l'EPCI, en ouvrant la faculté d’instaurer un « ratio correspondant à la part des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets dans les dépenses globales ». Cette quote-part devrait être plafonnée « à 15 % des dépenses engagées au titre de la mission de collecte et de traitement des déchets » ;
en outre, les dépenses de structures et les dépenses indirectes liées au service, comme par exemple la mobilisation ponctuelle de personnel communal, entrent dans le champ des dépenses pouvant être financées par la TEOM. Le Sénat donne enfin la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes ;
4. d’allonger de cinq à dix ans la période pendant laquelle peuvent coexister une tarification incitative et une tarification classique de la TEOM, au sein d'une même commune ou d'un même EPCI ;
d'ouvrir la possibilité, lorsque la TEOM ou la TEOMI a été instituée, que la redevance spéciale ne soit appliquée qu'aux propriétés exonérées de la TEOM : cela permettrait aux collectivités de construire un financement global cohérent du service déchets en utilisant en complémentarité la TEOM ou la TEOMI et la redevance spéciale et limite les situations de cumul des deux dispositifs ;
de supprimer la possibilité d'augmenter de 10 % le produit de la TEOM lors de la mise en place de la part incitative. En contrepartie, les frais de gestion seraient abaissés à 0 % pendant trois ans lors de cette même mise en place ;
5. d’instaurer une exemption de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets mais qui restent à ce jour non valorisables (soit environ 30 % des déchets ménagers) ainsi qu'un abattement de 50% de TGAP sur les résidus de déchets non valorisables issus d’installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes ;
d’instaurer une TGAP en amont sur les produits non recyclables à destination des ménages ;
6. de revenir sur la suppression de la taxe sur les friches commerciales (TFC), introduite par l'Assemblée nationale au motif que son rendement était trop faible : « la TFC n'est pas un impôt de rendement mais un outil à la disposition des collectivités locales au service de leurs politiques d'aménagement et de développement économique permettant d'inciter à l'utilisation des locaux commerciaux. [...] Elle est le pendant, pour les locaux commerciaux, de la taxe sur les logements vacants » explique l’un des amendements ;
7. de geler les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) ;
de verser aux collectivités territoriales, mettant en œuvre des plans climat-air-énergie, une fraction du produit de la TICPE, assortie de contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique ;
de créer un mécanisme de remboursement d’une fraction de la TICPE payée par les PME des secteurs industriels qui utilisent du gazole non routier (GNR) et bénéficiaient jusqu’alors d’un tarif réduit ;
8. de supprimer la minoration de 49,1 M€ des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) prévue pour 2019 ;
9. de sortir de la liste des variables d'ajustement les exonérations de TFPB de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l'acquisition de logements sociaux.
10. d’instaurer la possibilité, pour les communes et EPCI « ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale », de demander auprès de la direction départementale des finances publiques une rectification de leur prélèvement au titre du FNGIR.
La rencontre des maires de petites villes de la région Hauts-de-France, qui se déroulera en Mairie de Lille vendredi 14 décembre prochain, sera une bonne occasion de revenir sur les principales mesures du projet de loi de finances pour 2019 qui touchent les collectivités territoriales, et précisément les petites villes.
https://www.apvf.asso.fr/2018/09/25/rencontre-hauts-de-france/

L'APVF et les EPL renforcent leur coopération
Présent au Congrès des EPL (entreprises publiques locales), le 5 décembre à Rennes, Christophe Bouillon, Président de l’APVF a signé avec Jean-Marie Sermier, député du Jura et Président de la Fédération des EPL, une convention de partenariat renforçant les liens entre les deux associations. Elles ont décidé de travailler en concertation étroite sur la question …
Présent au Congrès des EPL (entreprises publiques locales), le 5 décembre à Rennes, Christophe Bouillon, Président de l'APVF a signé avec Jean-Marie Sermier, député du Jura et Président de la Fédération des EPL, une convention de partenariat renforçant les liens entre les deux associations.
Elles ont décidé de travailler en concertation étroite sur la question du logement et de développer l'échange d'information entre les services des deux structures sur les textes ayant un impact pour les collectivités.
Participant ensuite à la séance plénière, Christophe Bouillon est intervenu sur la question du logement et de la loi Elan, et plus généralement, sur le thème de la concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales, insistant sur l'absolue nécessité de refonder les relations notamment lors de la Conférence nationale des territoires.

"Gilets jaunes" : "Il est urgent de faire des propositions beaucoup plus fortes" pour Christophe Bouillon
Interviewé par la Tribune, le président de l’association des petites villes de France (APVF) a pointé une “vraie crise de confiance” et soulève la question de l’ISF comme le symbole “d’une profonde injustice”. Christophe Bouillon propose que les cahiers de doléances des gilets jaunes puissent être déposés en mairie. LA TRIBUNE – Comment réagissez-vous aux annonces …
Interviewé par la Tribune, le président de l'association des petites villes de France (APVF) a pointé une "vraie crise de confiance" et soulève la question de l'ISF comme le symbole "d'une profonde injustice". Christophe Bouillon propose que les cahiers de doléances des gilets jaunes puissent être déposés en mairie.
LA TRIBUNE - Comment réagissez-vous aux annonces du Premier ministre ?
CHRISTOPHE BOUILLON - Enfin ! Pour l'instant, c'est un moratoire. C'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, mais la question de l'ISF demeure assez forte, les gens ayant le sentiment d'une profonde injustice. Même si des propositions ont été faites, il y a une vraie crise de confiance. Je ne suis pas sûr que cela calme dans l'immédiat cette colère. Il y a urgence à remplir le vide de ces six mois perdus avec des propositions beaucoup plus fortes. Nous sommes disponibles pour agir.
Déjà la semaine dernière lorsque nous avons rencontré le Premier ministre, il nous a demandé de réagir et d'imaginer des sorties de crise. Nous lui avons dit que la transition énergétique se faisait dans les territoires, les maires s'étant pleinement investis dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). Nous demandons par exemple un véritable soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.
Nous lui avons également demandé d'être original et inédit dans sa réponse en faisant un geste fort après tant de retard et de crispation. Qu'il y ait des engagements dans les territoires, et pas de mesure administrative comme nous en avons l'habitude. Quand Édouard Philippe est venu à nos assises à Autun en mai dernier, nous l'avons alerté sur la question de la métropolisation. Les habitants qui se sont installés dans nos villes pour gagner en qualité de vie se sentent pris au piège et aimeraient que le droit à la mobilité soit renforcé.
Retrouvez l'intégralité de l'interview du Président Christophe BOUILLON en cliquant ici.

Christophe Bouillon sur France culture : « Il faut aligner l'indemnité des élus sur celle des directeurs généraux des services »
Conséquences des nouvelles contraintes, selon une enquête du Cevipof, un maire sur deux n’a pas l’intention de se représenter pour un nouveau mandat en 2020. Ceux qui se sont présentés pour la première fois en 2014 sont même 60% à déclarer vouloir abandonner tout mandat électif. En première ligne dans ces difficultés, les 4 000 petites villes …
Conséquences des nouvelles contraintes, selon une enquête du Cevipof, un maire sur deux n'a pas l'intention de se représenter pour un nouveau mandat en 2020. Ceux qui se sont présentés pour la première fois en 2014 sont même 60% à déclarer vouloir abandonner tout mandat électif.
En première ligne dans ces difficultés, les 4 000 petites villes éloignées qui comptent entre 2 500 et 25 000 habitants. Elles sont défendues par l'Association des petites villes de France (APVF). Cette association cherche à rendre attractive et à oxygéner la représentation mayorale qui compte 42% de retraités et seulement 15% d’employés comme l’explique son Président Christophe Bouillon dont vous pouvez retrouver les propositions relayées par France culture en cliquant ici.

ELAN : la loi promulguée dans son ensemble, à quelques exceptions près
La loi Elan a été promulguée et publiée au JO le 24 novembre dernier. Seules un vingtaine de dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2018. En cause un certain nombre de « cavaliers législatifs », introduits par voie d’amendements sans lien avec le projet de loi initial, …
La loi Elan a été promulguée et publiée au JO le 24 novembre dernier. Seules un vingtaine de dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2018. En cause un certain nombre de « cavaliers législatifs », introduits par voie d’amendements sans lien avec le projet de loi initial, relevant plutôt du domaine de la gestion immobilière.
Définitivement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat (respectivement, les 3 et 16 octobre), après qu’un accord ait été trouvé en commission mixte paritaire le 19 septembre, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) avait été déféré devant le Conseil constitutionnel par plus de soixante députés.
Dix-neuf articles ont été censurés sur le fondement des articles 39 et 44 de la Constitution (cavaliers législatifs). Un vingtième article est annulé au motif qu’il porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs fixé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Parmi les cavaliers censurés, on peut citer :
- l’article 72 créant un observatoire des diagnostics immobiliers,
- l’article 91 prévoyant une autorisation permanente d’accès de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux parties communes des immeubles des organismes d’HLM,
- l’article 108 précisant les conditions dans lesquelles une société civile immobilière familiale peut donner congé à son locataire,
- l’article 121 qui renforce les sanctions en matière d’occupation des espaces communs des immeubles et qui permet la résolution du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants,
- l’article 123 permettant aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d’habitation,
- l’article 135 imposant au bailleur de notifier au syndic de l’immeuble les coordonnées de son locataire,
- l’article 144 qui permet d’autoriser de manière permanente l’accès aux parties communes des immeubles d’habitation des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement,
- l’article 147 exemptant les propriétaires pratiquant la location saisonnière de fournir certains diagnostics techniques,
- l’article 152 qui prévoit un accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles d’habitation,
- l’article 155 prévoyant une révision tous les cinq ans de la liste des charges récupérables par le bailleur auprès de son locataire,
- l’article 200 qui interdit la réclamation de frais au titre d’une demande d’autorisation préalable de mise en location d’un logement dans les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé.
L’article 196 porte, quant à lui, atteinte à la séparation des pouvoirs. Il prévoyait qu’« un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitées dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la […] loi ». Or, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, l’instauration d’un délai préfixe dans lequel le pouvoir réglementaire est tenu de prendre un décret est contraire à l’article 16 de la DDHC et aux dispositions de l’article 21 de la Constitution (relatif aux pouvoirs du premier ministre).
Téléchargez la décision du Conseil constitutionnel en cliquant ici.
Téléchargez la loi Elan en cliquant ici.
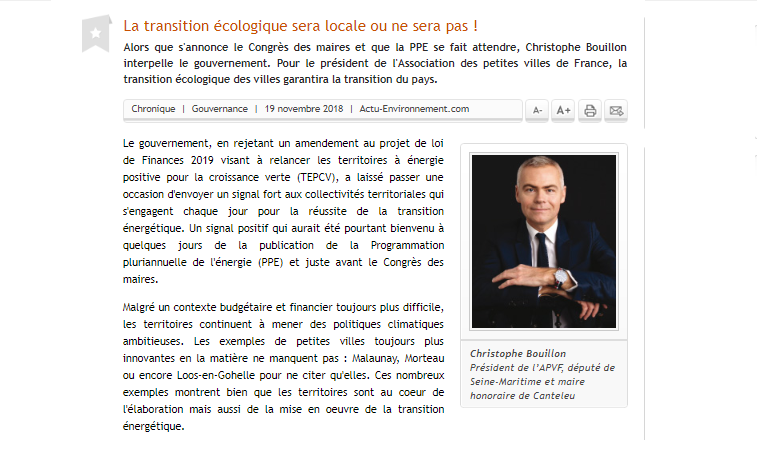
« La transition énergétique sera locale ou ne sera pas » pour Christophe Bouillon
Dans une actualité marquée par le Congrès des Maires et la présentation de la Programmation pluriannuelle de l’énergie, Christophe Bouillon, Député et Président de l’APVF, interpelle le Gouvernement dans un article du magazine Actu Environnement. Par le biais de cette tribune, il lance un appel pour une territorialisation de la transition énergétique. Il ressort de …
Dans une actualité marquée par le Congrès des Maires et la présentation de la Programmation pluriannuelle de l'énergie, Christophe Bouillon, Député et Président de l’APVF, interpelle le Gouvernement dans un article du magazine Actu Environnement. Par le biais de cette tribune, il lance un appel pour une territorialisation de la transition énergétique.
Il ressort de cette tribune trois idées essentielles :
Tout d’abord, Christophe Bouillon rappelle le rôle clé et encore insuffisamment reconnu des territoires dans la transition énergétique. Les petites villes sont de véritables « espaces à taille humaine propices à la transition énergétique » souligne le Président de l'APVF. Partout dans nos territoires, nous voyons se développer des modes de production d’énergie locale. Les collectivités comme Malaunay ou encore Loos-en-Gohelle innovent chaque jour pour répondre au défi climatique.
Avec l’amplification des catastrophes climatiques et la raréfaction de plus en plus grande de nos ressources, cette territorialisation de la transition énergétique devient de plus en plus urgente. Elle va permettre d’améliorer la qualité et l’acceptabilité des projets menés dans nos territoires.
Christophe Bouillon dépasse le simple constat et propose des solutions concrètes pour accélérer la transition énergétique comme l’affectation d’une part des recettes de la fiscalité carbone aux territoires.
Il invite pour terminer l’ensemble des acteurs locaux à signer l'appel de Montmélian pour une transition énergétique territoriale.
Retrouver l’intégralité de l’article en cliquant ici
