ESPACE MEMBRE

Finances locales : les dépenses de fonctionnement des communes baissent en 2018
Le pré-rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, réalisé par le département des études et des statistiques locales de la DGCL, expose les résultats provisoires des comptes des collectivités locales pour l’exercice 2018. En cela, les informations qu’il contient sont extrêmement précieuses pour les élus locaux. La séance plénière du dernier …
Le pré-rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales, réalisé par le département des études et des statistiques locales de la DGCL, expose les résultats provisoires des comptes des collectivités locales pour l’exercice 2018. En cela, les informations qu’il contient sont extrêmement précieuses pour les élus locaux. La séance plénière du dernier Comité des finances locales, mardi dernier, était consacré en partie à sa présentation.
Il ressort de ce document que les collectivités locales ont modéré leurs dépenses de fonctionnement en 2018 et leurs dépenses d'investissement ont continué à progresser.
Les dépenses de fonctionnement « ralentissent et se stabilisent » : + 0,2 %, après 2 % en 2017. Cette progression très contenue tiendrait à la fois au recul des subventions versées par l’Etat aux collectivités et à la maîtrise des frais de personnel. Mais, comme le souligne le pré-rapport et en cohérence avec le résultat des enquêtes de l’APVF, ce ralentissement est assez inégal selon les catégories de collectivité : du côté des communes, les dépenses sont en baisse de - 0,6 % tandis qu’elles augmentent de + 3,4 % pour les régions (cette hausse étant la conséquence du transfert de la compétence « transport » des départements aux régions).
S’agissant plus précisément des dépenses de personnel, elles ont augmenté de seulement + 0,9 %, contre + 2,9 % en 2017.
Parallèlement, la progression des recettes de fonctionnement est moins forte que l’année dernière : elles ont augmenté seulement de + 1,1 %, contre + 2,3 % en 2017.
Les dépenses d’investissement, quant à elles, augmentent moins vite : + 5,2 % cette année, contre + 6,2 % en 2017. A noter que la reprise est plus marquée dans le secteur communal et, plus particulièrement, dans les groupements de communes (+ 7,8 %). Le pré-rapport montre que l’investissement dans les départements reprend après une baisse ininterrompue depuis 2009 : les dépenses d’investissement augmentent de + 4,1 %.
Le lien vers le pré-rapport en cliquant ici.

Politique générale : « l’Acte II » des réformes est lancé
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté hier une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale et, aujourd’hui devant le Sénat. A ces occasions, il a décliné le calendrier de sept chantiers de réformes parmi lesquelles figure le nouvel acte de la décentralisation. D’autres chantiers ont été mis sur la table, comme ceux de l’écologie, de la mobilité …
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté hier une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale et, aujourd’hui devant le Sénat. A ces occasions, il a décliné le calendrier de sept chantiers de réformes parmi lesquelles figure le nouvel acte de la décentralisation. D’autres chantiers ont été mis sur la table, comme ceux de l’écologie, de la mobilité et l’école.
Ecologie : mobilité et énergie-climat, gaspillage
« Les douze prochains mois seront ceux de l'accélération écologique ». L’objectif du chef du gouvernement : que les projets de loi sur la mobilité et l'énergie-climat soient adoptés « avant l'été » et que « les aides existantes à la rénovation énergétique » soient remises « totalement à plat ».
Il a aussi affirmé que « tous les produits en plastique jetables seraient bannis » de l'administration à compter de 2020.
Le projet de loi de lutte contre le gaspillage sera inscrit dans les trois « priorités » de l'Assemblée nationale pour la rentrée en septembre.
Le Premier ministre, rappelant « l'urgence écologique », a indiqué par ailleurs que les propositions « les plus puissantes » de la convention citoyenne pour la transition écologique, voulue à l'issue du grand débat, pourraient être soumises « à référendum ».
Devant le Sénat aujourd’hui, il a affirmé que la lutte contre « l’assignation à résidence » dans les territoires les plus reculés serait une priorité.
Institutions : renforcement des maires, nouvel acte de décentralisation
Le Premier ministre s’est dit favorable à « un nouvel acte de décentralisation ». Il propose de procéder en deux temps.
- « Avant juillet » 2019 : le projet de loi « engagement et proximité »
Ce texte, qui sera examiné par le Sénat dès la rentrée de septembre, et dont l’objectif est de « conforter les maires », devrait comprendre deux axes.
D’une part, le projet de loi devrait contenir des mesures destinées à favoriser l’engagement des maires. Edouard Philippe s’est engagé, aujourd’hui devant le Sénat, à donner un cadre clair d’exercice des mandats aux maires et plus de liberté afin qu’ils soient en mesure de mener leurs projets. Cela passera par davantage de formation, une protection juridique et un accompagnement professionnel et familial renforcés.
D’autre part, Edouard Philippe souhaite « s’accorder avec les élus locaux et leurs représentants sur la meilleure méthode pour clarifier le millefeuille territorial ». « Il faut aller vers des compétences clarifiée, une responsabilité accrue, des financements clairs, comme le Président de la République nous y a incité », ajoute-t-il. Si les intercommunalités doivent porter les projets collectifs (économie circulaire, réseaux, logement, infrastructure et mobilités), le maire doit retrouver des leviers de décision et d’action. C’est pourquoi le chef du Gouvernement propose de corriger la loi NOTRe autour du triptyque « compétences, périmètre et gouvernance ».
- Avant les départements et les régionales de 2021 : le « nouvel acte de décentralisation »
Un autre projet de loi devrait être présenté « avant la fin du premier semestre 2020 », pour une application « avant les échéances électorales de 2021 » (les élections départementales et régionales).
Ce « nouvel acte de la décentralisation » devra « achever les transferts de compétences », selon le Premier ministre. Parmi lesquelles : le logement, les transports ou encore la transition écologique. Le projet de loi « décentralisation et différenciation » ouvrira la voie à la différenciation territoriale.
En guise de transition vers le chantier de la fiscalité locale, Edouard Philippe a insisté sur la logique de « responsabilité politique » : pour lui, « qui décide paye, et qui paye commande, mais qui commande assume » (Cf. article de l’APVF en cliquant ici).
Ecole : classes d'école réduites
Le Gouvernement veut « renouer avec l'égalité des chances ». Pour ce faire, le Premier ministre a confirmé que l'école serait rendue obligatoire dès 3 ans et que les classes de CP et de CE1 seraient limitées à 24 élèves sur tout le territoire. Un effort de réduction des élèves par classe en Grande section de maternelle dans les zones les moins favorisées sera fourni.

Lancement de la 6ème édition du Prix Des Cafés Pour Nos Régions
Le prix Des Cafés Pour Nos Régions, dont l’APVF est partenaire, récompense chaque année les 5 meilleurs projets de création, de reprise ou de rénovation de cafés en France. Les lauréats reçoivent une dotation de 10 000 euros, un accompagnement personnalisé Service en tête et une formation au crowdfunding, proposée par Ulule. Lancé en 2013, le …
Le prix Des Cafés Pour Nos Régions, dont l'APVF est partenaire, récompense chaque année les 5 meilleurs projets de création, de reprise ou de rénovation de cafés en France. Les lauréats reçoivent une dotation de 10 000 euros, un accompagnement personnalisé Service en tête et une formation au crowdfunding, proposée par Ulule.
Lancé en 2013, le prix Des Cafés Pour Nos Régions récompense les 5 meilleurs projets de création de reprise ou de rénovation de cafés en France (Est, Centre– Île-de-France, Nord, Ouest, Sud).
Un jury d’experts évaluera chaque projet en fonction de son caractère innovant, sa contribution à l’attractivité économique de la commune, sa dimension sociétale et sa viabilité.
Pour les élus des petites villes, les cafés sont un des facteurs clés du dynamisme économique et social. Alors que le parc de CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) vieilli, l’enjeu est de redynamiser des établissements existants, en leur insufflant le petit plus qui va leur permettre de se développer et de jouer pleinement leur rôle de vecteur du lien social dans nombre de villes et de villages de France
Le prix Des Cafés Pour Nos Régions est officiellement lancé en avril. Les porteurs de projets ont jusqu’au 15 juillet pour candidater sur le site www.descafespournosregions.fr
Pour en savoir plus, téléchargez le dépliant explicatif en cliquant ici.
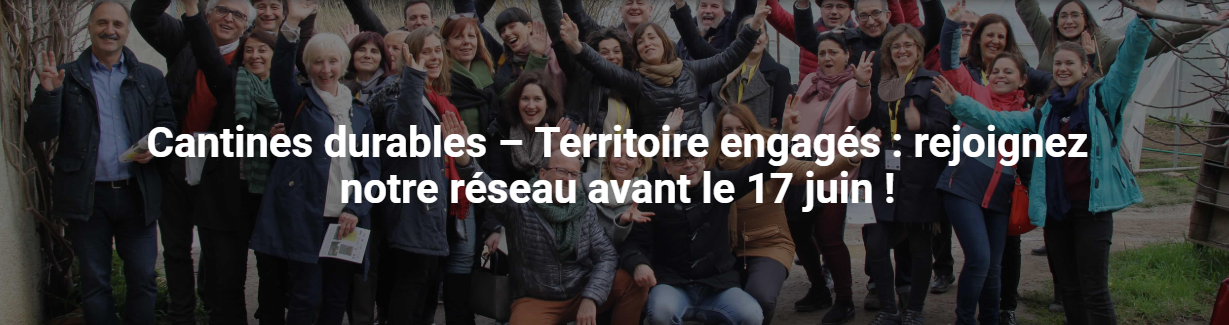
Cantines durables : Mouans-Sartoux propose d’accompagner sept autres collectivités
Vous représentez une collectivité locale qui souhaite faire évoluer la politique publique alimentaire de son territoire ? Comme à Mouans-Sartoux, pour vous manger bio, local, sain et juste est un impératif ? Vous avez déjà des outils en main mais souhaitez aller plus loin, plus vite et plus fort ? Alors vous êtes au bon …
Vous représentez une collectivité locale qui souhaite faire évoluer la politique publique alimentaire de son territoire ? Comme à Mouans-Sartoux, pour vous manger bio, local, sain et juste est un impératif ? Vous avez déjà des outils en main mais souhaitez aller plus loin, plus vite et plus fort ? Alors vous êtes au bon endroit pour candidater jusqu’au 17 juin au réseau Cantines durables – Territoires engagés initié Mouans-Sartoux.
Avec le soutien du Programme National de l’Alimentation (PNA), la ville propose d’accompagner sept collectivités dans la définition et la mise en œuvre d’une politique alimentaire territoriale respectueuse de l’environnement et de la santé des citoyens. En particulier, fort de l’expérience de la ville dans ce domaine, le réseau s’appuie sur le rôle-clé de la restauration scolaire comme principal levier de construction d’une véritable politique alimentaire de territoire.
Retrouvez la présentation du projet en cliquant ici
Candidatez en cliquant ici
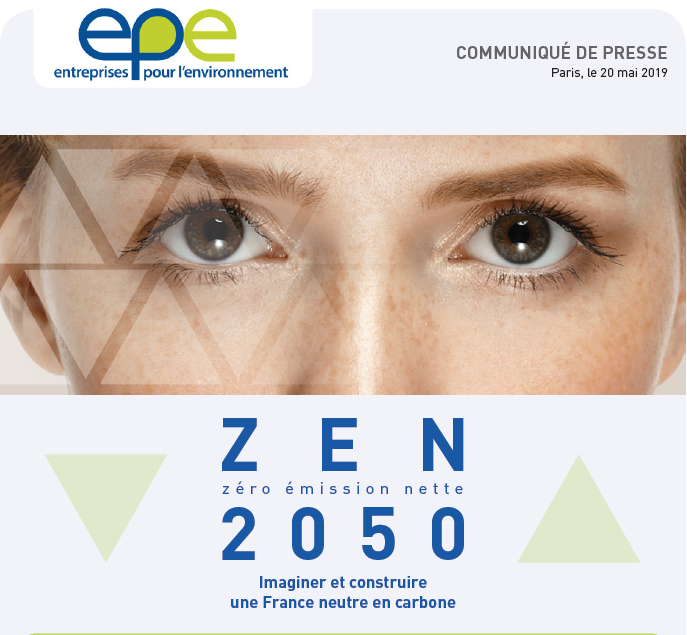
Transition écologique : Présentation de l’étude 0 émission nette en 2050
Présentée lundi 27 mai, l’étude « Zèro émission nette en 2050 » réalisée par Entreprise pour l’Environnement propose des clés pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Selon cette étude, la neutralité carbone peut être atteint à raison d’une baisse de 4.5 %/an des émissions de gaz à effet de serre grâce au végétarisme …
Présentée lundi 27 mai, l’étude « Zèro émission nette en 2050 » réalisée par Entreprise pour l’Environnement propose des clés pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Selon cette étude, la neutralité carbone peut être atteint à raison d’une baisse de 4.5 %/an des émissions de gaz à effet de serre grâce au végétarisme et aux voitures décarbonées.
Cette étude part de l’analyse de l’évolution des modes de vie de 9 ménages avec trois profils différents. Le premier, « sobre et heureux » est un urbain multimodal. Le 2ème, « réticent » est assumé rural avec une voiture hybride et des vacances en avion. Enfin, le 3ème, « consommateur flexible » a une alimentation locale et moins carnée et habite en principe en ville. L’étude intègre donc des dimensions économiques, sociales et techniques afin de mettre en lumière les options possibles.
A partir de ces cas précis, l’étude propose plusieurs chemins pour atteindre la neutralité carbone en 2050 qui passe notamment par :
- Mobilisation de l’ensemble des acteurs publics/privés, locaux/nationaux et internationaux ;
- Mise en place d’une fiscalité carbone plus équitable avec des mécanismes de compensation pour les ménages les plus fragiles ;
- Elaboration d’une politique d’aménagement du territoire qui tient compte des enjeux climatiques avec la limitation de l’étalement urbain ;
- Développement des énergies renouvelables et notamment de la biomasse ;
- Rénovation des bâtiments avec des dispositifs d’accompagnement ambitieux. L’objectif étant d’atteindre 80 % de logement très performants d’ici 2050 ;
- Réduction par deux des émissions directes du secteur agricole.
Cette étude arrive donc à la conclusion que la neutralité carbone est possible et même souhaitable en termes économique notamment. Elle implique néanmoins un changement de mode de vie contraint ou incité.
Retrouvez l'intégralité du rapport en cliquant ici

PJL Fonction publique : l’APVF auditionnée par le Sénat
L’APVF a été auditionnée, mardi 4 juin, sur le projet de loi de transformation de la fonction publique au Sénat par les rapporteurs Catherine Di Folco, sénatrice du Rhône, et Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, secrétaire général de l’APVF. L’occasion de préciser la position générale de l’association sur le texte et de présenter certaines …
L’APVF a été auditionnée, mardi 4 juin, sur le projet de loi de transformation de la fonction publique au Sénat par les rapporteurs Catherine Di Folco, sénatrice du Rhône, et Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, secrétaire général de l’APVF. L’occasion de préciser la position générale de l’association sur le texte et de présenter certaines propositions.
Nous avons rappelé aux rapporteurs la doctrine de l’APVF sur le sujet de la fonction publique : elle est à la fois attachée au statut, au principe selon lequel les emplois permanents doivent être pourvus à des fonctionnaires titulaires, et ouverte à des souplesses nouvelles en termes de gestion des ressources humaines.
Sur la question de l’extension du recours au contrat, l’APVF n’est pas opposée au développement de celui-ci dans la fonction publique territoriale dès lors que ce mode de recrutement demeure une voie d’exception. Le recours au contrat doit permettre de répondre à des problématiques spécifiques et de pallier les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontées parfois les petites villes.
Sur la création des contrats de projet, conclus pour une durée maximale de 6 ans afin de répondre à un besoin particulier (sur des emplois de catégories A et B), l’APVF, comme Philippe Laurent, Président du CSFPT, regrette que ce dispositif ne concerne pas, en l’état du texte, les titulaires de la fonction publique territoriale. L’APVF estime, en effet, que ce dispositif pouvait constituer un levier de coopération territoriale et concrétiser l’alliance des territoires en favorisant le partage d’ingénierie et de compétences entre collectivités.
L’APVF a conclu cette audition en rappelant l’une de ses propositions phare : elle est favorable à l’abaissement du seuil démographique à partir duquel une collectivité serait en droit de recruter un administrateur territorial de 40 000 habitants aujourd’hui, à 10 000 habitants. Ce seuil de 10 000 habitants a sa cohérence : il permettrait d’ouvrir la possibilité de recruter, dans les petites villes, des membres de Cabinet.
Le Sénat a globalement accueilli positivement les propositions formulées par l’APVF, et notamment celles qu’elle soutient sous l’égide de la Coordination des employeurs territoriaux.
Téléchargez le tableau de suivi du projet de loi en cliquant ici.
Téléchargez la note de préparation de l’audition en cliquant ici.
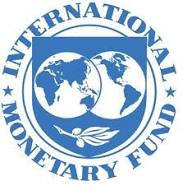
Dette publique française : les propositions du FMI pour endiguer la crise
A la veille du semestre européen, le Fonds monétaire international (FMI) a présenté, le 3 juin, les conclusions de sa mission de consultation consacrée à la France, en vertu. L’institution s’inquiète de la dette publique française considérée comme « trop élevée ». Ces conclusions décrivent les observations du FMI formulées à l’issue d’une mission officielle effectuée en …
A la veille du semestre européen, le Fonds monétaire international (FMI) a présenté, le 3 juin, les conclusions de sa mission de consultation consacrée à la France, en vertu. L'institution s'inquiète de la dette publique française considérée comme « trop élevée ».
Ces conclusions décrivent les observations du FMI formulées à l’issue d’une mission officielle effectuée en France au titre de l’article IV des Statuts du FMI. Sur la base des observations préliminaires, le FMI établira un rapport.
La mission part du constat d’un ralentissement de la croissance française et d’une persistance des problèmes structurels : « une dette publique et privée élevée, un chômage structurel encore élevé, une croissance atone de la productivité, et des inégalités d’opportunité ». Elle souligne que le succès des réformes prioritaires menées par le Gouvernement tiendra au consensus social qui s’en dégage.
Parmi les principaux domaines de réforme ciblés par le FMI, figure la nécessité de préserver la viabilité des finances publiques et accroître l’efficience du secteur public. Pour le FMI, si elles sont achevées et mises en œuvre « de manière ambitieuse », les réformes qui sont prévues dans la fonction publique, les retraites et les allocations de chômage devraient « renforcer l’équité, encourager le travail et générer des économies d’efficience ». Des réformes supplémentaires des dépenses seraient toutefois nécessaire « pour assurer que la réduction en cours de la charge fiscale puisse s’inscrire dans la durée et que la dette publique soit placée sur une trajectoire clairement à la baisse ».
Malgré une baisse du déficit budgétaire à 2,5 % du PIB l’an dernier, la dette publique demeure élevée et le ratio dépenses publiques/PIB reste le plus élevé d’Europe. Pour le FMI, s’il n’existe pas de risque immédiat, étant donné le niveau actuellement bas des taux d’intérêt, le niveau élevé de la dette n’offrirait guère, selon l’institution, « de quiétude dans une perspective à moyen et à long terme ».
Le FMI suggère alors de procéder à un effort budgétaire structurel ambitieux afin de placer la dette sur une trajectoire ferme à la baisse. Un effort sur le solde budgétaire primaire structurel de quelque ½ % du PIB par an pendant la période 2020-23 qui permettait de réduire la dette de près de 10 % et porter le solde budgétaire structurel à son objectif à moyen terme d’ici 2023.
Pour le budget de l’année prochaine, cela implique de prendre des mesures d’assainissement qui compensent les mesures d’allégement fiscal d’avril dernier et qui réduisent sensiblement le déficit. Le FMI appelle à consentir un effort considérable du côté des dépenses : il faut « rationaliser les dépenses publiques » et « en accroître l’efficience ». La maîtrise des dépenses en 2018 constitue, à cet égard, un pas dans la bonne direction.
Les pistes évoquées par le FMI :
- Réforme de la fonction publique: pour réaliser des économies à moyen terme, les autorités doivent viser une baisse ambitieuse des effectifs par attrition, en particulier au niveau des collectivités locales.
- Réforme des retraites: pour réaliser des économies budgétaires, les autorités devraient envisager d’accélérer le relèvement planifié de l’âge effectif de départ à la retraite et de le lier à l’espérance de vie.
- Réforme des allocations de chômage: le FMI recommande une révision des règles de calcul et de cumul des allocations, ainsi qu’une réduction du niveau de l’allocation maximale. Cela contribuerait aussi à améliorer l’équité du système et à inciter au travail.
- Réformes supplémentaires : elles pourraient porter sur des domaines où les dépenses de la France sont élevées par rapport aux pays comparables :
- continuer de rationaliser les dépenses fiscales et les subventions dans certains domaines (transport, logement) ;
- réduire les coûts de la santé (produits médicaux, hôpitaux, centres de consultation externe), tout en protégeant la qualité des services de santé publique et les dépenses de recherche-développement ;
- améliorer l’allocation des dépenses d’éducation sur les différents niveaux (du secondaire au primaire, et au supérieur) ;
- mieux cibler les prestations sociales et d’en réduire les coûts administratifs (famille, logement) ;
- la fusion de petites municipalités et l’élimination de doubles emplois entre les fonctions des collectivités locales et l’administration centrale pourraient aussi produire des gains d’efficience.
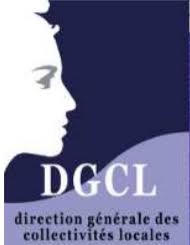
FPIC : les montants répartis en ligne sur le site de la DGCL
La Direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de mettre en ligne les montants des prélèvements et des versements du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) pour 2019. Au ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, on se félicite de stabilité du FPIC, gage d’un …
La Direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de mettre en ligne les montants des prélèvements et des versements du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) pour 2019.
Au ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, on se félicite de stabilité du FPIC, gage d’un engagement fort pour la solidarité financière entre les collectivités territoriales.
Il ressortirait de la nouvelle répartition du FPIC que :
- Le montant réparti au titre du FPIC est stabilisé à un milliard d’euros depuis 2016, conformément au choix du législateur, afin de maintenir l’intensité de l’effort de péréquation tout en assurant une certaine prévisibilité.
- 441 ensembles intercommunaux sont contributeurs nets en 2019 (431 en 2018) et 759 bénéficiaires nets (763 en 2018): « les changements de situation sont rares : 7 territoires sont nouvellement contributeurs nets et 3 deviennent bénéficiaires nets » remarque-t-on au ministère de la Cohésion des territoires.
- Le montant du FSRIF, 330 millions d’euros, est également stable par rapport l’an dernier (+20 millions d’euros par rapport à 2017).
Retrouvez les montants en ligne en cliquant ici.

Loi Santé : le Sénat adopte des mesures de lutte contre la désertification médicale
Le projet de loi “santé” est en cours d’examen au sein de la Chambre haute. Parmi les premières mesures adoptées par les sénateurs figurent notamment le renvoi à une négociation conventionnelle sur la question de l’accès aux soins, l’exonération de cotisations sociales pour les jeunes médecins s’installant dans les zones déficitaires, ainsi que la transformation …
Le projet de loi "santé" est en cours d'examen au sein de la Chambre haute. Parmi les premières mesures adoptées par les sénateurs figurent notamment le renvoi à une négociation conventionnelle sur la question de l'accès aux soins, l'exonération de cotisations sociales pour les jeunes médecins s'installant dans les zones déficitaires, ainsi que la transformation de la dernière année d'études de médecine générale en année de pratique "en autonomie" prioritairement dans les territoires en cours de désertification médicale.
Le Sénat poursuit son examen du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Une série de 14 amendements, de différents bords politiques, visaient à créer une forme de régulation de l'installation des médecins. Cette question a été renvoyée, à travers un amendement sénatoriale, à une négociation conventionnelle entre médecins et assurance maladie sur la contribution des médecins "à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins".
Les sénateurs ont également adopté un amendement visant à mettre en place une exonération de cotisations sociales incitative à l'installation rapide des jeunes médecins dans les zones déficitaires.
En attendant d'examiner les dispositions relatives au nouveau statut d'hôpital de proximité, le Sénat a confirmé la suppression du numerus clausus et a adopté un amendement novateur prévoyant prévoyant que la dernière année d'études du troisième cycle des études de médecine générale (et de certaines spécialités déficitaires) devienne une année de pratique "en autonomie", en cabinet ou au sein d'une maison de santé, prioritairement dans les zones déficitaires.
Le vote sur l'ensemble du texte aura lieu le mardi 11 juin prochain.
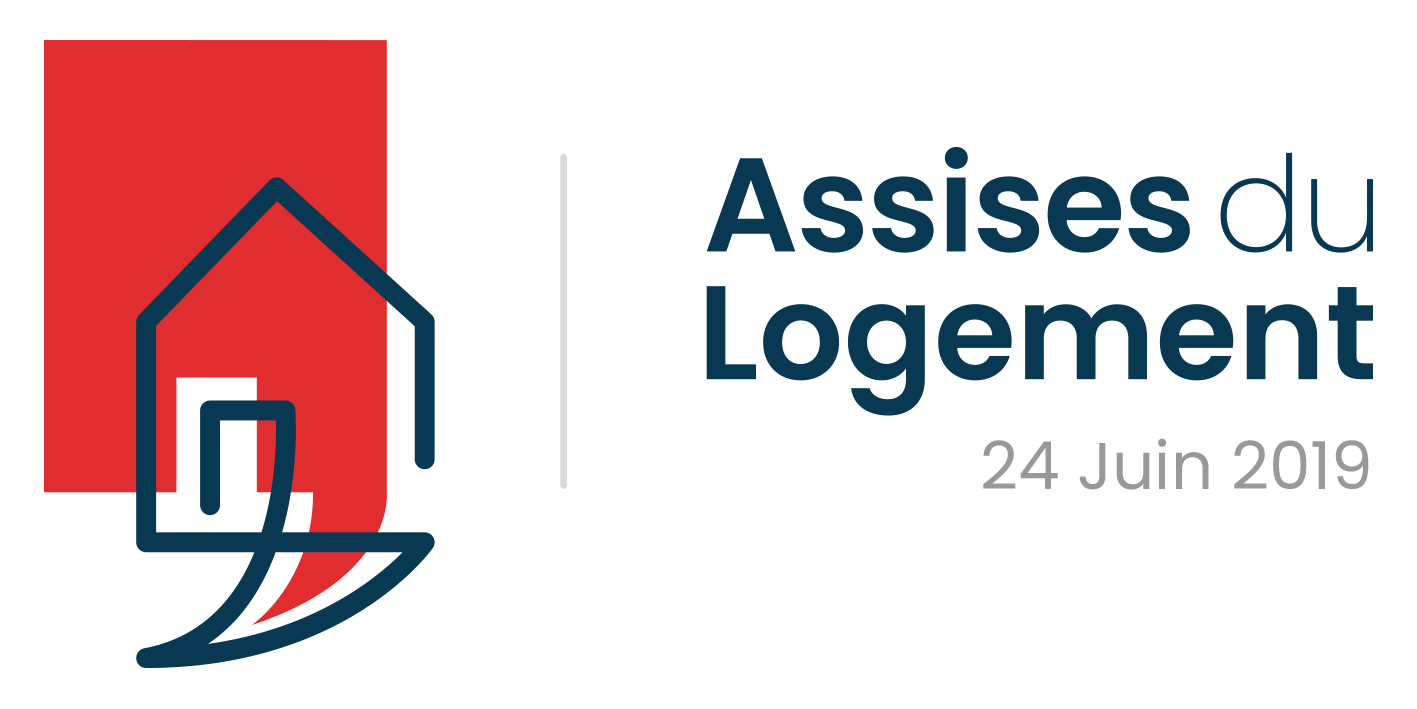
L’APVF partenaire de la 2ème édition des Assises du Logement
L’APVF est partenaire de la 2ème édition des Assises du Logement qui auront lieu le lundi 24 juin prochain à Paris. Il s’agit d’une journée unique pour suivre les évolutions en direct de toute la filière, des réglementations et des tendances qui font le logement de notre temps. Afin de s’informer, d’échanger, de découvrir …
L'APVF est partenaire de la 2ème édition des Assises du Logement qui auront lieu le lundi 24 juin prochain à Paris. Il s’agit d’une journée unique pour suivre les évolutions en direct de toute la filière, des réglementations et des tendances qui font le logement de notre temps.
Afin de s’informer, d’échanger, de découvrir les nouvelles pratiques et les usages, les 2èmes Assises du Logement regrouperont le lundi 24 juin tous les publics - maîtres d’ouvrage publics et privés, collectivités, maîtres d’oeuvre, institutionnels et politiques - autour des thématiques "Construire-Habiter-Connecter". En 2018, plus de 700 professionnels étaient au rendez-vous.
Pour cette deuxième édition, les enjeux sont considérables, car ils sont amenés à changer notre façon de vivre et à transformer nos villes et nos villages. Sans compter le poids économique important que représente la filière en France. De nombreuses réponses sont attendues : les conclusions du Grand Débat national, le cadre du plan de lutte contre l’habitat dégradé, les prochaines politiques de rénovation…, ainsi que les premiers bilans des lois ELAN et ESSOC. Les avancées du plan "Action coeur de ville" et notamment les appels à projets "Réinventons le coeur de ville" seront également au programme, ainsi que les questions d’accessibilité et d'adaptabilité, d’écoquartiers, d’outils numériques, de financement, de transformation des copropriétés…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Assises du logement !
